Archives du mot-clé Marc Esposito
Épisode 12 : ÉPILOGUE : SI C’ETAIT A REFAIRE


NDLR: Ce chapitre a été réactualisé avant publication en raison de changements survenus entretemps et des actualités respectives de Marc Esposito et Jean-Pierre Lavoignat.
ÉPILOGUE
REGRETS

Avez-vous des regrets concernant des réalisateurs ou des acteurs que vous n’avez pu rencontrer ?
Marc Esposito. Dans ma carrière de journaliste, l’un de mes rares regrets est de ne pas avoir pu vérifier ma théorie selon laquelle Sergio Leone était opiomane ! J’ai plusieurs indices : les scènes de fumage d’opium dans Il était une fois en Amérique, qui sont un vrai choix d’auteur, mais aussi la construction du film, en escargot, très complexe, mais cohérente dans l’esprit d’un créateur sous opium. De plus, quand je suis passé sur le tournage, Leone dormait sur sa chaise, au milieu de toute l’équipe qui s’affairait. Après avoir revu le film et goûté à l’opium, en revoyant la scène du téléphone qui sonne, je me suis dit : »C’est sûr, c’est un truc d’opiomane ! » J’aurais adoré avoir l’occasion, et l’audace, de lui poser la question !
Jean-Pierre Lavoignat. Moi, je regrette de ne pas avoir pu rencontrer Visconti et Brando. Pour Visconti, on est arrivés trop tard. Pour Brando, ça a failli se faire lorsque Euzhan Palcy a tourné Une saison blanche et sèche avec lui, mais on n’y est pas arrivés. Heureusement, Christophe, grâce aux rapports qu’il avait noués avec Johnny Depp, a pu l’interviewer sur le tournage de The Brave, et on a publié cette interview-évènement – la dernière grande interview cinéma de Brando – pour les dix ans de Studio. Pour un scoop, c’était un scoop ! Sinon, moi aussi, c’est avec Leone que j’ai l’un des grands regrets de ma vie de journaliste. Pour Première, je l’avais longuement interviewé avec Dominique Maillet pour la sortie d‘Il était une fois en Amérique, qui est assurément l’un de mes films préférés. Un jour – Studio existe déjà depuis plusieurs années – on apprend que Leone va bientôt tourner Les 120 jours de Leningrad. Avec Christophe, on demande à le rencontrer. Il nous reçoit chez lui, à Rome. On lui propose alors de suivre toutes les étapes de son projet, ce qu’il accepte. On le voit à chaque occasion possible. Je passe quelques jours avec lui pendant la Mostra de Venise 1988 dont il préside le jury, il vient en France invité dans un festival, Christophe le retrouve… A chaque fois, il nous raconte où il en est du casting, du financement, de son scénario. Cela devient de plus en plus excitant. Il joue incroyablement le jeu avec nous. De manière très amicale. Mais peu de temps avant le lancement de la préparation du film, il meurt subitement ! The end ! On avait créé de telles relations avec lui que j’aurais pu tenter, si tu m’en avais parlé alors, de lui demander s’il était ou avait été opiomane ! A Venise, je me souviens, il me disait : »Restez déjeuner avec moi, comme ça les gens ne viendront pas nous interrompre. Vous voyez Lina Wertmuller là-bas, je n’ai pas envie qu’elle vienne me parler ! » Il taillait tout le monde ! Ah ah ah ! Le Dernier empereur ? »Un film pour Vogue Homme ! » Visconti ? »Un très bon décorateur ! » Oui, c’est le plus grand regret de ma carrière à Studio. Mais franchement, je crois avoir rencontré tous les acteurs et tous les metteurs en scène que j’aimais ou que j’admirais. Le seul regret que j’ai aujourd’hui est de ne plus avoir de prétexte pour rencontrer ceux que je prenais plaisir à retrouver régulièrement – les Scorsese, Spielberg, Deneuve, Depardieu, Fanny Ardant, Jodie Foster, Auteuil, Almodovar, Lynch, Jeunet… avec lesquels s’étaient nouées au fil des ans de vraies relations. Et aussi de ne pas avoir de prétexte pour rencontrer les « nouveaux » dont les parcours m’intriguent et me passionnent. Heureusement, les master class ou les débats qu’on me demande d’animer aujourd’hui comblent parfois ces manques. Et les docs que je fais avec Christophe aussi, comme le dernier qu’on a fait sur les Three amigos mexicains : Alfonso Cuaron, Guillermo Del Toro et Alejandro Gonzalez Innaritu.

« A l’époque, les interviews étaient moins formatées. Il y avait moins d’intermédiaires. »
Quand on relit certains Première ou Studio, on se demande comment certaines interviews ont pu avoir lieu et être publiées : Deneuve-Depardieu sur Drôle d’endroit pour une rencontre, Beineix à propos de La Lune dans le caniveau. On n’imagine plus cela aujourd’hui !
JPL. En même temps, les gens que vous citez n’ont pas pour habitude d’être langue de bois ! Surtout avec nous. Disons qu’à l’époque, les interviews étaient moins formatées. Il y avait moins d’intermédiaires. Et c’étaient des gens qu’on connaissait bien. Quand Marc, dans Première, a fait l’interview-feuilleton de Beineix sur La Lune dans le caniveau, de la préparation au tournage, on ne demandait rien à personne, sauf à Beineix lui-même. Pareil quand on l’a fait, dans Studio, avec Régis Wargnier qui a tenu pour nous sur plusieurs numéros son journal de tournage d’Est-Ouest (dont il a d’ailleurs fait un livre ensuite). Aujourd’hui, il y a toujours quelqu’un dans l’entourage des artistes ou dans l’entourage de la production pour se demander si c’est pertinent de le faire, si c’est une bonne idée de marketing ! C’est un phénomène qui a commencé lors de mes dernières années à Studio et n’a cessé de s’accroître. Il y a des choses qu’on ne pourrait pas refaire aujourd’hui.


ME. Une chose est sûre : sans le savoir, je suis parti au bon moment. Je n’aurais pas aimé bosser avec les règles du jeu que Jean-Pierre a connues dans la décennie qui a suivi mon départ.
JPL. Et encore, à l’époque, il y a treize ans, ce n’était pas comme aujourd’hui. On réussissait à échapper aux press junkets (tables-rondes où sont réunis plusieurs journalistes, et qui sont devenus la règle de la promo), à publier nos photos de tournage sans les faire valider à qui que ce soit, à faire des photos avec les Américains, à avoir des rendez-vous qui duraient plus d’une demi-heure…. J’ai même fait une interview de plus de deux heures avec Tom Cruise pour un numéro dont il avait accepté d’être le rédacteur en chef, les gens du studio n’en revenaient pas qu’il se prête au jeu ! Il n’y avait pas tous ces intermédiaires qu’il y a aujourd’hui, même dans l’entourage des jeunes acteurs français qui ont fait trois films !
FILMS EMBLÉMATIQUES
S’il y avait des films de vos années Première-Studio que vous souhaiteriez faire redécouvrir, quels seraient-ils ?
ME. Tous les films qui me viennent à l’esprit sont des films connus.
Birdy (Alan Parker, 1985), par exemple, est-il si connu que ça par les nouvelles générations ?
ME. Sûrement pas, vous avez raison… La projection de Birdy à Cannes en 1985 était géniale. J’étais avec Bertrand Blier. Nous avions été emballés. Et pourtant, Blier est très, très difficile !
JPL. C’est bien pour ça que j’ai voulu faire avec Christophe un documentaire sur Alan Parker – et sur neuf autres cinéastes des années 80. Moi, l’une des projections à Cannes qui m’a le plus marqué, c’est celle de E.T. la dernière année de l’ancien Palais. On ne savait rien de rien du film, aucune image, on savait juste qu’il s’agissait d’un film de S.F., qui était censé se passer au moment où les enfants rentrent de l’école, avant le retour des parents. C’est la seule chose qui avait filtré. Et quand on a découvert le film le matin on était hallucinés ! Cela avait été un triomphe. Et je revois Spielberg, à la projection officielle du soir (on y était retournés !), souriant de bonheur au balcon de l’ancien Palais.
ME. L’histoire nous a donné raison sur le fait que les années 1980 ont été des années cinéma formidables. Ce qui ne se sent que quand on lit Première et Studio. Si vous lisez les critiques de l’époque dans Libération ou Télérama, ils en parlent comme d’une époque de merde, selon eux c’était mieux pendant la Nouvelle vague.
FUSION AVEC SCL
« Je ne lis plus aucun magazine de cinéma, sauf une fois l’an, avant de prendre l’avion, ça ne m’intéresse plus. »
Vous lisez toujours des journaux de cinéma ?
JPL. J’ai reçu Studio, puis Studio CinéLive, jusqu’à ce qu’ils arrêtent en décembre 2017, je ne lisais pas tout mais une bonne partie… Sinon, j’ai beaucoup de mal à lire aujourd’hui des journaux de cinéma, à regarder ou à écouter des émissions de télé ou de radio sur le cinéma, alors que j’aime toujours autant faire des interviews, des documentaires sur des réalisateurs ou des acteurs, animer des rencontres… C’est bizarre…
ME. Je ne lis plus Première depuis au moins 25 ans, depuis que j’ai quitté la presse. J’ai arrêté de lire Studio quand Jean-Pierre en est parti, en 2006. Je ne lis plus aucun magazine de cinéma, sauf une fois l’an, avant de prendre l’avion, ça ne m’intéresse plus. Ça m’amuse de faire du cinéma, c’est autre chose.
Comment avez-vous réagi à la fusion de Studio et de Ciné Live, en 2009 ?
JPL. On n’y était plus.
ME. J’ai eu l’impression que Studio avait bouffé Ciné Live. Le journal ressemblait plus à Studio qu’à Ciné Live.
JPL. C’est paradoxal, parce qu’à l’époque, il y avait plus de journalistes pigistes de Ciné Live que de Studio !
ME. Ça j’ignorais, je ne connaissais plus personne à Studio quand cette fusion a eu lieu.
JPL. Quand j’ai quitté Studio, en 2006, l’éditeur m’avait demandé d’avoir une fonction de conseiller. J’avais accepté sur le principe. Un jour, il me confie qu’il souhaite racheter Ciné Live et me demande ce que j’en pense. Je lui réponds que c’est une bonne idée. Ça permettrait de revenir à notre idée initiale, de deux journaux différents et complémentaires, comme lorsqu’on avait rêvé de faire à la fois Première et Studio. Et ce serait une très bonne chose pour la pub face à Première. Il me dit alors qu’on pourrait aller plus loin en mutualisant les critiques. Je tombe de ma chaise ! Si les critiques de Ciné Live sont les mêmes que celles de Studio, c’est que quelque chose ne tourne pas rond. C’est ce que je lui dis. Il ne m’a plus jamais rien demandé ! Finalement, il a racheté Ciné Live, et il a demandé à Michel (Rebichon) de diriger les deux journaux en même temps, chacun ayant un rédacteur en chef attitré, et de réussir à faire travailler les deux équipes au même endroit en mutualisant les services : le service photo, les secrétaires de rédaction… Opération qu’il réussit très bien, sans conflit. Un jour, au téléphone, Michel me dit qu’il a une réunion importante le lendemain matin pour préparer un séminaire – un de plus ! – pour une nouvelle formule de Studio et de Ciné Live. Le lendemain, il m’appelle et m’annonce… qu’il est viré ! On lui a dit : »Maintenant que les deux rédactions s’entendent bien, on va les fusionner pour ne faire qu’un seul journal. » Avec le sens de l’humour et de la répartie qui le caractérise, Michel leur répond : »C’est une mauvaise idée. Ils ont tous les deux une image très forte mais elle n’est pas vraiment compatible. C’est comme si on fusionnait Dior et Zara ! » Ils enchaînent : »C’est donc que vous n’êtes pas l’homme de la situation, au revoir ! » Et sans autre discussion, ils l’ont licencié. Il leur a fait un procès qu’il a gagné bien sûr. La direction croyait qu’elle allait additionner les lectorats. En fait, elle les a divisés par deux !
PREMIÈRE ET STUDIO TODAY
« Quand Les Cahiers se sont ouverts, sous l’ère Toubiana, il est arrivé qu’ils fassent des couvs sur les mêmes films que nous. »
Après avoir quitté la presse cinéma tous les deux, quel a été votre regard sur Première et StudioCinéLive ?
ME. Ce qui manque aujourd’hui, et qui manque depuis longtemps, à Première, et c’est aussi ce qui manquait à StudioCinéLive, c’est qu’ils n’ont aucune personnalité cinéphilique, ils ont les mêmes goûts que tout le monde. A mon époque, Première et Studio étaient des journaux qui défendaient un certain cinéma contre un autre – ça n’existe plus. Je serais curieux de faire l’expérience : comparer les classements annuels de Télérama, Première, Studio et des Cahiers à notre époque et ces dix dernières années. Dans les années 80, souvent, il n’y avait pas un seul film en commun dans nos Top 10. Alors qu’aujourd’hui, il doit y en avoir la moitié, voire davantage. Ce ne sont pas Les Cahiers ou Télérama qui ont changé, ce sont les journalistes de Première et Studio qui se sont mis à aimer les mêmes films chiants qu’eux !
JPL. Il y a eu quelques exemples inverses, mais très peu je te le concède ! Quand Les Cahiers se sont ouverts, sous l’ère Toubiana, il est arrivé qu’ils fassent des couvs sur les mêmes films que nous, comme sur Tenue de soirée, de Blier, ou sur Sous le soleil de Satan de Pialat, par exemple. C’était quand même rigolo.
ME. On a aimé, contre l’avis général des autres critiques, beaucoup de films qui sont restés… Amadeus, Le Cercle des poètes disparus, Greystoke, Pretty Woman… On était en phase avec les gens qui allaient au cinéma. Quand Première démarre, il est lu par les 15-24 ans, et moi j’ai 24 ans, je suis donc dans la même génération. J’ai senti que les choses avaient changé en 1987, au démarrage de Studio. J’avais 35 ans, et le film-culte de l’année, c’était Le Grand bleu, qui n’enthousiasmait personne dans notre rédaction. Notre public était devenu plus jeune que nous… On a dû seulement mettre 2 étoiles dans nos tableaux, alors que nos lecteurs allaient le voir dix fois !
JPL. C’est la période où l’on a reçu le plus de lettres nous engueulant ! C’est moi qui avais fait la critique, et on n’a mis en effet que 2 étoiles ! Après, Luc Besson a dit qu’on l’avait assassiné !
ME. Pour Luc Besson, si tu ne te prosternes pas devant lui en hurlant au génie, tu l’assassines !
JPL. On a fini par se réconcilier avec lui, mais… après Jeanne d’Arc ! On lui avait demandé une longue interview dans un numéro spécial sur les années 90 et il avait accepté. La première dans Studio. A la fin de l’entretien, il m’avait offert le livre du tournage de Jeanne d’Arc avec cette dédicace : ” Jeanne d’Arc m’a appris une chose : la guerre ne fait que des perdants ”. Ensuite, on a régulièrement travaillé avec lui.

« Aujourd’hui, le niveau d’ensemble (…) des séries s’est considérablement élevé, jusqu’à devenir très supérieur au niveau d’ensemble des films de cinéma »
ME. Il s’est réconcilié avec toi, pas avec moi. En 2003, quand Blier a été sélectionné à Cannes avec Les Côtelettes, produit par Besson, je suis descendu deux jours au Festival pour assister à la projection et soutenir Blier. Quand j’arrive sur la Croisette, je vois très vite Blier, qui m’invite à venir sur le bateau de Besson pour un raout en l’honneur des Côtelettes. Je lui réponds que je ne veux pas aller à une fête de Besson sans être sûr de ne pas être persona non grata, Blier se marre, il me dit que nos disputes sont anciennes, que Besson n’en a plus rien à foutre, je reste sceptique, Besson a la réputation d’être très rancunier, je lui dis que je n’irai à ce raout que s’il en parle à Besson et que Besson est ok. Blier demande donc à Besson s’il peut m’inviter, et Besson lui répond : ‘’Tu veux inviter mon pire ennemi ?!’’ Je n’y suis donc pas allé ! Ah ah ah ! Pour en revenir à Première aujourd’hui, ou aux derniers StudioCinéLive, je ne comprends pas qu’ils ne se soient pas davantage ouverts aux séries. Ils ont la chance d’avoir des titres, Studio, Première, qui ne contiennent pas le mot cinéma, ils auraient facilement pu se permettre d’élargir leur champ d’action… Game of Thrones mérite plus de pages que n’importe quel film. La moitié du magazine devrait leur être consacrée. A notre époque, c’était différent. Quand on démarre Première, les séries qui marchent, c’est Dallas et Les Feux de l’amour ! Aujourd’hui, le niveau d’ensemble – scénario, mise en scène, acteurs – des séries s’est considérablement élevé, jusqu’à devenir très supérieur au niveau d’ensemble des films de cinéma.
Après huit ans d’existence, Studio CinéLive a été racheté par le groupe qui édite Première et qui a décidé de l’arrêter en décembre 2017, pour mieux relancer un nouveau Studio quelques mois plus tard sous forme d’un trimestriel de luxe. Qu’avez-vous pensé de ce nouveau Studio qui n’a finalement eu que deux numéros ?
ME. Dès que j’ai lu le n° 1, je me souviens avoir dit : ‘’Il n’y aura pas de numéro 3’’ – il y a toujours un n° 2 parce qu’on le boucle avant d’avoir les résultats du 1. Sur le papier, l’idée était jolie, mais je n’ai jamais cru à la périodicité trimestrielle, encore moins pour un magazine de cinéma. C’est inadapté au rythme de l’actualité cinéma : quand un film reste un mois à l’affiche, c’est un exploit. La seule solution aurait été de faire un magazine déconnecté de l’actualité, c’était loin d’être le cas. Surtout, il y avait trop de sujets photos interminables sur des jeunes et belles actrices quasi inconnues, qui jouaient aux mannequins, avec en légende les marques de leurs vêtements : pantalon Trucmuche, chemise Tina Z, chaussures Jim Plouf, ça me semblait totalement à côté de la plaque. Et même anti-cinéphile. Un acteur n’est pas un mannequin, un magazine de cinéma devrait illustrer cette différence et non la gommer. Une photo d’acteur doit promouvoir l’acteur, son regard, son humanité, sa beauté, pas les fringues qu’il porte, et d’autant moins qu’elles ne viennent pas de sa garde-robe personnelle, rien n’est usé, porté, ça donne des photos de mode, sans vie, pas des photos de cinéma. Là encore, on voit comme les choses ont changé depuis nos années 80. J’ai eu une grosse engueulade avec Coluche à cause d’un sweat shirt qu’il portait dans La Femme de mon pote (de Bertrand Blier, 1983). On avait fait un reportage sur le tournage, et publié une photo d’une scène du film où il portait un sweat avec la marque écrite dessus. Dès la parution du reportage, il m’avait téléphoné, furieux, il était convaincu que j’avais touché du pognon de la marque du sweat pour publier cette photo ! J’étais tout aussi furieux qu’il pense un truc pareil, on s’est hurlé dessus pendant un quart d’heure ! Si on avait mis en légende »Sweat shirt Marcel Dugenou », il aurait mis un contrat sur ma tête !
JPL. J’avais trouvé que le défi de relancer Studio était sacrément gonflé par les temps qui courent où la presse papier a… si mauvaise presse ! Cela rendait le pari encore plus excitant. En plus que Thierry Chèze en soit le rédacteur en chef, alors qu’il est arrivé à Studio comme stagiaire en 1993, et qu’il n’en est jamais parti, bouclait la boucle d’une certaine manière. Le nouveau Studio était un très bel objet, avec une belle maquette, de belles photos et des articles intéressants. Je trouvais juste que ça manquait d’images de cinéma et aussi de mythologie. Mais ce n’était apparemment pas leur volonté. Dommage qu’on ne leur ait pas laissé le temps de se trouver. Deux numéros, c’est quand même pas beaucoup. Peut-être était-ce économiquement intenable… Mais comme Marc, je pense que le rythme trimestriel était très difficile à tenir, et comme lui aussi, j’avais été choqué par la présence des marques partout, même dans les chapeaux des articles ! Je m’étais juste dit que c’était la marche du temps, que j’étais sans doute trop vieux, et que les lecteurs auxquels il s’adressait ne seraient pas choqués, eux qui arborent fièrement les logos des marques sur leurs vêtements quand moi, adolescent, je décousais les crocodiles de mes chemises Lacoste ! Première a donc finalement absorbé Studio. C’est sûr, symboliquement, j’aurais préféré que ce soit l’inverse… Au moins, les trois journalistes qui restaient de mon époque (Thierry Cheze, Sophie Benamon et Thomas Baurez) ne se sont pas retrouvés sur le carreau et ont intégré l’équipe de Première. C’est quand même un drôle d’épilogue…
Quel mot résume le mieux votre période Studio Magazine ?
ME. Jeunesse ! J’ai arrêté la presse à 40 ans, quand on cesse d‘être jeune.
JPL. Ce n’est pas mon cas ! Alors je pourrais dire « excitation » et « plaisir ». L’excitation, le foisonnement, le bouillonnement, le plaisir d’avancer en bande et de travailler en équipe, le plaisir des rencontres avec des gens qu’on admire, voire qu’on aime, le plaisir de partager notre plaisir.
ME. Même en réfléchissant, c’est ça qui reste : ces 17 ans de Première – Studio, c’est ma jeunesse, c’est notre jeunesse. On était tous très jeunes. A part Henry Béhar, Martine Moriconi et Jean-Pierre, qui a, comme chacun sait, six mois de plus que moi, pendant 17 ans, j’ai le plus souvent engagé des gens plus jeunes que moi, souvent des débutants. On a toujours travaillé avec des jeunes de 25 ans, 30 ans maxi… Ma première assistante, Gigi, devait avoir à peine 20 ans, moi 28, c’était joyeux ! Si je l’avais laissée faire, elle aurait fumé des pètes à son bureau toute la journée !
JPL. Ça, y a que toi qui avais le droit !
ME. Ah ah ah ! S’il fallait hiérarchiser les souvenirs, mes années Première Studio, ce sont d’abord des histoires humaines qui restent, mes relations avec tous ceux avec qui j’ai fait ces journaux. Jean-Pierre, Dany, Jean-Luc Levesque, Christophe, Denis, Catherine Wimphen, Pascaline, Christine, mes assistantes, Catherine, Gigi, Lili, Sylvie, Juliette, ont plus compté dans ma vie que Claude Sautet ! Les seuls artistes qui ont compté autant, ce sont ceux avec qui j’ai vraiment eu des histoires humaines fortes, et ce qui est dingue, c’est que ce sont les quatre du film-culte de ma jeunesse : Depardieu, Dewaere, Miou-Miou et Blier, le seul avec qui je suis toujours ami, depuis 30 ans maintenant… Les films viennent en dernier, j’ai peu de souvenirs de films.
JPL. Je pense que ce sont deux choses vraiment différentes. Il y a d’un côté l’aspect humain du journal, de son aventure collective et de sa fabrication, et l’excitation qui a accompagné tout ça – et là dessus, je suis d’accord avec Marc, ces relations que j’ai pu avoir quasiment avec tous ceux avec lesquels j’ai travaillé, dont certains sont toujours des amis que je vois régulièrement, ont énormément compté, forcément même plus que tout le reste. Et de l’autre côté, il y a les films qui nous ont marqué personnellement, qui ont compté pour nous intimement. Il y en a beaucoup dont je me souviens très bien, que je revois, que j’ai plaisir à présenter voire à faire découvrir dans les séances d’UGC Culte ou ailleurs. Les films, ce pourrait être l’objet d’un autre entretien, où on regarderait la liste de tous les films sortis pendant toutes ces années-là et où on dirait ce qu’il nous en reste aujourd’hui.
SI C’ÉTAIT A REFAIRE
Si c’était à refaire, le referiez-vous ?
ME. Aujourd’hui ? Non, bien sûr.
JPL. Revivre ce qu’on a vécu, en en ayant tiré les leçons ? Tout de suite ! Mais aujourd’hui ? Ah non, jamais ! Je suis trop vieux !
ME. C’est une expérience unique, indépassable. J’ai rencontré plein de gens formidables, j’ai pu écrire exactement les articles que je voulais, j’avais une liberté totale, on avait créé un outil idéal pour les journalistes de cinéma que nous étions, c’était génial, je me suis éclaté, comme peu de gens ont eu la chance de s’éclater dans leur vie. En tant que dirigeant, j’ai été trop peu procédurier, trop insouciant, trop imprudent. Aujourd’hui, les gars dans notre position ont des contrats en béton, des avocats dans tous les coins. Tout ce qui est arrivé de négatif ne serait pas arrivé si on avait été plus prudents et davantage hommes d’affaires. Je suis sorti de ces 17 ans de presse sans un rond, criblé de dettes, parce que ce job, et mes fréquentations liées à ce job, me poussaient à vivre très au-dessus de mes moyens, vu mon salaire très raisonnable ! On était une bande d’amis – il m’est arrivé d’inviter toute l’équipe avec leurs familles à réveillonner chez moi, juste eux et moi – je ne pouvais pas me payer comme un nabab et eux comme des gueux ! L’échelle des salaires était plus resserrée qu’ailleurs, à la suédoise, de 1 à 3,5.
JPL. Comme dit Marc, on ne connaîtra jamais meilleures conditions. Comme lui, j’ai eu beaucoup de chance, j’ai rencontré des gens incroyables, des artistes magnifiques, j’ai vécu des moments rares, j’ai partagé des émotions formidables avec des gens dont j’étais proche, j’ai aimé ce travail en équipe, j’ai fait des voyages insensés, j’ai vécu des aventures que je n’imaginais même pas pouvoir vivre… « J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans ». Qu’est-ce que vous voulez qu’il m’arrive de plus ? En même temps, je ne suis pas du tout nostalgique. Jamais, je ne me dis ‘ »c’était mieux avant ». Ou alors disons que… j’ai la nostalgie joyeuse ! Je suis tellement heureux d’avoir vécu tout ça et de pouvoir, comme dans cet entretien, le partager avec d’autres.
Si aujourd’hui vous aviez carte blanche pour créer un journal, vous ne seriez pas tentés ?
ME. Jamais ! Même avec un revolver sur la tempe ! Un peu après Studio, j’aurais pu être intéressé par une aventure différente, j’aurais aimé m’occuper d’un news politique, comme L’Express ou Le Nouvel Obs, mais on ne me l’a jamais proposé, et je n’ai jamais espéré qu’on me le propose. Je suis un rêveur, mais un rêveur lucide !
JPL. Créer un journal aujourd’hui ? Jamais, mais j’accepterais volontiers – et encore, plus les jours passent et plus j’en doute sérieusement ! – un poste de grand reporter de luxe. Je choisis les thèmes de mes papiers, je vais rencontrer les gens, et je suis très bien payé, etc. Mais je ne veux plus de responsabilités dans un journal !

Quand nous avons réalisé l’essentiel de cet entretien, en 2016, vous aviez tous les deux décidé d’en faire un livre, vous avez signé un contrat avec un éditeur, vous en aviez parlé sur Facebook, et puis ce livre ne s’est pas fait, et Marc a écrit tout seul ses ‘’Mémoires d’un enfant du cinéma.’’ Que s’est-il s’est passé ?
ME. Même si ces entretiens étaient une bonne base de départ, nous avions beaucoup de choses à réécrire, et surtout à compléter, c’était un très gros travail… J’avais le temps de m’y consacrer à temps plein, et j’ai donc avancé beaucoup plus vite que Jean-Pierre dans l’écriture ou la réécriture de mes interventions. Jean-Pierre, lui, était pris par ses diverses et nombreuses activités, il avançait beaucoup plus lentement que moi, et reportait sans cesse la livraison de ses textes. Fin août 2017, j’avais fini tout mon travail, alors que lui n’en était qu’au premier tiers. Au fil des semaines et des reports de livraison des textes, nos rapports, par mail, lui à Paris moi à Bali, se sont tendus, je ne comprenais pas qu’il préfère aller présenter le film de Thierry Klifa en province ou interviewer Inarritu ou del Toro pour ses docs plutôt que de travailler sur ce livre, j’ai fini par penser qu’il en avait moins envie que moi – je le pense toujours, quoi qu’il dise ! – et mes mails sont devenus de plus en plus désagréables… Heureusement, en janvier 2018, il a pris la décision qui nous a empêchés d’aller plus loin dans le conflit, il m’a dit : ‘’On n’a pas signé ce livre pour s’engueuler, et se stresser, je préfère qu’on arrête.’’ Alors, on a arrêté, et je me suis lancé dans l’écriture de mes Mémoires. Et je vous ai demandé d’enlever de cet entretien tous les passages, toutes les anecdotes que je voulais garder pour mon livre (mes relations avec les ‘’vedettes’’, surtout) et de reporter sa parution sur vos sites pour ne pas déflorer mon livre, ce que vous avez accepté, et je vous en remercie de nouveau ici.
JPL. En fait, lorsque je suis allé voir mon éditeur en mai 2017 pour lui proposer ce livre à deux voix, il a été tout de suite enthousiaste et m’a dit que ce serait bien pour une sortie au printemps ou à l’été 2018, ce qui était idéal pour moi, mais Marc tenait à une sortie au printemps, car il espérait tourner son film indonésien en 2018. En juin, je me suis laissé convaincre par lui et par l’éditeur que j’arriverais à l’écrire et le terminer sans problème pour la fin 2017, pour parution au début du printemps. C’est ma grande erreur. Non seulement parce que je devrais savoir depuis le temps que plus je vieillis et plus j’écris lentement – aucun des livres que j’ai faits n’est sorti à la date initialement prévue !! – mais surtout parce que j’avais des engagements desquels je ne pouvais pas me défiler. Et notamment quatre docs sur le feu : Michel Hazanavicius, et les 3 Amigos : Cuaron, Innaritu et Del Toro. C’étaient des docs que j’avais initiés et « vendus » à Canal + Cinéma et à OCS, il était impossible de les repousser et encore moins que je ne les fasse pas… Sans même parler des présentations mensuelles d’UGC Culte… Au fil des mois, ça s’est révélé très compliqué pour moi de travailler sur tout à la fois, d’autant que Marc, lui, avançait à la vitesse de l’éclair et que je me retrouvais devant des pages de texte dans lesquelles il n’était pas si simple d’intervenir. A l’automne, j’ai bien compris que je n’y arriverais pas, mais j’essayais quand même. Je me consolais en me disant qu’après tout, il n’y avait pas d’autre urgence que celle qu’on se fixait. Les anniversaires de Première et de Studio étaient passés, ce livre pouvait sortir six mois, voire un an plus tard, c’était pas bien grave. Ce n’était pas l’avis de Marc dont les mails, c’est vrai, devenaient de plus en plus désagréables. J’ai donc préféré arrêter. Disons qu’il était trop impatient et moi trop lent. La distance qui s’est alors instaurée entre nous n’a duré que quelques mois. Des évènements privés et professionnels ont fait qu’on a repris naturellement contact, et que tout s’est enchaîné. Après tout, peut-être que, comme le disait Fellini pour les films, ‘’les livres se font comme ils doivent se faire.’’. Résultat : son livre est passionnant, personnel, foisonnant, formidable. J’ai adoré le lire. Et j’attends le tome 2 ! En plus, imaginez, ces « Mémoires d’un enfant du cinéma» font déjà 535 pages. S’il avait été à deux voix, il en ferait mille ! Rien que pour les années Première ! Ah ah ah…
ME. La première fois que nous nous sommes revus, pour déjeuner, au Wepler, trois ou quatre mois après cette embrouille, nous avons réussi à papoter deux heures ensemble comme si rien ne s’était passé, sans jamais évoquer cette histoire ! Aucun de nous deux n’en avait envie, notre désir de rester amis était trop fort pour qu’on prenne le risque de s’accrocher en reparlant de cet épisode finalement sans importance, puisque je suis ravi de m’être lancé dans mes Mémoires, qui m’ont permis d’écrire un livre bien plus personnel en effet que ne l’étaient ces entretiens. Et j’espère bien que Jean-Pierre se décidera vite à écrire ses Mémoires, car il a aussi beaucoup de jolies choses à raconter, il connait tous les artistes de cinéma de la planète !
JPL. On verra… Pour l’instant je n’y suis pas encore prêt. D’autant que la seule envie que j’ai maintenant, c’est de moins travailler. Voire… plus du tout !
Marc, comment avez-vous vécu la sortie de vos Mémoires ?
ME. Mal ! Les dernières semaines avant la sortie, ma relation avec mes éditeurs s’est gravement détériorée, parce qu’ils craignaient une avalanche de procès, alors que j’étais sûr qu’il n’y en aurait aucun – l’Histoire m’a donné raison, il n’y en a pas eu un seul à ce jour. J’ai refusé de couper ce qu’ils voulaient que je coupe, ils l’ont très mal pris, et à partir de là, tout est allé de mal en pis, le tirage, la mise en place, la promo, la presse… Je préfère ne pas en dire plus, car cette affaire n’est pas terminée… Heureusement, grâce au bouche à oreille, j’ai l’impression que le livre est toujours ‘’vivant’. Plus de quatre mois après sa sortie, il est parfois mieux exposé qu’à sa sortie… J’aurai les chiffres de ventes à la fin de l’année, quand l’éditeur sera obligé de m’envoyer les comptes, on verra bien.
Vous avez dit dans une interview que vous aviez l’intention d’écrire deux autres tomes, un qui irait de la création de Studio jusqu’au Cœur des hommes, puis un autre sur votre parcours de réalisateur. C’est toujours à l’ordre du jour ?
ME. Oui, bien sûr. Mais je n’ai pas encore commencé à écrire le tome 2, j’ai besoin de souffler, le tome 1 a été un gros travail.
Et votre film indonésien, l’adaptation de Sang et volupté à Bali, de Vicky Baum ? Est-il toujours d’actualité ?
ME. Oui, je m’active toujours à chercher les pépettes pour le faire. J’attends des réponses importantes, je saurai vite si je le tourne, comme j’espère, en 2020 ou pas. Je croise les doigts, je touche du bois.
Jean-Pierre, au même moment que les Mémoires de Marc, vous avez publié un livre avec Danièle Thompson consacré à Gérard Oury (Mon père, l’as des as. Ed. La Martinière). Comment s’est déroulée cette aventure ?
JPL. En fait, cela s’est fait un peu à mon corps défendant ! Ah ah ah … En mai 2018, Isabelle Dartois, des Editions de La Martinière, m’a parlé d’une idée de livre sur Gérard Oury, écrit par Danièle Thompson, qui, comme chacun sait, est non seulement sa fille mais aussi sa principale collaboratrice – elle a écrit avec lui onze de ses dix-sept films, dont les plus gros succès : Le Corniaud (officieusement), La Grande Vadrouille, La Folie des grandeurs, Rabbi Jacob, L’As des as... Et m’a proposé de l’écrire avec elle, car Danièle était très occupée par l’écriture avec son fils, Christopher, d’une série sur les jeunes années de Brigitte Bardot. J’ai décliné sa proposition, pas tout à fait guéri encore de Casino d’hiver, que j’ai écrit avec Dominique Besnehard, et de l’expérience du livre à deux voix avec Marc. Un peu plus tard, je tombe sur Danièle Thompson qui me dit : « C’est génial, ce projet avec toi ! Je suis ravie que tu aies accepté ! Sans toi, je ne l’aurais pas fait. » La Martinière m’avait finalement « vendu » malgré moi ! Ah ah ah ! Danièle était si contente que je n’ai pas osé lui dire que j’avais refusé, et puis, au fond, je crois que ça m’amusait d’écrire à nouveau en me mettant dans la peau de quelqu’un d’autre. C’est un exercice intéressant. Une sorte de défi même. Si Danièle et Isabelle ont pensé à moi, c’est que non seulement je connaissais bien Danièle, et l’aimais beaucoup, et que j’aimais beaucoup aussi Gérard Oury auquel d’ailleurs j’avais, à la demande de Christopher Thompson, consacré un documentaire que nous avions réalisé avec Stéphane Groussard (Gérard Oury, Il est poli d’être gai. 2002) quelques années avant sa mort.
Quand l’aviez-vous rencontré pour la première fois ?
JPL. A l’époque de Première. Ce devait être en 1985 ou 1986. Unifrance avait organisé un mini festival du cinéma français en Inde, à Bombay, et m’avait invité avec deux autres journalistes. Gérard Oury et Miou Miou étaient les vedettes de cet évènement. C’était un voyage incroyable. Le choc de l’Inde… On en parlera une autre fois ! Ah ah ah ! Miou Miou n’a finalement pu nous rejoindre qu’à la fin du séjour. J’ai donc passé des journées entières avec Gérard Oury qui était non seulement un homme délicieux mais un conteur merveilleux. Je ne cessais de l’interroger et l’écoutais raconter mille anecdotes avec un vrai bonheur. Cela a créé des liens entre nous. Ils ont perduré au fil des ans, même si je n’ai pas toujours été fan des films qu’il a faits après. Pour ce livre, j’ai donc interviewé Danièle longuement – et c’était passionnant d’écouter sa fille parler de lui, raconter cette vie ô combien romanesque, avec tant d’épreuves et tant de succès… Puis, je me suis mis à écrire un premier jet, et ensuite, il y a eu pas mal d’allers-retours entre elle et moi… Et voilà. Le livre est plus long que les prévisions de La Martinière et… il est sorti avec trois semaines de retard ! On ne change pas les rayures du zébre, dirait Depardieu. Ah ah ah !
Jean-Pierre, même si vous voulez vous arrêter, vous allez bien refaire quelques documentaires ou un livre, non ?
JPL. Pour les documentaires, Christophe est là qui me pousse. Et on va commencer à réfléchir d’ici peu à quelques idées… Pour les livres, on verra. Si j’ai aujourd’hui envie de ne plus rien faire, c’est que mine de rien, depuis que j’ai quitté Studio, il y a 13 ans déjà, je n’ai pas arrêté : des articles de-ci de-là, des dossiers de presse pour des copains réalisateurs, cinq livres, près de vingt documentaires, une grande expo sur Romy Schneider, la programmation pendant un an du cinéma de répertoire Les Fauvettes, la responsabilité d’UGC Culte, et je ne parle même pas des master-class du Festival de Marrakech ou ailleurs, de la chaîne de télé éphémère et de la radio du Festival d’Angoulême, des animations de débat ou des présentations de films…
ME. Le problème de Jean-Pierre, depuis longtemps, c’est qu’il a rayé de son vocabulaire le mot : ‘’non’’. Ah ah ah !
JPL. Je suis en train de le réapprendre… ! En même temps, si je fais tout ça, c’est aussi parce que ça me plaît toujours, parce que ça m’excite encore, parce que je ne suis pas du tout blasé. Et puis, sans être trop pompeux, tous ces différents travaux ne sont au fond que des opportunités de transmission, c’est une manière de rendre un peu ce qui m’a été donné… Il n’empêche que je rêve aussi – et de plus en plus ! – de ne rien faire. Comme je le répète souvent, je suis un feignant contrarié, comme on parle de « gaucher contrarié » !
ME. Moi, c’est différent. Depuis que j’ai quitté Studio, ça fait plus de 25 ans maintenant, j’ai une vie super cool, et en plus, depuis trois ans, je vis à Bali. Je travaille chez moi, j’écris beaucoup, je suis très actif, mais sans avoir de contraintes. Je travaille où je veux, quand je veux.
JPL. Un homme libre ! Et heureux, en somme !
ME. J’ai l’impression d’avoir toujours été les deux. J’ai eu une chance de dingue !
FIN
Propos recueillis par Sylvain Lefort & Fred Teper
BONUS
Les inédits (Photos rares et documents privés)











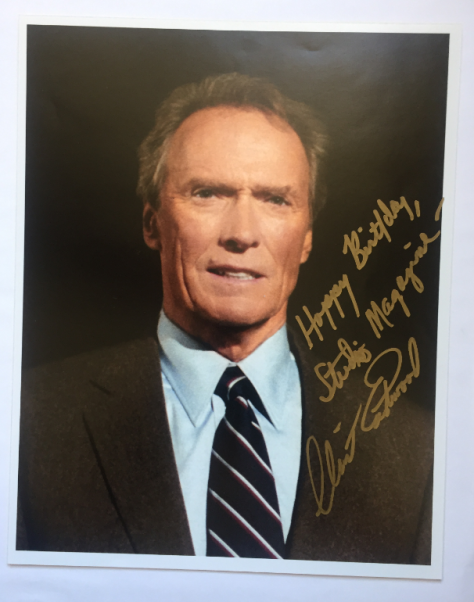



tu la passes dans Studio? » Jean-Pierre accepte, ils ont fait la photo et elle est passée dans Studio.
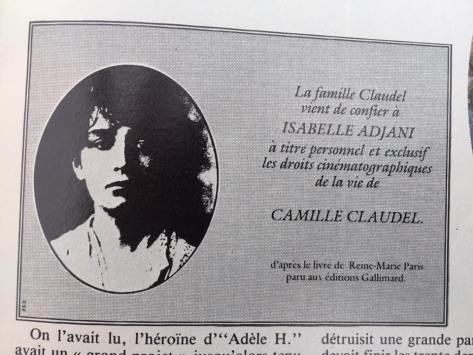





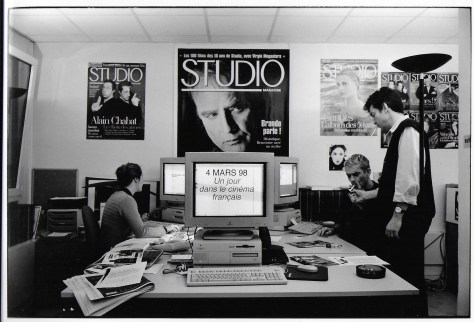









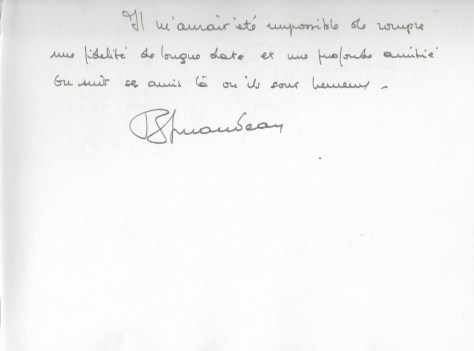











Les Tops de Première et Studio Magazine de 1981 à 1992
1981


1982


1983

1984
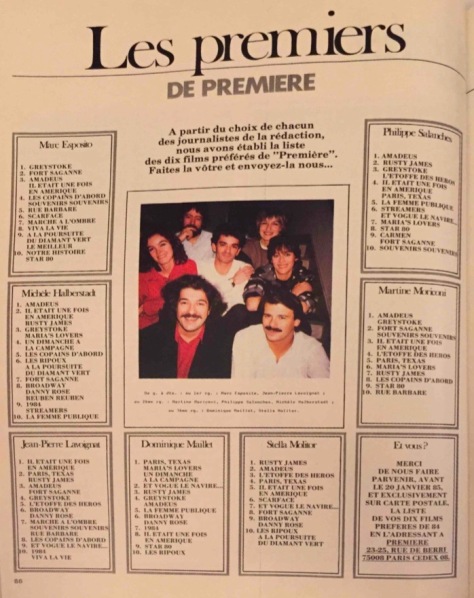

1985


1986

1987

1988


1989


1990


1991


1992


Commander Mémoires d’un enfant du cinéma de Marc Esposito (Editions Robert Laffont) ici
Commander Gérard Oury – Mon père L’as des as de Jean-Pierre Lavoignat & Danièle Thompson ici
Épisode 11 : AFTER WORK


DÉPART
« Mon départ n’a jamais été à l’ordre du jour, tout s’est joué en 24 heures. »
Marc, vous avez quitté Studio en mars 1993. Qu’est-ce qui vous a conduit à prendre cette décision ?
Marc Esposito. Mon départ n’a jamais été à l’ordre du jour, tout s’est joué en 24 heures, à cause d’un faisceau d’événements qui, tous, m’ont poussé à ce départ. Le terrain était favorable, car j’en avais marre de plein de choses… Marre d’être patron, marre de voir autant de films, marre de vivre à Paris. Depuis la rentrée 1992, Adèle vivait chez sa mère, j’avais émigré en Provence, et je ne venais plus au bureau que 4 jours par semaine, c’était une première prise de distance. Ce qui a compté, aussi, c’est que mon entente avec la rédaction, depuis les conflits engendrés par le quotidien de Cannes en 91, n’était plus aussi parfaite que la décennie précédente. A l’époque, je voulais transformer Studio en hebdo multi-culturel, exactement ce qu’a fait Les Inrocks plusieurs années plus tard, mais je sentais bien que la rédaction n’était pas emballée par cette perspective, qu’ils n’y croyaient pas. Il y a enfin que les ventes de Studio stagnaient autour de 80 000, j’avais rêvé de plus, j’avais rêvé de faire trois journaux en même temps, alors gérer le train-train d’un mensuel à 80 000 exemplaires, ça ne pouvait pas m’emballer longtemps. D’où l’idée de passer hebdo et d’élargir notre champ d’action… Bref, tous ces éléments réunis ont créé, sans que je m’en aperçoive, des conditions favorables à mon départ, manquait juste l’incident déclencheur. Il est arrivé le 5 mars 1993, en deux étapes. 1ère étape, 11 h du matin, je roule sur l’autoroute A1, Lille-Paris, je suis seul, je viens de passer deux nuits sur le tournage de Germinal, et je rentre à Paris pour assister à une réunion importante avec nos directeurs financiers. Je viens d’avoir 40 ans, je me dis que ça fait trop longtemps que j’ai mis de côté mes envies de réalisation, et je me fais un serment, lié à ma réunion de l’après-midi avec nos directeurs financiers : »S’ils osent me demander de licencier qui que ce soit, je me casse. » Je savais que Studio perdait un peu d’argent, qu’il fallait faire des économies, mais personne n’avait encore osé me demander de licenciements. Mais cette fois, ils ont osé. Je leur ai répondu : »Mon salaire fait l’équivalent des économies que vous me demandez, c’est moi qui m’en vais », je me suis levé, je leur ai serré la main, et ils ne m’ont plus jamais revu. Je n’ai pas vécu ce clash comme un coup de tête, mais comme le résultat d’une succession d’événements que je n’ai pas décidés, qui m’ont mené inexorablement à cette décision.
Jean-Pierre Lavoignat. J’étais encore au bureau, quand tu es arrivé après cette réunion. Tu m’as dit : »Je vais m’en aller ». Je t’ai dit : »Je m’en vais aussi. » Et tu m’as dit : »Non, il faut que tu restes. Il faut que Studio continue. »
Ont-ils essayé de vous retenir ?
ME. Non. J’ai appris par la suite qu’ils avaient contacté des chasseurs de têtes pour me remplacer. Il faut croire qu’ils n’avaient pas trouvé ! Les modalités de mon départ se sont réglées très vite, juste avec mon avocat. Comme j’étais démissionnaire, je n’étais pas en position de force. J’ai pris une somme ridicule, dont 60 % sont partis illico pour payer mes dettes aux impôts !

JPL. Je suis donc resté. Les rapports n’ont pas toujours été simples, avec les gestionnaires qui avaient provoqué le départ de Marc. En même temps, ils ne voulaient pas faire trop de vagues, et tenaient à la continuité du journal. Ils ont été virés par la suite, quand les Anglais d’Emap, qui avaient rachetés les Éditions Mondiales sont donc arrivés dans le capital de Studio quelque temps plus tard. Mes rapports avec la hiérarchie sont alors devenus plus compliqués, usants même. Les Anglais n’avaient qu’une idée en tête : transformer Studio en Empire (magazine de ciné anglais) et nous mettre sous leur coupe. Le seul problème, c’est qu’ils avaient sous-estimé ma – notre – capacité de résistance, et le soutien indéfectible de nos deux actionnaires historiques, Canal et UGC. A chaque fois que j’ai senti la rédaction – et le journal – en danger, je suis allé voir Lescure, Verrecchia et Sussfeld, et ils ont toujours été de notre côté. Toujours. Le plus terrible, c’était de se dire que toute cette énergie que je mettais dans ces rapports de force, c’était autant en moins que je pouvais mettre dans le journal lui- même. Les Anglais nous ont même déménagés de force à Boulogne, mais grâce au soutien de Canal et d’UGC, nous sommes revenus dans Paris… rue de Berri, quasiment en face des premiers locaux de Première ! Du coup, le départ de Marc, qui était inattendu et nous laissait un peu orphelins, et les relations tendues avec les éditeurs ont resserré davantage encore les liens de l’équipe. Je me suis beaucoup appuyé alors sur Christophe (d’Yvoire), et pour l’organisation et la bonne marche du journal au quotidien sur Sylvie Gonthiez, puis aussi, à partir de 1994, sur Michel (Rebichon), lorsqu’il est rentré de Los Angeles où il avait pris la succession de Christophe en 1992. Christophe, Michel et moi, on fonctionnait un peu en triumvirat. Un directeur de la rédaction et deux red-chef ! On avait des tempéraments très différents mais finalement très complémentaires, et tous les quatre, Sylvie et nous, on était très proches, on travaillait beaucoup mais on n’était pas les derniers à rigoler… Cela a duré comme ça quasiment pendant treize ans après le départ de Marc.

HOLLYWOOD ET L’APRÈS ESPOSITO
Vous aviez un correspondant de Studio à Los Angeles comme vous en aviez eu dès les années 80 à Première…
ME. Oui, ça a démarré à Première avec Henry Béhar. Je trouvais indispensable d’avoir un correspondant permanent à Hollywood, mais Béhar avait préféré aller à New York. Trois ans après le lancement de Studio, on s’est dit qu’il fallait vraiment qu’on ait quelqu’un à Los Angeles. En janvier 90, Christophe d’Yvoire a donc ouvert le bureau de Studio à deux pas de Sunset Boulevard.

JPL. Christophe était parti avec femme et enfants (ils étaient tout petits) et au bout de deux ans, il a eu envie de rentrer en France. Michel l’a remplacé, et… est devenu le grand ami de Sharon Stone ! Ah ah ah ! A son retour, en 94, Laurent Tirard y a fait un bref passage avant de laisser la place à Juliette Michaud, qui avait débuté avec nous comme assistante de Marc. Au bout du compte, c’est elle qui y sera restée le plus longtemps. D’ailleurs elle y est encore, mais plus pour Studio ! Elle a fait un très joli livre, et très drôle, où elle raconte son expérience de correspondante de Studio, genre “Bridget Jones à Hollywood ” que je vous conseille. (Junket, Éditions Press Pocket). Leur présence à Hollywood a permis de faire mieux connaître Studio aux Américains et donc de beaucoup mieux travailler avec eux et de tisser des liens pas aussi forts que ceux qu’on avait en France, mais quand même… On a même pu organiser de vraies séances photos avec certains : Jodie Foster, Bruce Willis, Mel Gibson, Johnny Depp… En plus, Michel a fait partie de la Hollywood Foreign Press, l’association des journalistes étrangers en poste à Hollywood qui décerne les Golden Globes, et cela nous a ouvert davantage de portes encore. Il n’y a pas une star américaine qui lui ait échappé dans ces années-là ! Ah ah ah ! Forcément, après le départ de Marc, un nouveau chapitre de l’histoire de Studio s’est ouvert, d’autant qu’on venait juste de recruter comme pigistes des jeunes mecs passionnés qui ont donc fait à Studio leurs débuts de journalistes et y ont eux aussi à leur tour imprimé leur marque : Laurent Tirard et Thierry Klifa, rejoints quelque temps plus tard par Thierry Chèze (arrivé en 93 comme… stagiaire maquette et qui n’en est jamais parti !). Dès que j’ai pu, je les ai engagés. Et ils ont fait comme nous à Première : ils se sont intéressés aux acteurs et aux réalisateurs qui débutaient comme eux. Et c’est ainsi qu’on a accompagné toute une nouvelle génération de comédiens – Tautou, Cotillard, Cassel, Canet, Bellucci, Kiberlain… – et de metteurs en scène – Klapisch, Kassovitz, Ozon, Audiard… Idem pour les Américains – Brad Pitt, Johnny Depp, Clooney, Tarantino, les Coen, James Gray, Di Caprio, Kidman… Pour ne citer qu’eux. Studio a changé. Les années ont passé. Autour de ses piliers, l’équipe a régulièrement changé de visage. Certains sont partis, d’autres sont arrivés : Patrick Fabre qu’on avait eu comme stagiaire juste avant notre départ de Première, ou Sophie Benamon et Thomas Baurez qui, eux, y sont restés jusqu’au bout. Certains n’ont fait que passer, d’autres étaient des pigistes réguliers, d’autres encore n’ont tenu qu’une rubrique. On a fait débuter de nouveaux photographes aujourd’hui parmi les plus demandés du marché. On a pu aussi faire travailler les plus grands. On a fait appel à des illustrateurs, à des écrivains… Tout en se glissant dans la ligne du journal, tous ont apporté leur passion, leur curiosité, leurs emballements, leurs sensibilités différentes. Cela a forcément enrichi Studio. Et il y avait aussi tous les autres qui travaillaient « dans l’ombre » et que les lecteurs ne connaissaient pas. Mais qui ont été essentiels à la réussite du journal. Les directeurs artistiques qui se sont succédés après Daniel Daage – Thierry Gracia, Jean-Luc Levesque (celui qui est assurément resté le plus longtemps), Joaquim Roncin (à qui l’on devra plus tard le slogan « Je suis Charlie ») – et qui eux aussi ont laissé leur marque en modernisant le look du journal, en y apportant leur regard et leur sensibilité. Et également les maquettistes, les secrétaires de rédaction, Pascaline, Beaudoin, la responsable du service photo, les différentes équipes de la pub et du marketing, Françoise D’Inca, l’assistante de la rédaction devenue une figure du journal… Impossible de les citer tous sinon ça va devenir un Bottin ! Mais si j’insiste, en étant un peu long, pardon, c’est parce que leur implication et leur enthousiasme ont forcément beaucoup compté dans la réussite du journal et aussi parce que ça m’étonne toujours de constater à quel point tous ces gens venus d’horizons vraiment différents, et quel que soit le service où ils travaillaient, ont composé à chaque fois, malgré les départs et les arrivées, une véritable équipe, cohérente et liée par quelque chose que je ne pourrais pas définir mais de bien particulier.
ME. Par l’histoire du journal, et par toi, surtout… Tu es très fédérateur.

« On a beaucoup travaillé, mais on a beaucoup beaucoup ri ensemble. »
JPL. Sans doute les difficultés avec les gestionnaires ont-elles renforcé ces liens, mais on le doit aussi (surtout ?) à cette excitation de faire ce journal-là précisément, à la singularité de cette aventure et de son histoire, et bien sûr à tous ces moments partagés, y compris les galères… Franchement, on a beaucoup travaillé, mais on a beaucoup beaucoup ri ensemble… Cela ne veut pas dire qu’on ne s’est fâchés avec personne, il doit bien y avoir dans Paris des gens qui ont travaillé avec nous et qui nous en veulent ! Mais je suis toujours touché de voir qu’aujourd’hui encore quasiment tous ceux qui sont passés par Studio en gardent un souvenir très fort, sinon comme l’un des plus beaux moments de leur vie, en tout cas comme une période à part, un peu rare… A moins que ce soit seulement la nostalgie de leur jeunesse ! Je sais que le sujet de cette discussion est plus d’évoquer la collaboration entre Marc et moi que de raconter toute l’histoire de Studio jusqu’à mon départ, 13 ans après lui, mais juste quelques mots sur ce chapitre-là de Studio. En plus de ce sens de la proximité et de la fête dont je parlais, Marc nous a laissé autre chose aussi en héritage : le goût des défis. On n’a cessé de les multiplier. D’organiser des rencontres qu’on nous disait impossibles. De vouloir en un mois photographier tous les acteurs français (un des numéros, le 109 en avril 1996, dont je suis le plus fier et où il y a quelques unes des plus belles photos qu’on ait jamais faites et publiées). De demander à Johnny Depp, Jodie Foster, Binoche, Béart, Sean Penn, Brad Pitt, Tom Cruise ou Sophie Marceau d’être rédacteurs en chef. De proposer à Deneuve et De Niro de faire une photo ensemble pour une couve, juste pour annoncer les films évènements de l’année. De convaincre Vincent Cassel et Monica Bellucci, alors qu’ils avaient dit non à tout le monde, de poser ensemble pour notre numéro 200. D’inventer des numéros spéciaux : Un jour dans la vie du cinéma français, les Cent ans du cinéma, Génération 2000, avec des portraits de tous les jeunes acteurs du moment, un Spécial actrices, etc. Nous étions les seuls à faire de tels numéros, ils venaient s’ajouter aux traditionnels Hors Série Bilan de fin d’année, ou aux Spécial Hollywood très complets et très détaillés, initiés dés le début de Studio. Tous ces numéros ont beaucoup compté dans l’image de marque de Studio pendant toutes ces années. Et cela excitait absolument tous les membres de l’équipe, quelle que soit leur fonction ! Je ne suis pas sûr que cela aurait existé de la même manière sans ce qu’avait insufflé Marc au tout début – dont la photo des 177 acteurs est bien sûr le plus bel exemple ! Je suis même sûr du contraire.


ESPOSITO, PARENT, TIRARD ET KLIFA CINÉASTES

Comment ça se passait quand l’un d’entre vous passait de l’autre côté de la barrière, en réalisant un film ? Il y a eu Marc, mais aussi Denis Parent, Laurent Tirard, Thierry Klifa…
JPL. C’est arrivé tard, au début des années 2000. Marc, depuis son départ, on s’y attendait bien sûr, mais je n’avais jamais imaginé que trois autres anciens journalistes de Studio passeraient à la mise en scène… Cela ne nous a pas posé de problèmes particuliers car ils ont tous fait des films qui leur ressemblaient et comme on les aimait, eux, il n’y avait pas de raison qu’on n’aime pas leurs films. En plus, je ne crois pas à l’objectivité en matière de jugement artistique. On regarde un film en fonction de ce qu’on est, de ce qu’on a vécu, de ce qu’on aime, de ce qui nous trouble, de ce qu’on n’aime pas… Comme on aimait leurs films, on les a traités à la fois amicalement et journalistiquement. C’est sûr, on aurait été dans la merde si on les avait détestés ! Pour le film de Denis, Rien que du bonheur, le premier à être sorti, on a organisé un dialogue entre lui et son « héros », Bruno Solo, comme sur un divan, ce qui était dans l’esprit du film. Un peu après, lorsqu’on a vu Le Cœur des hommes, on a été tellement emballés et sûrs qu’on ne serait pas les seuls, qu’on a décidé de faire la couv de Studio avec la photo qui a fait l’affiche du film, mais sans rien dire à Marc. J’adorais l’idée de lui faire cette surprise.
ME. J’ai été scotché que vous ayez osé. Ça m’a bouleversé…
JPL. A la sortie de Mensonges et trahisons, on a fait avec Laurent Tirard ce qu’il a fait avec tant d’autres : une leçon de cinéma. C’est lui en effet qui avait eu l’idée de ce rendez-vous dans le journal et il avait interrogé des tas de metteurs en scène sur leur manière de travailler, de Blier à Woody Allen, en passant par les Coen, Lynch, Cronenberg, John Woo, et plein d’autres. Il a avoué plus tard qu’il avait eu cette idée pour trouver des réponses aux questions que lui-même, qui rêvait de mise en scène, se posait. Plus tard, il les a réunies dans deux livres, dont le premier a d’abord été publié aux États-Unis – personne n’en avait voulu en France !! – avant d’être finalement publié ici. Et il y a aujourd’hui des versions en russe, en espagnol… Pour Une vie à t’attendre, le premier film de Thierry Klifa, on a fait ce qui était évident quand on connaît Thierry et son amour des acteurs : on a mis ses comédiens en avant et on a fait une couve avec Nathalie Baye et Patrick Bruel, deux acteurs qu’on aimait depuis longtemps, depuis Première, et qu’on suivait particulièrement. Tous ces sujets étaient absolument légitimes, et franchement, je n’ai eu aucun problème de conscience. Il n’aurait manqué plus que ça qu’on s’empêche de les faire juste par crainte qu’on nous le reproche.

« Je me fous des avis des critiques, puisque je ne les estime pas. »
Et vous, Marc, comment avez-vous vécu votre relation avec les critiques après votre passage à la réalisation ?
ME. Depuis que je suis passé à la réalisation, je m’interdis d’exprimer tout point de vue sur la critique. Il y a quelques années, Patrice Leconte avait fait un papier contre la critique… Fallait pas, malheureux ! Ils ont le droit d’écrire ce qu’ils veulent ! Moi, j’ai toujours fait comme si je ne les lisais pas. Et depuis mes deux derniers films, je ne fais même plus »comme si », je ne les lis vraiment plus du tout. Je n’ai rien lu sur Le Cœur des hommes 3. Ça ne m’empêche pas de savoir que la critique a globalement été très mauvaise. Il y a toujours des gens qui vous disent : »Ah qu’est-ce qu’il t’a mis, celui-là ! » Je me fous des avis des critiques, puisque je ne les estime pas. Parmi tous les paramètres qui m’ont poussé à arrêter ce métier, il y avait aussi le fait que ça me faisait chier d’être dans le camp des critiques et des journalistes de cinéma. Je trouvais qu’à part mes copains de Studio, les journalistes de cinéma n’étaient pas des mecs terribles, alors que j’avais rencontré des acteurs et des metteurs en scène qui étaient des gens formidables. J’avais envie d’être dans le camp de Blier et Deneuve, et pas dans celui de Gérard Lefort et Pierre Murat. Je m’en suis rendu compte quand je suis devenu cinéaste : tant qu’on n’a pas fait de films, on ne sait pas ce qu’est la mise en scène. Les critiques parlent d’un truc dont ils ignorent tout. On lit parfois, dans des critiques, »mise en scène élégante », eh bien, à chaque fois, vous pouvez être sûrs que les décors sont beaux et les acteurs bien habillés ! Pierre Murat, de Télérama, avait critiqué Le Cœur des hommes 2 en disant qu’il n’était qu’une succession de champs-contrechamps, alors qu’il contient plus de 30 scènes (je le sais, je compte tout !), soit une sur trois environ, filmées et montées en un seul plan-séquence, ce qui est rarissime, non seulement dans le cinéma populaire que je pratique, mais aussi chez les auteurs intellos !
JPL. Marc en effet a toujours été fana des calculs, des tableaux, des statistiques. Et quand il est passé à la mise en scène, il a fait pareil… Avant de faire son premier film, il a étudié, et chronométré, des films entiers, scène par scène…
ME. C’était avant Toute la beauté du monde, quand je croyais que ce serait mon premier film, au milieu des 90’s. J’avais choisi une dizaine de films d’amour – César et Rosalie, Manhattan, Annie Hall, Out of Africa, Kramer contre Kramer… – et j’avais chronométré, annoté toutes les scènes. Je voulais savoir s’il y avait des règles, quel nombre maximum de scènes on pouvait faire, jusqu’à quelle longueur on pouvait aller. J’ai beaucoup appris… Chez Woody Allen, c’est une succession de scènes qui font quasiment toutes la même longueur, entre une minute et une minute trente. Chez Sautet, c’est beaucoup plus varié, alterné, mais aucune scène ne dépasse les trois minutes. Dans mes films, je me suis vite rendu compte qu’à chaque fois qu’une scène dépassait les trois pages de dialogues, je finissais toujours par les raccourcir au montage. Du coup, j’ai arrêté d’écrire des scènes de plus trois pages, je sais que c’est ma limite. Quand vous regardez un film comme Smoke, de Wayne Wang, que j’aime beaucoup, le plan final du monologue d’Harvey Keitel, c’est quasiment huit minutes : c’est un exploit, j’aurais adoré pouvoir faire pareil !
DÉPART DE JEAN-PIERRE
« Cela faisait plusieurs années déjà que je disais que je n’allais pas faire un journal de jeunes jusqu’à 50 ans. »
Jean-Pierre, treize ans après Marc, vous décidez à votre tour de quitter Studio. Comment cela s’est il passé ?
JPL. Un jour de 2003 ou 2004, je ne sais plus, les actionnaires historiques de Studio, Canal et UGC, ont décidé de se recentrer sur leur cœur de métier et de vendre leurs parts. Je n’étais plus assez jeune ni assez naïf pour faire le tour des investisseurs potentiels pour qu’ils nous aident à racheter Studio nous-mêmes. J’en ai quand même vu quelques uns, j’ai rencontré aussi quelques éditeurs, dont Claude Perdriel, le propriétaire du Nouvel Obs avec qui l’affaire a failli se faire, mais très vite j’ai senti que c’était loin d’être gagné et j’ai renoncé. Studio a donc été sur le marché. On me disait qu’Emap (nos actionnaires anglais) allait tout racheter et je pensais que si c’était le cas, vu les rapports conflictuels qu’on avait eus, mes jours étaient comptés. Un après-midi de printemps alors que j’attendais un éditeur qui pouvait être un repreneur potentiel à la terrasse du Café de Flore, je me suis dit pour la première fois qu’une vie après Studio était possible ! Une petite graine venait d’être plantée dans mon cerveau… Et puis, finalement, les Belges de Roularta sont arrivés et ont tout racheté, y compris nos parts, au printemps 2004, chassant les Anglais. Les gens de Roularta craignaient qu’on fasse jouer la clause de conscience et que les principaux responsables du journal s’en aillent à leur arrivée. Ils ne voulaient pas acheter une coquille vide. Ils ont donc mis comme condition au rachat de Studio que non seulement moi, mais aussi les deux rédacteurs en chef – Michel et Christophe – nous nous engagions à rester au moins un an et demi. Or je savais que Christophe avait d’autres projets. Je leur ai dit : »Deux dont moi, c’est déjà pas mal ! » Ils ont accepté. On était d’accord sur leur vision du journal, sur ce qu’ils voulaient en faire… Ils ont fait ce qu’ils avaient promis – même le DVD inclus dans le journal qui était comme une émission de télé idéale sur le cinéma, et qui a été confié à Christophe et Sylvie ! Tout s’est donc bien passé entre Roularta et moi. Mais quand l’échéance de l’année et demie s’est rapprochée, je me suis dit que si je restais, cela voulait dire que je restais à vie… Cela faisait plusieurs années déjà que je disais (au début en riant, après moins !) que je n’allais pas faire un journal de jeunes jusqu’à 50 ans, or je les avais dépassés. Pendant longtemps, on avait fait le journal sans se poser trop de questions, juste comme on le sentait nous, et cela marchait, mais depuis plusieurs années cela devenait de plus en plus compliqué. Je me posais des tas de questions dont je n’avais pas les réponses. Il était temps de passer la main. Donc, deux mois avant l’échéance, je les ai prévenus que j’allais m’en aller. J’avais vu avec Michel, il était d’accord pour me succéder. Ensemble, on a choisi une date qui nous convenait à tous les deux. Cela a été mars 2006. Et pour souligner la continuité du journal, j’ai tenu après mon départ une chronique pendant un an environ. Comme Marc l’avait fait après son départ.
APRÈS STUDIO
Et l’après-Studio, vous l’aviez préparé ?
JPL. Pas du tout ! Le mois le plus bizarre a été celui qui a précédé mon départ. La rédaction avait déménagé à Saint-Ouen, et tous les matins, j’allais au journal en scooter en me disant »Génial, dans un mois, j’aurai changé de vie ! » Et le soir, je rentrais chez moi en me disant : »Tu es sûr ? C’est un journal que tu aimes, un métier que tu aimes, des gens que tu aimes, et tu ne sais pas ce que tu vas faire, ni même ce que tu veux faire ! » Cela a été ça pendant un mois : exalté le matin, déprimé le soir ! J’ai arrêté comme prévu, j’ai fait une petite fête de départ avec toute l’équipe dans un bel endroit, je suis parti aux États-Unis deux ou trois semaines, et à mon retour, la page était tournée ! J’en étais surpris moi-même. Presque un an après mon départ, c’était les 20 ans de Studio. J’ai eu envie de faire un livre de photos, pour marquer l’événement, pour réunir beaucoup de ces moments, de ces visages, de ces rencontres qui avaient marqué l’histoire de Studio, et la nôtre, et la mienne. Je suis très heureux qu’il existe. (Studio la légende du cinéma, Albin Michel). Et très fier de ce qu’il dit de toutes ces années…
Propos recueillis par Sylvain Lefort & Fred Teper
Commander Mémoires d’un enfant du cinéma de Marc Esposito (Editions Robert Laffont) ici
Commander Gérard Oury – Mon père L’as des as de Jean-Pierre Lavoignat & Danièle Thompson ici
A suivre…
Épisode 10 : LE MASQUE ET LA LÉGION D’HONNEUR


STUDIO, LE QUOTIDIEN

En 1991, à Cannes, vous aviez lancé une version quotidienne de Studio…
Jean-Pierre Lavoignat. C’était une bonne idée, mais compliquée. Nous n’avions pas assez de moyens. Imaginez, l’imprimerie était à Nice et… il n’y avait toujours pas Internet ! Le deuxième jour, j’ai compris que je ne pourrais voir aucun film. Cette année-là, j’ai dû en voir deux ou trois ! Je passais mon temps à faire des allers-retours à Nice avec deux secrétaires de rédaction qu’on avait recrutées localement dont une, une fois arrivée à l’imprimerie, s’endormait littéralement sur la table ! Un enfer !
Marc Esposito. C’est la seule fois où on s’est vraiment engueulés, Jean-Pierre et moi – et encore, sans casser de vase ! Ce quotidien, c’est une idée que j’ai imposée à toute l’équipe, qui n’en avait aucune envie. Moi je trouvais très embêtant qu’on n’existe pas pendant le Festival. Notre avis sur les films n’était publié que dans le numéro d’après Cannes qui paraissait fin juin. Pour exister à Cannes de la même manière qu’on existait les onze autres mois de l’année, il fallait faire un quotidien. J’ai pu financer ce projet grâce à Philippe Labro. Je suis allé le voir alors qu’il était le patron de RTL. Il a acheté la dernière page de pub de tous les numéros, cela a suffi à financer tout le quotidien.
JPL. Ce quotidien était compliqué à réaliser, d’un point de vue organisation. Il y a eu des tas de problèmes logistiques qui ne dépendaient pas de nous et qui nous ont dépassés. En plus, malgré tous nos efforts, il n’arrivait pas à Cannes à l’heure et ceux qui s’étaient abonnés avec la promesse de le recevoir le lendemain ont quasiment tout reçu d’un coup après le Festival !
ME. Pour la première fois, toute l’équipe râlait, mais jamais je n’ai pensé que c’était une mauvaise idée, au contraire ce quotidien nous a fait exister très fort à Cannes cette année-là, et j’étais très en colère contre l’équipe ! Jean-Pierre, comme toujours, bossait beaucoup, mais tout le reste de l’équipe renâclait. Ce qui était des vacances était devenu un bagne ! Pour la première fois, ils étaient obligés de travailler tous les jours, les pauvres bichons !
JPL. Des vacances, faut quand même pas exagérer ! Ah ah ah ! Y avait aussi le numéro normal à faire… D’ailleurs, on avait renforcé l’équipe spécialement pour cela. Je me rappelle que parmi les « nouveaux » venus juste pour le Quotidien, il y avait, je ne sais plus qui nous l’avait présenté, Marc Weitzmann, qui est passé ensuite aux Inrocks et est aujourd’hui un écrivain intello et respecté, avec lequel on s’était très bien entendus…
« C’était très grisant d’avoir la liberté qu’on avait. On écrivait ce qu’on avait envie d’écrire… »
ME. Mais même cette année 91, malgré les tensions, je me suis éclaté, j’adorais donner mon avis à chaud, sur tous les films, je faisais des papiers très longs… Comme je m’étais moqué de Jacques Rivette qui était en compète cette année-là, Forestier nous avait appris qu’une pétition circulait pour m’empêcher d’être critique de cinéma ! Ah ah ah ! Il leur avait dit : »Vous êtes fous ? Comment vous allez faire ? Chacun a le droit d’écrire ce qu’il veut ! » Ils ne risquaient pas de m’exclure du Syndicat de la critique, je n’y étais pas ! C’était très grisant d’avoir la liberté qu’on avait. On écrivait ce qu’on avait envie d’écrire, on était nos propres patrons, on n’avait aucune corvée. A Cannes, on habitait quasiment tous ensemble, on y faisait le journal, cette vie n’était possible que parce qu’on s’aimait beaucoup. Dans les autres rédactions, on entendait que les membres de l’équipe se tiraient dans les pattes, ça nous paraissait un autre monde.
JPL. Bien sûr, il y avait de grosses discussions au sein de la rédaction, et parfois même de vraies engueulades. On n’était pas tous d’accord sur tous les films, ni sur le traitement à leur accorder, loin de là ! Mais ça ne durait pas. Le plaisir de travailler ensemble, les liens qu’on avait entre nous et qui ont quasiment été toujours de même nature, alors que, forcément, les équipes ont changé au fil des ans, l’emportaient toujours. C’est même étonnant que cet esprit-là ait toujours perduré malgré la différence des personnalités. Au moins à Studio, quand quelqu’un partait en vacances, il n’avait pas peur de ne pas retrouver sa place à son retour.
ME. Ce qui a empêché les habituelles disputes dans les rédactions, c’est qu’on était deux patrons avec une légitimité que très peu de patrons ont. On avait créé le journal, on était amis depuis longtemps, on avait longtemps travaillé à Première, du coup on pouvait par exemple, sans gêne, s’octroyer les articles qu’on avait envie d’écrire, tout le monde trouvait ça normal. Ils avaient presque tous débuté avec nous, ils avaient appris leur métier avec nous, aucun n’avait envie d’être à notre place, aucun n’avait envie de travailler autant que nous ! Que Jean-Pierre surtout ! Moi je prenais plus de temps pour moi. Parce que pendant toutes ces années, de 85 à 92, je vivais seul avec ma fille, Adèle, et j’étais un père très présent. Mes horaires étaient organisés en fonction d’Adèle. C’est aussi pour elle que je suis de moins en moins parti en reportage, que j’ai arrêté de suivre des acteurs que j’interviewais depuis mes débuts… Jean-Pierre a toujours passé beaucoup plus de temps que moi à la rédaction, il pouvait rester au bureau 18 heures par jour, de 6 heures du matin à minuit !


JPL. Non, non, il faut pas exagérer, j’y arrivais très tôt c’est vrai, mais je ne partais pas si tard… Ce qui est vrai en tout cas, c’est que pour les interviews, on s’est passé les relais. Sur Depardieu, sur Sautet, sur Corneau, sur Bruel, sur Lindon, tu m’as passé la main… Deneuve est un bel exemple. Au début, à Première, c’était toi qui l’interviewais, puis on l’a rencontrée ensemble, puis j’ai été tout seul, puis, plus tard à Studio, j’ai emmené un jour avec moi Thierry Klifa qui l’adorait – c’était pour la sortie de Place Vendôme – puis il a pris le relais… Et aujourd’hui, il en est à son troisième film avec elle ! Pareil pour Fanny Ardant d’ailleurs où il est venu un jour avec moi au rendez-vous, avant de l’interviewer tout seul, et il en est aujourd’hui à sa troisième pièce de théâtre avec elle. C’est une belle histoire, non ?
ME. Le parcours de Jean-Pierre prouve que j’avais raison sur un point qui m’importe. On dit souvent qu’il y a des gens qui sont faits pour être chefs, et d’autres pas. On me l’a sorti quand j’ai engagé Jean-Pierre comme rédac chef adjoint à Première en 1982, puis, onze ans plus tard, quand je lui ai laissé les rênes de Studio. »Jean-Pierre est trop gentil pour être un chef », on me disait. C’est une connerie monumentale. Ce qui compte, c’est la légitimité. Jean-Pierre, ce n’est pas parce qu’il ne gueule jamais qu’il n’est pas un chef.
JPL. J’ai gueulé ! Beaucoup plus que tu ne crois ! Après ton départ… C’est peut-être la fonction qui l’exige !
ME. Tu n’es pas un gueulard, tu le sais bien. Tu n’en as pas besoin. Lui et moi étions légitimes. La légitimité dispense d’actes d’autorité. J’ai pu en faire par faiblesse, par excès de tempérament, mais Jean-Pierre et moi n’étions pas contestés parce qu’on était là les premiers le matin, parce qu’on pouvait faire le travail de quasiment tout le monde, aussi bien, voire mieux ! Quand on a la légitimité, le caractère de chef ou pas, c’est du pipeau. On peut être chef tout en étant gentil, proche des gens, souriant, comme Jean-Pierre l’est, et comme je le suis souvent aussi, mais moi pas toujours ! Après mon départ de Studio, si UGC et Canal ont toujours défendu la rédaction, c’est parce que Jean-Pierre était à sa tête. Rien ne dit que ça se serait passé de la même façon avec moi. Jean-Pierre, partout où il passe, les gens l’apprécient. J’ai toujours pensé que c’était une sorte de chef idéal. Tout le monde rêve d’un chef gentil, qui ne t’engueule pas devant tout le monde. Jean-Pierre écrivait mieux que les autres, il travaillait 14 fois plus, et tout le monde l’aimait, qui allait lui contester sa légitimité ? Après mon départ, je suis sûr que personne ne s’est dit : »Maintenant que l’autre con est parti, je vais pouvoir prendre la place de Jean-Pierre !’
JPL. Ah ah ah ! Arrête, on frôle le procès en béatification !
LIBERTÉ ÉDITORIALE
« Nos lecteurs aimaient nos très longs papiers, il n’y avait aucune raison de se freiner. »
De quelle liberté éditoriale disposiez-vous ?
ME. Totale ! Et puis, on avait l’espace et les pages pour nous exprimer : 80 ou 100 pages par mois, tandis que Forestier, par exemple, n’avait que deux pages par semaine dans L’Express puis dans L’Obs. On aurait pu faire deux ou trois articles de plus par numéro si on avait fait des papiers plus courts, mais on voulait pouvoir faire des sujets longs, on préférait avoir deux ou trois articles de moins. Du temps de Première avec Frimbois, il fallait que les papiers soient courts. Mais Jean-Pierre et moi étions des rédacteurs abondants, donc quand on a été aux manettes, on a fait de plus en plus long, sans se forcer, et ça a marché. Dans le numéro record des ventes de Première avec Christophe Lambert, il y a une interview de lui interminable [In Première 108 Mars 1986 NDLR] ! Nos lecteurs aimaient nos très longs papiers, il n’y avait aucune raison de se freiner. Moi, ça me faisait plaisir d’écrire une critique de huit feuillets sur Danse avec les loups.
JPL. On était chefs, on faisait ce qu’on voulait ! Si j’avais envie d’aller voir Patrice Chéreau répéter dans son théâtre des Amandiers, à Nanterre, j’y allais et je faisais un papier ! On avait des contraintes de pagination, de volume, mais sur le choix des papiers et leur contenu, on avait une liberté totale. Il y avait même des articles qui se terminaient « en tourne », comme on disait, à la fin du journal, où du coup il y avait des pleines pages de texte qui se succédaient. Ce serait totalement impensable dans les journaux d’aujourd’hui.
VENTES
Quelle a été la plus grosse vente de Studio ?
JPL. Le numéro 1 (130 000 exemplaires), le numéro de la photo des 177 acteurs, le premier Spécial Hollywood, les deux ou trois numéros avec Marilyn Monroe en couverture, et notamment celui sur les 100 ans du cinéma. Il y a même eu un numéro d’été, avec des photos inédites de Marilyn que Christophe avait dégotées à Los Angeles, qu’on a dû retirer – cela n’avait été possible que parce qu’il était en vente deux mois…
ME. Il n’y avait pas beaucoup de variations en dehors de ces numéros. Au bout d’un moment, on s’était stabilisés autour de 80 000, pour un journal à 30 francs c’était un succès, mais économiquement, ça restait juste, pour les raisons que j’ai déjà expliquées…
INFLUENCE
« On avait 35 ans, on était perçus comme des wonder boys, et très rock’n roll par rapport au milieu ambiant »
Malgré votre succès et votre influence, comment se fait-il que vous ne vous soyez pas retrouvés dans les cercles officiels du cinéma ?
ME. Ça a toujours été une volonté de ma part. On avait déjà ce pouvoir de donner notre avis dans notre journal, c’était suffisant, je ne voulais pas qu’on soit aussi parmi ceux qui décident qui aura des sous de France 2 ou du CNC, ou qui aura des prix dans tel ou tel festival. Il y a aussi qu’on n’a pas été des courtisans du monde officiel de la Culture, on n’a jamais fréquenté les couloirs du pouvoir, comme a pu le faire un Serge Toubiana, ex boss des Cahiers du cinéma, qui a été ensuite directeur de la Cinémathèque, et qui est maintenant patron d‘Unifrance, après avoir été conseiller du patron de Pathé. Il faut être un homme de réseaux pour faire un parcours pareil. Nous, on n’était dans aucun cercle officiel, aucun de nous n’était au Syndicat de la critique – on était très peu nombreux dans ce cas, ils y étaient tous. On avait 35 ans, on était perçus comme des wonder boys, et très rock’n roll par rapport au milieu ambiant ! Pourtant, on a eu quelques occasions… Par exemple, quand Simone Veil est venue au Festival de Cannes pour donner une conférence sur je ne sais plus quoi, en 88 je pense, c’est à moi qu’on est venu demander de l’accueillir, de mener le débat – je ne sais plus du tout qui avait pensé à moi pour ça, mais j’avais accepté bien sûr. J’ai passé deux heures avec elle, j’étais ravi.
JPL. Il y a eu aussi les premières Fêtes du cinéma à Paris : on nous avait demandé de participer aux réunions avec ceux qui organisaient la Fête. C’est nous qui avions proposé Ran de Kurosawa, pour la projo publique sur la façade de Beaubourg.
ME. Je me souviens, à ces réunions, il y avait Bertrand Delanoë, alors responsable d’une agence de communication, aimable comme une porte de prison !
JPL. Tout cela était dû bien sûr au succès de Première, et aussi à notre proximité notoire avec les artistes de cinéma…
ME. Je voulais qu’on soit un clan à part, qui ne se mélangeait pas avec les autres journalistes. J’ai engueulé des journalistes de Studio quand j’ai appris qu’ils avaient papoté dans une fête avec des journalistes de Libé. C’étaient nos ennemis ! Ils avaient chié sur Dewaere le jour de sa mort, ils chiaient sur tous les réals et tous les acteurs qu’on aimait, je les détestais autant qu’ils me détestaient ! Copiner avec eux, que je critiquais à longueur d’éditos, je le ressentais comme une non solidarité à mon égard, à l’égard du titre, c’était comme un trahison. Là dessus, je suis beaucoup plus raide que Jean-Pierre ! C’est mon côté napolitain ! Jean-Pierre déteste avoir des ennemis, il est beaucoup plus amical que moi, avec beaucoup de gens. Il est aujourd’hui réconcilié avec des personnes avec lesquelles on s’était fâché il y a 30 ans lors du départ de Première, moi je ne leur serre toujours pas la main. Pour moi, quand la ligne rouge a été franchie, c’est fini. Je suis un fervent adepte du proverbe chinois : »Quand quelqu’un t’a enculé une fois, ne lui donne pas l’occasion de t’enculer deux fois ! » Avec Jean-Pierre, on a souvent les mêmes goûts, mais on a deux tempéraments vraiment différents. Si ça avait été l’inverse – des goûts opposés et deux tempéraments identiques – on aurait été potes trois heures !
« On n’a jamais été invités au Masque et la Plume, ni à l’époque Première , ni à celle Studio . »
JPL. Il y a quand même une poignée de gens à qui je ne dis pas bonjour ! Si, si ! C’est vrai qu’on n’a jamais cherché à faire de l’entrisme dans les milieux officiels… On était plus excités à l’idée de nouer avec les acteurs et les réalisateurs des liens, sinon d’amitié, en tout cas d’amitié professionnelle (si bien que lorsqu’on avait une idée d’article ou de rencontre, on les appelait directement), que par celle de fréquenter les officiels. Ils l’ont sans doute compris – et croyez moi, ce n’est absolument pas un regret, juste un constat – puisque ni Marc ni moi n’avons jamais eu la moindre proposition de figurer dans la moindre commission du CNC, ni dans un comité de sélection, alors que plein d’autres y sont sans cesse conviés.
ME. Il y a un autre signe qui en dit long : on n’a jamais été invités au Masque et la Plume, ni à l’époque Première, ni à celle Studio. Il y avait tous les critiques des grands journaux, et des revues de cinéphiles, qui vendaient 124 exemplaires par mois, mais pas nous. On n’était pas dignes du Masque et la Plume ! Ah ah ah !
JPL. Si, Jérôme Garcin m’a proposé de les rejoindre, mais c’était fin 2005, au moment où j’avais pris la décision de quitter Studio. Ça ne tombait pas très bien et … ça venait un peu tard !
ME. 18 ans après la création de Studio ! 29 ans après la création de Première !
JPL. A propos de nos rapports avec les autres journalistes, ma différence avec Marc, c’est que, moi, j’ai continué à être journaliste, et donc pendant plus de quinze ans après son départ, j’ai eu l’occasion forcément de les croiser souvent, de me retrouver avec eux parfois dans les mêmes galères, dans les mêmes émissions de télé, de mieux les connaître… Et puis du temps est passé, l’époque a changé, une nouvelle génération est arrivée, qui avait lu Première ou Studio. En plus, depuis que j’ai quitté Studio – ça fait déjà 13 ans !! – j’ai continué à les fréquenter dans les festivals, dans d’autres circonstances professionnelles, certains ont même fait des articles gentils sur les documentaires que j’ai réalisés avec Christophe (d’Yvoire). Les rapports ne sont plus du même ordre. Mais enfin, il y en a quand même plein auxquels je dis juste bonjour. C’est parfois plus simple de saluer quelqu’un que de se forcer à l’ignorer !
ME. Il y a une autre anecdote qui montre bien à quel point nous sommes différents, et que Jean-Pierre est beaucoup plus sociable que moi. A peu près à la même époque, au milieu des années 2000, nous avons été tous les deux proposés pour être décorés, moi de l’ordre du Mérite, puis un peu après Jean-Pierre des Arts et Lettres. C’est plus chic ! L’ordre du Mérite c’est pour une mère de famille qui a élevé 21 enfants. Ah ah ah ! Mais la différence, c’est que Jean-Pierre a accepté, alors que j’ai refusé.
JPL. Moi, j’avoue que lorsque, début 2007, Marie-Claude Arbaudie, qui était une amie depuis longtemps, qui avait été rédactrice en chef du Film Français, et qui était alors conseillère cinéma auprès du ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres, m’a appelé pour me dire que j’allais être décoré de la médaille de Chevalier des Arts et lettres, et par le ministre lui-même, j’en suis resté bouche bée ! J’étais tellement surpris que je n’ai pas su quoi répondre. Elle était d’ailleurs si contente de me l’annoncer – je pense que l’initiative venait d’elle – qu’elle a dû trouver un peu tiède ma réaction. J’étais bien sûr touché par cette proposition mais sans savoir trop comment réagir. Et puis, le lendemain matin, je me suis dit que s’il y avait quelqu’un à qui cela ferait plaisir, bien plus qu’à moi, c’était mon vieux père – il allait fêter ses 89 ans. Je l’ai appelé, et en effet, il était très content et très fier ! Ma mère était alors très malade, et nous avons organisé avec ma sœur son voyage éclair à Paris pour la cérémonie. Au ministère, il était comme un poisson dans l’eau, n’hésitant pas à aller tailler la bavette avec Renaud Donnedieu de Vabres !! Luc m’avait dit avant « Et tu vas parler de moi dans ton discours ?”. Et je l’avais fait bien sûr. Une sorte de coming out officiel ! Ça n’avait même pas étonné mon père ! Ah ah ah ! Marc était là d’ailleurs, c’était au moment où l’on fêtait les 20 ans de Studio.
ME. Et j’étais ravi d’être là. Et je me suis dit que j’avais bien fait de refuser le Mérite, parce que j’aurais détesté être à ta place. Moi j’avoue que je n’ai pas du tout pensé au plaisir de mes parents, j’ai juste pensé à mon embarras dans cette situation, me faire remettre une médaille dans un palais de la République par le ministre de la Culture de l’époque, Renaud Donnedieu de Vabres, faire un discours, non vraiment, c’était au-dessus de mes forces. Puisque personne ne me mettait un revolver sur la tempe, je préférais m’éviter ça. Ce n’est pas pour des raisons idéologiques, c’est juste à cause de ma pudeur, de ma timidité, ça aurait été une épreuve, vraiment. Évidemment, si ça avait été Michel Rocard ou Simone Veil qui devaient me remettre la médaille, je me serais fait violence. Là, c’était plus facile de refuser. C’était Véronique Cayla, la patronne de l’époque du CNC, à qui j’avais dû serrer la main deux fois dans ma vie, qui m’avait proposé pour cette décoration, à ma grande surprise. Ça m’avait touché bien sûr, et flatté, je ne vais pas prétendre le contraire. J’avais passé des heures à écrire la courte lettre que je lui avais envoyée pour expliquer mon refus…
JPL. Bien sûr, moi aussi, ça m’avait touché et flatté, mais je peux avouer aujourd’hui, je n’en ai jamais parlé à personne, ni même à mon père – Luc a fini par le lui dire – que j’ai quand même refusé la Légion d’Honneur !
ME. C’est dingue ! Et tu ne me l’avais jamais dit ?!
JPL. Non, c’était vraiment too much… C’est Eric Garandeau, alors patron du CNC, qui m’avait proposé. Les Arts et les Lettres, il pouvait y avoir une petite légitimité – et encore ! – mais franchement, la Légion d’Honneur !!! Fallait pas exagérer ! Mon père, ancien militaire, l’a – mais pour avoir réellement risqué sa vie à la guerre. Moi, j’avais fait quoi ? Des journaux de cinéma, des livres et des documentaires !!! Il m’avait fallu des heures aussi pour écrire la lettre expliquant pourquoi je la refusais.
ME. Je suis sur le cul ! Qu’on te l’ait proposée, que tu l’aies refusée, et que tu ne me l’aies pas dit !
JPL. Tu étais à Bali, loin de toutes ces petites histoires parisiennes… Ah ah ah ! Tu aurais été là, ce serait venu naturellement dans la conversation…
Propos recueillis par Sylvain Lefort & Fred Teper
Commander Mémoires d’un enfant du cinéma de Marc Esposito (Editions Robert Laffont) ici
Commander Gérard Oury – Mon père L’as des as de Jean-Pierre Lavoignat & Danièle Thompson ici
A suivre…
Épisode 9 : DUOS DE REALISATEURS POUR 177 ACTEURS


« La photo des acteurs reste, (…) l’un des moments les plus forts de toutes ces années-là. »
ACTEURS/PHOTOS
Venons-en à la photo des 177 acteurs du cinéma français dans le numéro du premier anniversaire de Studio, en février 1988. Qui en a eu l’idée ?
Jean-Pierre Lavoignat. Marc, bien sûr ! Il avait l’idée de cette photo qui réunirait tous les acteurs du cinéma français depuis un certain temps, un peu à l’image des photos que faisaient jadis les studios américains – sauf que pour eux c’était plus facile : les acteurs étaient sous contrat ! Il a même envisagé un moment l’organiser pour le lancement de Studio, il souhaitait que ce soit l’axe du film de pub de lancement. C’était trop compliqué à mettre sur pied, et on n’avait pas assez de temps. Il a relancé l’idée pour le premier anniversaire de Studio, sans être sûrs qu’on arriverait au bout.
Marc Esposito. Il fallait qu’ils soient tous disponibles le même jour à la même heure ! Ça ne pouvait donc être qu’un dimanche. Dès le mois de septembre 87, on a envoyé des lettres aux 20 acteurs les plus importants, en leur proposant des dates, on s’est décidé pour le jour qui avait été le plus souvent choisi. Ensuite, on a envoyé une lettre à tous les autres acteurs, en leur disant : »Le dimanche 10 janvier, à telle heure, à tel endroit, on fait une photo de tous les acteurs français réunis. Nous espérons que vous pourrez être parmi nous. » La bonne idée est venue de Christine Levreau, notre RP. Elle a proposé de monter un partenariat avec les taxis G7, qui appartenaient à Rousselet, le boss de Canal, notre actionnaire, afin qu’il y ait un taxi en bas du domicile de chacun des acteurs le même dimanche matin, à la même heure. Résultat : tous ceux qui avaient dit qu’ils viendraient sont venus, vu qu’un taxi les attendait en bas de chez eux !
JPL. Il y a quand même eu quelques défections de dernière minute : Christophe Lambert qui s’était blessé trois jours avant sur un tournage et était encore à l’hôpital, Sophie Marceau, qui était partie au Japon, Daniel Auteuil, pour je ne sais plus quelle raison…
ME. Ça, moi je m’en souviens ! Il vivait alors avec Emmanuelle Béart, qui avait refusé de venir parce qu’elle n’avait pas digéré je ne sais plus quel petit coup de griffe que j’avais écrit sur elle, et le matin de la photo, pendant qu’il se préparait, elle lui avait fait une scène pour qu’il ne vienne pas ! C’est lui qui te l’a raconté plus tard… Ce qui est drôle, c’est que quand le numéro est paru, Auteuil était l’invité de Drucker dans une émission, Drucker a montré la photo, en lui demandant pourquoi il n’y était pas. Et Auteuil a répondu : »Si si, j’y suis, cherchez bien… » Ah ah ah !

Il n’y a ni Belmondo, ni Delon…
JPL. Belmondo venait de finir les représentations de Kean, qu’il avait joué jusqu’à l’épuisement et il m’avait dit : »Rien au monde ne me fera rester à Paris. Donc, c’est une très bonne idée, mais ne comptez pas sur moi, je n’en peux plus, j’ai besoin de soleil ! » Si Belmondo était venu, c’est sûr que Delon serait venu aussi. Delon nous avait fait téléphoner quelques semaines avant pour nous dire qu’il ne pourrait pas être disponible car il avait un rendez-vous en Allemagne avec des businessmen japonais (!) et qu’il regrettait car c’était une belle idée. Marc m’avait dit : »C’est du pipeau ! » Je ne voulais pas le croire. Le jour de la photo – qui s’était éternisée ! – on débarque, Marc, moi et quatre ou cinq autres de l’équipe, à 3 heures de l’après-midi à la Brasserie de l’Alma, un des restos cinéma de l’époque, pour déjeuner. Je pousse la porte, et qui je vois assis fond de la salle ? Delon ! C’est moi qui ai détourné le regard, tellement j’avais honte… pour lui ! On est restés en froid pendant longtemps après cette histoire. Mais cela ne nous a pas empêchés, des années plus tard (en avril 96), de lui proposer de faire la couverture, avec Olivier Martinez (Delon avait failli jadis faire Le Hussard sur le toit, et Martinez venait de le tourner), d’un Spécial Cinéma français. Il avait été adorable pendant la séance photos. Mais on s’est refâchés dés la sortie du numéro, car il n’a pas apprécié que je lui annonce quelque temps avant la parution qu’on avait décidé, en chemin, de faire deux autres couvs pour ce numéro-événement : Béart et Binoche, alors considérées comme rivales, et la bande du Splendid réunie pour la première fois sur la même photo depuis une éternité. Et puis on s’est réconciliés à nouveau sur le tournage du Leconte, Une chance sur deux... Ensuite, on a enfin eu des rapports normaux. Et il a été très coopératif et très amical quand je me suis occupé de l’expo Romy Schneider. La photo des acteurs reste, pour moi, et je suis sûr que c’est pareil pour Marc, l’un des moments les plus forts de toutes ces années-là. 177 acteurs avaient donc répondu présents En plus, ce qui était génial, c’est qu’ils étaient très heureux d’être là. Ils ne voulaient plus partir ! Après la photo, ils étaient restés longtemps à papoter autour du buffet. Ils étaient détendus parce qu’ils étaient venus juste pour une photo : pas de remise de prix, pas de projo, pas de promo, juste une photo de famille… Il y a eu des moments magnifiques : Bernadette Lafont s’est précipitée sur Jean Marais pour lui dire qu’elle l’aimait depuis toujours, Noiret a déclaré la même chose à Denise Grey. Et Girardot… Elle nous avait d’abord dit non, elle nous avait même raccroché au nez quand on l’avait appelée pour la relancer ! Marc et moi lui avions écrit une lettre…
ME. … c’est dingue, le nombre de lettres qu’on a écrites pendant toutes ces années !
JPL. …pour lui dire à quel point elle nous avait fait aimer le cinéma quand on l’avait vue dans ses films des années 60-70. Elle est finalement venue, et est restée longtemps après à bavarder avec les uns et les autres. En partant, elle m’a dit : »Vous avez bien fait d’insister. Je croyais que le cinéma français ne m’aimait plus. J’ai eu la preuve du contraire. » Comme aux César quelques années plus tard, les pleurs en moins. Anouk Aimée, elle, ne répondait pas à nos lettres. Tous les deux, on l’a invitée à déjeuner au Prince de Galles, on lui a fait un énorme numéro de charme…
ME. Surtout toi ! Ah ah ah !

JPL. Elle nous a promis de venir. Et… elle n’est pas venue ! Charlotte Rampling nous avait dit oui. Mais le jour J, le taxi nous a appelés pour nous dire qu’il n’y avait personne devant son domicile. On lui a alors laissé un message sur son répondeur, elle n’a pas décroché mais elle est venue. Micheline Presle est arrivée la dernière car elle avait voulu venir avec sa propre voiture et s’était perdue ! Quand Deneuve est arrivée, je suis allé l’accueillir, et elle m’a demandé : »Philippe est là ? Et Yves ? Et Gérard ? – Ils sont là tous les trois. » Noiret, Montand et Depardieu étaient là, elle était rassurée, elle n’était pas la seule star… On avait passé des nuits à faire « le plan de table », en tenant compte de tas de paramètres : les jeunes, les vieux, les stars, les pas stars, les hommes, les femmes, ceux qui avaient eu une histoire entre eux, ceux qui ne s’aimaient pas…

ME. C’était compliqué parce que, sur des gradins, ceux du premier rang en bas étaient beaucoup plus en évidence que ceux qui étaient tout en haut. On leur avait demandé d’être tous habillés en noir. Sous le noir, seul le blanc était accepté pour les chemises, écharpes, tee shirts. Ils avaient tous joué le jeu. Personne n’est arrivé avec une chemise rouge, en disant : »Désolé, j’ai oublié… »
JPL. A l’entrée du studio, on avait affiché le plan, avec tous les noms dans les cases, c’est comme ça qu’ils ont découvert où ils étaient placés, à côté de qui on les avait mis.

ME. J’avais continué de bosser sur ce plan toute la nuit, j’étais venu au studio sans avoir dormi, direct du bureau !
JPL. Je me souviens, Montand m’avait dit : »J’ai vu que je suis au cinquième rang. Qui tu as mis au premier, petit ? » Je lui ai dit : »Jean Marais, Charlotte Gainsbourg, Bernard Blier, Bernadette Lafont, Denise Grey, Christophe Malavoy, Thierry Frémont… » Il a compris qu’on n’avait pas fait un placement « hiérarchique », et il n’a fait aucun commentaire. L’idée qui a résolu tous les problèmes, c’est que comme tout le monde savait qu’on était très amis avec Depardieu, qui était au top, on l’avait placé très haut, donc très mal. Du coup, personne ne pouvait se plaindre.
ME. Ce qui est génial, surtout, c’est qu’on ait pu faire ce coup-là à Depardieu, sans qu’il le prenne mal. Beaucoup, à sa place, auraient mal réagi : »Quoi ? Je suis pote avec les boss, et ils me placent comme une merde ?! »
JPL. A l’époque, il tournait Camille Claudel. Il a la tête de Rodin sur la photo. Le lendemain de la photo, il a engueulé Adjani parce qu’elle n’était pas venue, qu’elle s’était privée d’un moment incroyable, que c’était un truc unique. Il y en a même d’autres qu’on n’avait pas invités, qui nous avaient appelés pour en être, on n’avait pas osé leur dire non.


RENCONTRES CINÉASTES
Pour Studio, vous organisiez des rencontres entre des cinéastes. Comment les organisiez-vous ? En fonction des affinités qu’avaient les réalisateurs les uns avec les autres ?
JPL. Des fois oui, des fois non. Il est sûr que faire se rencontrer Scorsese et Tavernier pour le n° 1, ce n’était pas le plus compliqué. Ils se connaissaient et s’appréciaient. Idem pour la rencontre Corneau-Eastwood au moment de Bird. Corneau était tellement généreux, il aimait le cinéma des autres, ce qui n’est pas le cas de tous les cinéastes, loin de là ! De fait, on l’a beaucoup mis à contribution ensuite : avec Jean-Jacques Annaud, avec Beineix et Zulawski, avec Stephen Frears, avec Tavernier. Une des rencontres qui m’a le plus marqué, c’est celle de George Miller et George Lucas. Cette année-là (1988), Miller est membre du jury à Cannes et Lucas y présente sa dernière production, Willow. Tout le monde nous dit : »Vous rêvez, vous ne les aurez pas ! ». En plus, ils ne se connaissaient pas. J’insiste. Finalement, leurs attachés de presse françaises nous ont soutenus et ont obtenu un OK pour 45/50 minutes d’entretien. On les rejoint, Christophe (d’Yvoire) et moi, à l’Hôtel du Cap. Au bout de 30 minutes, c’est comme si on n’était plus là. Ils parlent entre eux, comparent les mythes, évoquent les ouvrages de Joseph Campbell, le grand spécialiste américain de la mythologie. Leur dialogue a quasiment duré trois heures !

Pourquoi ces rencontres se sont-elles arrêtées ?
JPL. Parce qu’on a épuisé un peu nos idées et aussi parce qu’on a eu de plus en plus de mal à trouver des metteurs en scène prêts à jouer le jeu.
ME. Bruno Dumont – Pascale Ferran, ça fait moins rêver ! Il y avait beaucoup de grands metteurs en scène à l’époque, ce qui n’est plus le cas.
Vous avez fait dialoguer Sautet avec Blier, Woody Allen avec Agnès Jaoui, Scorsese avec Kurosawa, Louis Malle avec Kieslowski, Coppola avec Lucas, Sidney Lumet avec Chouraqui, Tarantino avec Tony Scott, Sidney Pollack avec Lelouch…
ME. Tout ça, c’est Jean-Pierre. On n’aurait jamais essayé de faire cette série d’entretiens si Jean-Pierre n’avait pas été là, c’était pile un truc pour lui, il avait les deux qualités nécessaires pour y arriver : il est tenace, et tout le monde l’adore !

JPL. En tout cas, c’était une idée à toi ! Scorsese-Kurosawa, ce n’était pas une interview de promo, mais presque. Ils étaient à Cannes ensemble pour la projection de Dreams, le film de Kurosawa dans lequel Scorsese, qui l’avait produit avec Lucas et Spielberg, jouait Van Gogh. C’était très frustrant, car Kurosawa ne parlait pas anglais, et Scorsese pas japonais. La traduction dans chacune des langues prenait un temps infini. Pour une heure d’entretien, on a eu 20 minutes de contenu. Mais ils ne l’ont fait que chez nous. Une rencontre qui a compté, parce qu’il est rigolo de jouer les instruments du destin, même si c’est vaniteux de dire ça, c’est celle de Brian De Palma avec Régis Wargnier au Festival de Deauville 1987. On avait d’abord proposé à Susan Seidelman, la réalisatrice de Recherche Susan désespérément, de le rencontrer. Elle s’était désistée deux jours avant. Il se trouve que j’avais croisé peu de temps auparavant Régis Wargnier, tout juste sorti du succès de La Femme de ma vie, et qu’il m’avait dit qu’il adorait De Palma. J’appelle donc Wargnier en catastrophe pour lui proposer de venir avec moi à Deauville le lendemain. Il accepte. Après la projection des Incorruptibles, vient le moment de l’interview. Il faut savoir qu’à l’époque, De Palma a une réputation terrifiante, notamment auprès des journalistes qu’il traite très mal. On lui présente Wargnier, il écoute d’une oreille distraite et dès les premières questions, il est odieux avec lui. Au bout d’un quart d’heure, Wargnier s’énerve et lui dit : »Vous n’avez pas le droit de me parler comme ça. Je suis cinéaste, j’aime votre travail, et je peux vous dire pourquoi et comment, dans votre film, vous avez fait tel ou tel plan ! » De Palma en est resté scotché ! Il est devenu tout miel et ne l’a plus quitté jusqu’au dimanche soir. Et ils sont devenus très amis. Ils sont même arrivés un soir bras dessus bras dessous à une fête de Studio ! De Palma a ensuite demandé à Wargnier de s’occuper d’une partie du casting des actrices pour Mission Impossible – et c’est Emmanuelle Béart qui a eu le rôle. Wargnier a présenté Patrick Doyle à De Palma qui lui a commandé la musique de L’Impasse... Et Wargnier a joué son propre rôle, le temps d’une scène avec Sandrine Bonnaire, dans Femme Fatale que De Palma a tourné à Cannes. Sans Studio, cela n’aurait sans doute pas existé. Il y a eu deux ou trois histoires du même ordre. Par exemple, c’est en voyant une photo de Binoche dans Studio que Kieslowski a eu envie de lui proposer Bleu. Pareil pour Vincent Perez : Nadine Trintignant a vu une photo de lui dans Studio et lui a proposé La Maison de Jade, sur lequel il a rencontré Jacqueline Bisset avec qui il est resté plusieurs années.
Autre rencontre qui a dû être mémorable : Godard-Balasko…
JPL. C’était inattendu et passionnant. Godard venait de faire Soigne ta droite, avec des acteurs qui n’avaient pas l’habitude d’être chez lui : Birkin, Lavanant, Villeret, Galabru, etc. Et Balasko venait de réaliser son deuxième film, Les Keufs, dans lequel elle avait donné un très beau rôle, celui d’un commissaire névrosé, à Jean-Pierre Léaud. C’est de là qu’est née l’idée de cette rencontre. Et Godard avait joué le jeu de manière incroyable, s’amusant même à faire le clown avec son écharpe. On n’était pas fous de cette période-là de Godard, mais il y avait quand même quelques films qu’on avait aimés : Sauve qui peut la vie, Passion… On avait même fait la couv de Première avec Johnny sur le tournage de Détective, avec Nathalie Baye et Claude Brasseur…
ME. Johnny ! Mon idole ! J’ai adoré l’après-midi que j’ai passée avec lui pour cette interview. Il s’était montré intelligent, subtil, très cinéphile, très pointu, tout comme j’étais sûr qu’il était.

JPL. J’ai toujours eu aussi beaucoup d’affection pour lui. Et sa passion pour le cinéma était vraiment touchante. L’un de mes plus beaux souvenirs avec Johnny, c’est lorsque je suis allé à Vienne avec Luc sur le tournage du Neveu de Beethoven, de Paul Morissey, le complice d’Andy Warhol (que j’avais trouvé, à ma grande surprise, réac à mort !) dans lequel tournaient Jane Birkin et Nathalie Baye. A l’époque, Johnny était donc avec Nathalie Baye et était venu passer le week-end sur le plateau. Ils avaient même accepté qu’on fasse une photo d’eux ensemble sur le plateau, lui en jean et blouson, elle en crinoline, et on l’avait publiée. Luc et moi, on devait rentrer le dimanche soir et il nous a demandé de repousser notre retour au lundi matin pour ne pas faire le voyage tout seul. On s’est donc retrouvés le lundi matin tous les trois à l’aéroport de Vienne. Je lui demande ce qu’il prépare. »Un album avec Michel Berger. » Et là, il sort de la poche de son blouson une feuille avec un texte écrit au crayon à papier et il commence à chanter : »Y a des flat cases qui traînent sur scène… » Les premiers mots de ce qui allait être Le Chanteur abandonné ! Et il nous a chanté la chanson en entier. En avant-avant-première, juste pour Luc et moi !
ME. J’en suis malade, d’avoir raté ça. En même temps, tant mieux : j’aurais chialé comme un abruti !
JPL. En plus, dans l’avion, il y avait Rudolph Noureev qui est venu parler avec lui. Tout cela me paraissait totalement irréel… Quant à Godard, on a retravaillé avec lui plusieurs fois ensuite. Notamment pour le numéro des 100 ans du cinéma, en mars 95.
« La rencontre avec Spielberg a été simple et passionnante comme toujours. La rencontre avec Godard a été un moment rare. »

Comment cela s’est-il passé ?
JPL. On avait décidé qu’il n’y aurait que deux très très longues interviews : Spielberg et Godard. Les deux opposés sur la carte du cinéma ! Les deux ont dit oui. J’ai donc interviewé Spielberg à Los Angeles avec Michel (Rebichon) qui était à l’époque le correspondant de Studio à Hollywood. Et Godard avec Christophe (d’Yvoire) à Rolle, en Suisse. Les privilèges du chef ! Ah ah ah ! La rencontre avec Spielberg a été simple et passionnante comme toujours. La rencontre avec Godard a été un moment rare. Il était brillant et attachant, il ne voulait plus nous laisser partir, il a changé lui-même notre billet de train pour qu’on prenne le dernier, et nous a fait visiter sa caverne d’apprenti sorcier avec tous ses ordinateurs sur lesquels il inventait ses Histoire(s) du cinéma, il a insisté pour un dernier verre au café en bas. Il avait l’air seul. Il le disait d’ailleurs. C’était touchant. Aujourd’hui, quand j’entends parler de Godard, c’est à cette après-midi là que je pense toujours. Et à son sourire enfantin et désarmant. Deux ans ou trois ans plus tard, quand Les Cahiers du cinéma ont publié Godard par Godard où étaient réunis ses « grands entretiens », ils nous ont appelés pour nous dire que Godard avait souhaité que cette interview y figure et ils nous demandaient l’autorisation de la publier. J’imagine leurs têtes quand Godard le leur a demandé !
ME. J’ignorais cette histoire, elle est magnifique !
JPL. Il nous est arrivé d’élargir ce principe des rencontres et de ne plus faire discuter ensemble deux metteurs en scène mais deux personnalités qu’on aimait. Juste pour notre plaisir, et… le leur ! Spike Lee nous avait dit qu’il aimerait rencontrer Béatrice Dalle, on a monté la rencontre. On savait Patrick Bruel fou du Cercle des poètes disparus, on lui a demandé d’interviewer Peter Weir pour nous… Caro et Jeunet étaient des fans absolus de Terry Gilliam, on a organisé leur dialogue. J’adorais les romans de Modiano et j’aimais beaucoup Jean-Marc Roberts, que j’avais rencontré à Première sur les tournages de Pierre Granier-Deferre dont il était le scénariste fidèle. La parution simultanée de deux de leurs livres a été l’occasion de les faire parler ensemble de cinéma juste pour nous. Un bonheur… C’était l’avantage de faire un journal où l’on décidait, seuls, ce qu’on allait y mettre. On en profitait pour rencontrer les gens qu’on aimait, même hors cinéma. Mais ce n’était pas valable que pour Marc et moi. Les autres aussi y trouvaient leur compte. Ne serait-ce que dans la rubrique « Invité » où des personnalités diverses parlaient de cinéma. Denis (Parent) a ainsi pu interviewer Alberto Moravia, Philippe Djian et Peter Gabriel, Michel (Rebichon), Rudoph Noureev, David Hockney, et… Boy George ! On pourrait continuer longtemps cette liste mais je ne vais pas vous faire le sommaire des sommaires !
SUR LE DIVAN
Dans les premiers Studio, il y a la rubrique Divan. Comment est-elle née ? Pourquoi ?
ME. On voulait faire une série d’interviews d’acteurs ou réalisateurs menées par un psychanalyste cinéphile. Mais on ne trouvait pas cette perle rare… Jean-Pierre me dit alors connaître une certaine Joëlle de Gravelaine, qui est certes astrologue mais qui est aussi une grande spécialiste, et éditrice, de sciences humaines, et que ça pourrait être intéressant de faire ces interviews avec elle, à partir de leur thème astral. A l’époque, je n’étais pas du tout branché astrologie, mais comme Jean-Pierre est mon ami, je lui ai fait confiance, on a tenté le coup, et j’ai bien fait, ses interviews avec Joëlle de Gravelaine étaient très intéressantes, originales, profondes… Moi je n’en ai fait que deux avec Joëlle : Depardieu et Huppert. La première, avec Huppert, j’avais laissé Joëlle dérouler tout son thème astral sans l’interrompre, et à la fin, Huppert lui a dit : »Il m’a fallu 10 ans de psychanalyse pour savoir tout ce que vous venez de me dire. » Là, j’ai été sûr que Jean-Pierre avait eu une bonne idée. Car Huppert, a priori, n’était pas la meilleure cliente pour une interview sur des bases d’astrologie.


JPL. Joëlle n’était pas vraiment cinéphile, elle ne connaissait pas bien les acteurs, mais elle les aimait. Elle arrivait »neutre », sans a priori cinéphile, c’était parfait. Joëlle mettait le doigt sur des trucs personnels, mais sans entrer dans l’intimité. Dans la rédaction du papier, on gommait au maximum toutes les références à l’astrologie. Cette rubrique, qu’on a appelée Divan, avant qu’Henri Chapier ne fasse son émission à la télé, n’a pu exister que parce qu’on avait fait Première avant. Si on n’avait pas créé des rapports de confiance avec les acteurs, je ne pense pas qu’ils auraient accepté de se prêter aussi facilement au jeu d’une interview à partir de leur thème astral. Le premier qui a accepté d’essuyer les plâtres pour le numéro 1, c’est Bernard Giraudeau avec qui on avait de très bons rapports, parce qu’on l’aimait depuis le début – on a sans doute été parmi les premiers à l’époque de Première à lui consacrer une couverture. En même temps, Giraudeau adorait les défis… Pour ceux à qui on a proposé ensuite de s’allonger sur notre Divan, c’était plus simple, ils pouvaient voir ce que ça donnait dans le journal. Comme c’était nous, comme c’était pour Studio, même ceux qui étaient très réticents, comme Michel Blanc par exemple, étaient partants. Ils ont tous dit oui. Depardieu et Huppert donc, mais aussi Deneuve, Bertolucci, Jeanne Moreau, John Malkovich, Serrault, Wim Wenders, Lelouch, Fellini… Joëlle m’avait d’ailleurs raconté que Fellini l’avait appelée plusieurs fois ensuite pour la consulter.
ME. Beaucoup d’acteurs et d’actrices vont voir des voyantes. Leur métier dépend du téléphone qui sonne, certains attendent des réponses depuis des mois.
« Un dossier sur le prix des acteurs (…), qu’on a été les premiers à faire (…) nous a valu deux ou trois lettres d’insultes de comédiens. »
JPL. On avait dès le lancement de Studio voulu imposer de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rubriques. Il y avait le Divan, mais aussi le Portfolio d’un grand photographe de cinéma, et les sujets « Mémoire » où on parlait des stars du passé, parfois en ayant la chance de les rencontrer quand ils étaient encore vivants, en ressortant leurs plus belles photos. J’ai même interviewé Arletty ! Tout cela a été dés le début la marque de fabrique de Studio. Et on ne cessait de chercher de nouvelles idées. D’autant que Marc n’aime pas la routine, ni les choses trop bien installées. Il avait toujours besoin de se, de nous remettre en question. On a ainsi organisé plusieurs séminaires de réflexion d’où sont nés des rendez-vous qui sont vite devenus incontournables. Un dossier sur le prix des acteurs, par exemple, qu’on a été les premiers à faire et qui nous a valu deux ou trois lettres d’insultes de comédiens. Ou une rubrique comme « La Terre tourne », où l’on suivait les films, de l’annonce du projet jusqu’à leur sortie, et qui est vite devenue un must du journal. Gilles Jacob m’avait même dit qu’elle lui était très utile pour surveiller la progression des films « cannables ». Bien sûr de se retrouver tous ensemble dans les toboggans aquatiques de Center Park où se déroulaient ces séminaires resserrait l’équipe davantage encore ! Ah ah ah !

Il y avait la chronique d’Alain Chabat et Dominique Farrugia, alias Bidibi et Banban, qui clôturait le journal…
ME. C’étaient des potes depuis leurs débuts, on avait plein d’amis communs, on faisait la fête à Cannes ensemble, je croisais souvent Dominique aux Bains douches, qui était ma troisième maison ! J’aimais l’idée que l’image de Studio soit associée à leur humour, à leurs personnages, à leur façon d’aimer le cinéma et d’en faire.
JPL. Il y a eu deux époques. Une première qu’ils ont arrêtée au bout d’un an et demi. Et puis, sous la pression de Marc, ils sont revenus.

ME. Ces pleutres n’avaient pas osé me dire qu’ils voulaient arrêter, je l’ai découvert en lisant leur dernière chronique ! Je l’avais mal pris ! Après plusieurs mois de silence, je les ai invités à déjeuner au Prince de Galles, et je leur ai dit, très sérieusement, comme dans Le Parrain : »Je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser… » Ils se sont marrés ! Et ils sont revenus !
C’était quoi, la proposition ?
ME. Je leur ai dit : »Ok, vous êtes devenus des stars, la pige qu’on vous versait est devenue ridicule, et on ne peut pas vous payer plus. Mais on peut vous offrir à la fin de l’année chacun une belle voiture, pour nous c’est juste des pages de pub… » Ils sont donc revenus, les voyous ! Mais j’ai démissionné de Studio quelques mois plus tard, et ils n’ont jamais eu de voiture, ah ah ah !

JPL. Les temps avaient changé, les gestionnaires n’ont pas voulu que je tienne la promesse de Marc, et j’ai trouvé avec eux un autre arrangement, mais franchement je ne sais plus lequel… Malgré ça, et malgré leurs nombreuses activités, ils ont quand même tenu deux ans et demi. Lorsque Chabat et Farrugia débarquaient au bureau pour terminer (ou écrire !) leur chronique, c’était comme un ouragan qui anéantissait d’un coup tension et mauvaise humeur ! Le rire en cascades de Farrugia résonnait dans tout le journal… Difficile d’y résister ! D’ailleurs ils étaient irrésistibles, et on ne pouvait, on ne peut, qu’avoir de la tendresse pour eux. Quelques années plus tard, en 2002, on a voulu retrouver cet humour décalé et on a alors fait appel à leurs protégés, Les Robins des Bois qui, eux, composaient une sorte de lettre sous forme de patchwork où il y avait même des objets collés ! Je me souviens d’un pot de yaourt renversé, surmonté d’un petit drapeau français censé être le Fort Saganne ! Du coup, on était obligés de photographier leur page. Une véritable œuvre d’art brut ! Eux aussi ont tenu deux ans, puis ont chacun mené leur route ensuite.
Daniel Toscan du Plantier aussi a tenu une chronique, au début. Pas longtemps…
ME. Deux ou trois mois, si ma mémoire est bonne. On l’aimait bien, et on était ravis de sa chronique, mais ça a donné au Figaro l’idée de faire la même chose, et un jour, on a vu une chronique de Toscan dans Le Figaro Magazine, écrite dans le même esprit, parlant des mêmes choses. On était très en colère ! Le Fig Mag, à l’époque, puait grave, ils avaient une attitude très réac sur le sida, ils parlaient de ceux qui avaient le sida en disant les »sidaïques » ! Je l’ai appelé, pour lui dire que les deux magazines n’étaient pas compatibles, il m’a fait une réponse-pirouette à la Toscan, on a attendu la semaine d’après, il était toujours dans Le Fig Mag, alors je lui ai fait une lettre, pour lui dire que c’était fini avec Studio. Quelques mois plus tard, je tombe sur lui dans un cocktail, je vais le saluer, et il me présente aux gens qui étaient avec lui : »C’est lui qui m’a viré de Studio ! », et il s’est marré. On l’aimait beaucoup.
JPL. Toscan a toujours été bienveillant avec nous. Il faut dire qu’on aimait les mêmes gens : Depardieu, Huppert, Pialat… Des années plus tard, il se trouve que comme je suis très ami avec Mélita, elle m’a demandé d’être, avec Fanny Ardant, son témoin à son mariage avec Toscan. J’ai une très belle photo de Fanny Ardant et moi signant le registre à la mairie, on dirait que, nous aussi, on est en train de se marier ! On avait décidé de leur acheter un olivier comme cadeau de mariage. Quelque temps plus tard, je fais une interview d’elle et ensuite, pour la remercier, je lui envoie un petit mot avec un livre, sûr qu’elle allait l’aimer, mais pas sûr du tout qu’elle ne l’avait pas lu. Elle l’avait lu et m’avait répondu avec cette belle écriture penchée qui semble être celle d’un écrivain romantique : »C’est normal que nous aimions les mêmes livres puisque nous sommes attachés au même arbre. »
Propos recueillis par Sylvain Lefort & Fred Teper
Commander Mémoires d’un enfant du cinéma de Marc Esposito (Editions Robert Laffont) ici
Commander Gérard Oury – Mon père L’as des as de Jean-Pierre Lavoignat & Danièle Thompson ici
A suivre…
Épisode 8 : STUDIO : L’AVENTURE, C’EST L’AVENTURE


NAISSANCE
« Nous voulions intéresser ceux qui trouvaient que Première était un journal trop teen-ager… »
Studio est conçu au départ pour fonctionner en synergie avec Première, mais en quoi leurs concepts étaient-ils différents ?
Marc Esposito. Le fait d’avoir été lourdés de Première nous a obligés à modifier le concept initial de Studio. Par exemple, il ne devait pas y avoir de critiques dans Studio. Quand c’était la même équipe qui devait faire les deux journaux, il était inutile de publier nos avis dans les deux journaux, nos critiques seraient restées à Première, plus branché sur l’actualité immédiate que Studio ne devait l’être. A partir du moment où on ne pouvait plus donner notre avis sur les films dans Première, il fallait qu’on le donne dans Studio, donc on a mis des critiques dans Studio. L’idée était de faire un beau magazine, luxueux, avec un dos carré et un très beau papier, un peu plus tourné vers le passé que Première, avec des interviews plus longues et des articles plus haut de gamme. Nous voulions intéresser ceux qui trouvaient que Première était un journal trop teen-ager. Surtout, on s’était aperçus, pendant toutes ces années à Première, qu’il y avait une mine d’or iconographique jamais utilisée, sur un siècle de cinéma : Marilyn, Bogart, Rita Hayworth, Gabin, Bardot, Liz Taylor…
Jean-Pierre Lavoignat. Première était devenu une sorte de news du cinéma, très puissant, qui vendait régulièrement entre 300 et 400 000 exemplaires. C’était un peu un TGV qui avançait tout seul, même si nous y consacrions beaucoup de temps et d’énergie. Je crois que Marc rêvait de retrouver la fièvre de son retour à Première, l’excitation d’inventer une nouvelle fois un journal qui n’existait pas, le plaisir du défi et du risque. Et puis aussi, il se disait que les lecteurs de Première qui nous suivaient depuis le début vieillissaient et que, comme leurs habitudes de cinéma allaient changer, ils allaient certainement abandonner Première. L’idée de Marc avec Studio était donc de garder ces lecteurs en leur proposant un magazine plus beau, plus adulte. Une sorte de Vogue du cinéma. Marc a proposé le concept à Filipacchi qui lui a dit qu’il n’y croyait pas, qu’il n’y avait pas de place pour deux journaux de cinéma. Marc lui a alors demandé l’autorisation d’aller chercher le financement du journal en dehors du groupe, Hachette restant bien sûr prestataire de service. Filipacchi a accepté. Se doutant bien que Marc rêvait de nouveaux projets, il lui avait d’ailleurs demandé quelques temps auparavant de relancer L’Hebdo des Savanes, ex Echo des Savanes, transformé en Hebdo cinéma ! Et Marc a relevé le défi.
ME. Forcément, un hebdo, c’était excitant !



JPL. L’Hebdo Cinéma est né en janvier 1985. Ils n’ont même pas joué le jeu, et au bout de dix semaines, ils ont arrêté L’Hebdo, dont Marc avait confié la rédaction en chef à Michel (Rebichon). Pourtant, les ventes progressaient doucement. Marc qui avait déjà l’idée de Studio et n’a pas chômé : de démarche en rendez-vous, il a réussi à trouver le financement de Studio auprès de Canal + et d’UGC – notamment grâce à une fille dynamique et formidable, Corinne Rougé, qui est devenue directrice de la pub de Studio et l’est restée pendant dix ans. Et, sur les conseils de Daniel Toscan du Plantier, qui connaissait le milieu mieux que personne, on a demandé, et obtenu, de l’IFCIC (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles) un prêt garanti par l’État. On avait aussi proposé à ceux qui le voulaient, dans la rédaction de Première, d’être actionnaires de ce nouveau journal.
ME. Ça s’appelait la Société des Fondateurs de Studio, dont j’avais 37 %, le reste étant détenu par une douzaine de membres de la rédaction, plus Toscan et Denisot (qui avait été notre go-between dans les discussions avec Canal) qui avaient mis un petit billet pour avoir 2 %. Cette Société des Fondateurs avait 45 % de Studio SA, qui éditait Studio…
JPL. …et dont Marc était le PDG ! Je me souviens, l’un des premiers conseils d’administration de Studio, est arrivé très vite après qu’on ait été virés de Première et que nos potes aient démissionné. Il y avait André Rousselet et Pierre Lescure, les boss de Canal, Guy Verrecchia et Alain Sussfeld, les boss d’UGC, Marc et moi, et une ou deux autres personnes je ne sais plus qui… On leur a raconté notre licenciement, qu’ils connaissaient – il y avait même eu un papier sur le sujet dans Libé, titré : « Première perd ses stars » ! Et lorsqu’on a évoqué le cas des démissionnaires, André Rousselet a dit aux autres actionnaires : »C’est une trop belle histoire, on engage tout le monde, si vous êtes d’accord. » Tout le monde a été d’accord.

ME. Rousselet était un mec top, un seigneur. Mais Lescure, Verrecchia et Sussfeld ont été top aussi. Jamais aucun n’a passé un coup de fil pour nous demander une faveur ou se plaindre d’une critique. Toujours est-il que grâce à leur accord d’engager les démissionnaires de Première, on s’est retrouvés avec une quinzaine de salariés. Dix de plus que prévu dans le budget. Pour un journal qui démarre, c’était énorme, ça augmentait les risques. Mais ça rendait l’aventure encore plus singulière. Le pire de l’histoire, c’est qu’on a perdu notre procès contre Filipacchi qu’on avait attaqué pour licenciement abusif et qui a prétendu qu’il n’était au courant de rien au sujet de Studio, qu’on avait tout fait en douce.
JPL. Mais le plus honteux, c’est qu’ils nous ont fait un procès pour concurrence déloyale ! Genre »Dans Studio, il y a des critiques de cinéma comme dans Première, des filmographies comme dans Première… », etc.
ME. Comme si un constructeur de voitures attaquait un concurrent en disant : »C’est honteux, leur voiture aussi a des roues et un volant ! »
JPL. C’était insupportable d’entendre leur avocat parler à des juges qui avaient l’air de n’avoir jamais vu un journal de cinéma ! Ils ont gagné en partie, ce qui est hallucinant, même s’ils n’ont eu droit qu’à un franc de dommages et intérêt. La seule chose qu’on a gagnée, ce sont les indemnités légales, qu’on n’avait pas eues, puisqu’on avait été mis à pied.


« Parmi mes regrets, il y a celui de m’être quand même souvent trompé humainement, sur beaucoup de gens. »
ME. Dany et toi, oui, moi rien du tout ! J’ai même été condamné à payer 100 000 F (3 mois de mon salaire de l’époque) à Filipacchi ! Vu que je n’avais pas un rond, j’ai demandé au Conseil d’administration que ce soit Studio qui paye, et Canal et UGC ont été d’accord. Encore une fois, merci à eux, mais il faut dire, c’était très choquant, cette condamnation. J’ai perdu parce qu’aucun de ceux qui étaient restés à Première, pourtant tous des potes, dont la plupart avaient débuté dans le métier grâce à nous, n’a voulu témoigner contre Filipacchi et dire qu’il mentait en prétendant n’avoir jamais été au courant de Studio. Il y en a même eu un, le photographe Bertrand Laforêt, qui a osé faire un faux témoignage pour soutenir Filipacchi. Parmi mes regrets, il y a celui de m’être quand même souvent trompé humainement, sur beaucoup de gens. Je n’ai pas toujours eu un flair formidable. On parle de tous ceux avec qui ça s’est bien passé, mais j’ai trop souvent accordé ma confiance à des gens qui ne la méritaient pas, j’ai engagé pas mal de gens en croyant que c’était des gens bien, et qui se sont révélés des merdes humaines.
FILIPACCHI
Filipacchi est une personnalité mythique de la presse d’alors….
ME. J’ai rencontré Filipacchi une dizaine de fois, il n’était pas antipathique, mais franchement, il ne fait pas partie des mecs qui m’ont ébloui intellectuellement. Son manque d’intuition sur Studio, le fait d’avoir pensé qu’il pouvait nous lourder de Première, Jean-Pierre, Dany et moi, et qu’Halberstadt et les autres pouvaient nous remplacer sans dommages, c’est bien la preuve qu’il n’était pas un génie ! Surtout, il était trop vieux et trop déconnecté, il vivait dans sa bulle. Il avait aussi un côté Mafia, il nous a punis, il a voulu nous montrer qu’il était le boss. On était un petit État dans l’État, ça l’agaçait. J’ai lu, dans le numéro de Première qui prétend raconter l’histoire de Première, que Filipacchi avait téléphoné à Halberstadt, qui nous avait succédé, pour lui dire que sa couverture sur Batman de Tim Burton était nulle ! Ce n’est jamais arrivé avec moi, il ne m’a jamais appelé pour me dire quoi que ce soit sur le contenu du journal, ni en bien, ni en mal.
JPL. En plus, Première ne dépendait pas directement d’Hachette, on était édité par une filiale. Avant l’histoire du Premiere US et le projet Studio, qui se sont déroulés en même temps, de 85 à 87, on n’avait jamais eu affaire à Filipacchi. En fait, on a toujours eu, quel que soit le groupe auquel on ait appartenu, un statut un peu à part. Un peu celui du village d’Astérix encerclé par les Romains ! Aussi bien Première que Studio ont été des journaux qu’on a toujours faits dans notre coin, de manière quasi artisanale. C’est sans doute ce statut à part qui, quelles que soient les époques, a nourri la cohésion et le dynamisme de l’équipe.
Et c’est donc Michèle Halberstadt qui vous a remplacés à Première...
JPL. Oui, elle avait donc démissionné deux ou trois mois auparavant. Elle m’a appelé un soir chez moi quelques jours après notre licenciement pour me dire qu’on lui proposait la rédaction en chef de Première et qu’elle voulait savoir ce que j’en pensais. Je lui ai répondu : »Rien ! Que veux-tu que j’en pense ?!! C’est ta vie, ce n’est plus la mienne. Tu sais dans quelles conditions on a été virés, c’est à toi de voir. C’est toi que ça regarde. » Le lendemain, elle est arrivée à la rédaction en disant : »J’ai eu Jean-Pierre, il trouve que c’est une bonne idée que je sois rédactrice en chef ! » C’est dans la foulée de cette réunion qu’une partie de l’équipe a donc démissionné, et pas seulement les journalistes.
ME. Toutes ces péripéties ont rendu l’aventure du démarrage de Studio encore plus excitante. C’était déjà génial, de créer, de lancer un nouveau journal, alors là, l’enjeu était encore plus fort. Même si on était là dès le premier numéro de Première, ce n’est pas nous qui en avions eu l’idée.
JPL. Sauf que le moment où Première décolle correspond au moment où tu reviens et deviens rédacteur en chef.
ME. Oui, mais ce n’est pas moi qui suis à l’origine du concept. En même temps, c’est clair que je n’aurais jamais eu l’idée de Studio si je n’avais pas fait Première.

JPL. D’autant plus qu’on n’aurait jamais pu faire Studio sans la qualité des rapports qu’on avait créés à travers Première avec les gens du cinéma. En arrivant de nulle part, on n’aurait rien pu faire ! Halberstadt peut dire ce qu’elle veut – je ne lui reproche pas d’avoir pris notre place malgré les conditions de notre départ, après tout, chacun ses principes, chacun sa morale, chacun sa vie… – mais je me souviens très bien que pendant la première année de Studio, sinon plus, elle nous a fait vivre un enfer ! Je passais mon temps à éviter toutes les peaux de banane qu’elle glissait sous nos pieds ! Une vraie course d’obstacles ! Elle ne cessait de faire pression sur tout le monde, sur les attachés de presse, sur les acteurs, pour qu’ils refusent de travailler avec nous, en disant : »Nous on est à plus de 400 000 (ce qui n’était déjà plus vrai !)… Si Studio vient sur ce tournage, on n’ira pas. » Pour le numéro 2 de Studio, on avait organisé une rencontre Alan Parker-Jean-Jacques Beineix. A l’époque, ils sont tous les deux au top : l’un vient de faire Birdy, l’autre 37,2 le matin. On les connaît très bien tous les deux. Parker est OK pour la rencontre avec Beineix et nous invite un dimanche chez lui à Londres pour déjeuner. A l’apéro, il nous dit : »C’est bête, cette histoire de Première et Studio. Ce sont vos affaires, ça ne me regarde pas. Je suis ami avec vous, je suis ami avec Michèle, mais quand même, elle m’a appelé avant hier soir ici pour me demander de ne pas faire la rencontre avec Jean-Jacques Beineix ! » Ça a duré comme ça pendant un ou deux ans. Heureusement, on avait créé de tels rapports avec les gens de cinéma grâce à Première, qu’ils nous sont restés fidèles, et n’ont jamais cédé à ses pressions.
STUDIO MAGAZINE

L’équipe de départ de Studio est donc la même que celle de Première ?
JPL. Oui quasiment… Michel, Christophe, Luc, Denis Parent, Catherine Wimphen, Martine Moriconi qui nous a rejoints quelque temps plus tard, Sylvie Gonthiez, l’assistante de Marc, qui est devenue secrétaire générale de la rédaction de Studio, Christine Levraud qui s’est occupée de nos R.P., Roger Duciel, maquettiste, Alain Carton, un ami d’enfance de Marc qui était secrétaire de rédaction. Et François Forestier, de L’Express, aujourd’hui à L’Obs, qui a fait des piges régulièrement au début. La seule différence notable, c’était la présence de Pascal Mérigeau.
ME. Il était sympa, je l’aimais bien. Après nous, il a longtemps travaillé L’Obs, quand je lisais ce qu’il écrivait, je me demandais comment il avait fait pour travailler avec nous : lui aussi était à fond dans la ligne Libé-Télérama-Les Inrocks !
JPL. Il se foutait un peu de nous à l’époque parce qu’on aimait beaucoup des films français qui sortaient ! Pour lui, il n’y avait que Mankiewicz et Renoir. Il avait fait des piges à Première les toutes premières années en signant des papiers mémoire avec François Guérif, et Forestier nous avait reparlé de lui au moment de L’Hebdo Cinéma. A l’époque, il faisait des papiers dans Téléstar. Après Studio, comme il était devenu copain entre temps avec Jean-Michel Frodon, il est entré au Monde, puis est passé au Nouvel Obs. On a été l’instrument de son destin ! Ah ah ah !
ME. Au départ, à part Rebichon qui avait donc quitté Première pour devenir le rédac chef de Studio, l’équipe de Première devait rester à Première. Et on avait engagé Mérigeau comme rédacteur en chef adjoint. Le problème, c’est qu’après l’arrivée de tous les démissionnaires de Première, on s’est retrouvés avec une rédaction pléthorique, qui coûtait très cher, et que nos résultats financiers n’étaient pas aussi bons que prévu. Nos ventes étaient excellentes, au-dessus de nos prévisions, mais il y avait un paramètre qu’on avait sous-estimé, et qui s’est révélé très pénalisant, économiquement, c’est qu’à ce prix et à ce niveau de diffusion, il fallait mettre en place 200 000 exemplaires pour en vendre 100 000. A Première, pour vendre 400 000, on tirait à 500 000, pas à 800 000 ! Et Studio, avec son très beau papier glacé, coûtait très cher à fabriquer. Bref, il a fallu très vite resserrer l’équipe. L’été 88, 18 mois après la création de Studio, on s’est séparés de trois ou quatre personnes. On a proposé à Mérigeau de ne plus être redac chef adjoint (quatre chefs, ça faisait beaucoup quand même !), mais une sorte de pigiste de luxe régulier, il l’a mal pris et a préféré partir.


JPL. Et il a aussi fallu trouver de nouveaux actionnaires. UGC et Canal ont en effet souhaité qu’il y ait un groupe de presse dans le capital de Studio, pour se rassurer. On a donc cédé une partie de nos parts aux Éditions Mondiales (Télé Star, Télé Poche, Le Film français…), mais UGC et Canal en revanche ont tenu à ne pas toucher à notre nombre de voix au sein du Conseil d’administration. Sussfeld avait dit : »Nous avons l’argent, mais c’est vous qui avez les idées et qui faites le journal. »
ME. Rien à dire, ils ont été top.
JPL. Et jusqu’au bout ! Lorsque, en 2004, Studio a été vendu au groupe belge Roularta, Alain Sussfeld était là lui-même à la signature de la vente, alors qu’UGC aurait pu envoyer seulement un directeur financier. Comme je le remerciais d’être venu, il m’a dit : «Nous étions là le premier jour, il est normal que nous soyons là le dernier !»
« Yves Montand, président du jury, s’était assis sur la règle de confidentialité pour nous faire plaisir… »
Votre premier beau scoop avec Studio est arrivé très vite, dès le n° 4. Yves Montand, président du jury à Cannes en 87, racontait sa vie au jour le jour, ce qui ne s’était jamais fait.
JPL. Ça ne s’était jamais fait, parce que, théoriquement, les jurés sont tenus au secret. C’était, de la part de Montand, à la fois le signe d’une grande liberté et d’une formidable confiance à notre égard.
ME. Ça, c’est un de nos plus beaux coups. Et c’est dû à Jean-Pierre, à 100 %. Même si Montand n’avait révélé aucun secret fracassant, j’étais ravi de ce coup parce que j’imaginais la tête des boss du Festival ! Yves Montand, président du jury, s’était assis sur la règle de confidentialité pour nous faire plaisir, et pour se faire plaisir, en faisant la couverture de notre journal en smoking. Pour des fans de Montand comme nous, c’était jouissif ! Et vis à vis de Première, c’était un coup magnifique, qui montrait que notre relation aux artistes avait plus de poids que leur tirage, qui était encore sûrement à cette époque trois ou quatre fois supérieur au nôtre. Et c’était d’autant plus satisfaisant qu’on n’avait pas réussi ce coup-là grâce à notre amitié avec des potes comme Depardieu ou Lambert, non, c’était avec Montand ! C’est-à-dire un monument du cinéma français ! Et c’était l’année où Pialat avait décroché sa Palme très contestée pour Sous le soleil de Satan…

JPL. Oui, et je sentais bien d’ailleurs en parlant avec lui que son cœur penchait plutôt du côté des Yeux noirs, de Mikhalkov avec Mastroianni. Mais il n’était pas seul à décider. C’était amusant d’ailleurs parce qu’il me testait sur certains films : « Dis petit, ils en ont pensé quoi dans ton journal ?” Encore une fois, il ne violait pas le secret des délibérations, mais on découvrait la vie quotidienne d’un président du Jury et on devinait ses sympathies. Je le voyais régulièrement, tous les jours ou tous les deux jours, pour qu’il me raconte ce qu’il avait fait. Ce n’est pas toujours simple vu son emploi du temps. Je me revois encore un soir, avant la projection officielle, en train de le suivre, mon walkman à la main, de sa salle de bains à sa chambre, lui en slip et en marcel et en train de s’habiller. Ah ah ah ! Carole Amiel, qui était donc devenue sa femme, et qui était plus jeune que nous, était là bien sûr. Je me souviens que le soir où Luc faisait les photos pour la couverture, il lui avait dit : »Va t’amuser avec les petits. » Et à Luc et moi : “Vous sortez ce soir ? Emmenez-la, emmenez-la. » J’imagine la tête qu’il aurait faite si elle était venue avec nous ! Dès le début de Studio, en dehors d’Adjani qui était alors très proche d’Halberstadt (elles se sont fâchées depuis), nous avons eu en effet le soutien de toute la nouvelle génération que nous avions accompagnée, mais aussi des « poids lourds » avec lesquels nous avions noué de bons rapports du temps de Première : Montand, Deneuve, Noiret, Belmondo, etc.
Propos recueillis par Sylvain Lefort & Fred Teper
Commander Mémoires d’un enfant du cinéma de Marc Esposito (Editions Robert Laffont) ici
Commander Gérard Oury – Mon père L’as des as de Jean-Pierre Lavoignat & Danièle Thompson ici
A suivre…
Épisode 7 : C’EST ENCORE LOIN, L’AMERIQUE ?


CANNES
Cannes, qu’est-ce que ça vous évoque ? Avant vous, comment le Festival était-il couvert ?
Jean-Pierre Lavoignat. Depuis que je suis allé la première fois à Cannes avec Marc, la première année de Première en 1977, j’ai adoré y retourner, et j’y ai beaucoup de bons souvenirs, malgré les galères… Ce n’est pas rien de faire le journal à Cannes ! C’est génial d’être pendant deux semaines avec des copains à voir des films, à rencontrer et photographier des acteurs et des metteurs en scène, à choisir des photos, à écrire des papiers, à faire la fête. Tout ça en même temps ! Sous le soleil (enfin, ça dépend des années !!) et au bord de la mer. C’est un moment unique. Voilà pourquoi, même si aujourd’hui mon emploi du temps y est beaucoup plus tranquille, j’ai toujours beaucoup de plaisir à y aller.
Marc Esposito. Moi, c’est l’inverse, je suis devenu sauvage, je ne suis plus du tout à l’aise à Cannes. Depuis mon départ en 93, j’y suis allé trois fois en 25 ans, cinq jours en tout. Je n’y connais plus grand monde. Mais quand on y allait pour Première et Studio, c’était génial, c’était le meilleur moment de l’année.
JPL. Dès son retour à Première en 80, Marc a décidé de faire descendre à Cannes toute la rédaction, y compris les maquettistes et les secrétaires de rédaction, et qu’on fasse le journal sur place, presque dans les conditions d’un quotidien. Du coup, on a loué des villas où on pouvait vivre et travailler, et elles ont été de plus en plus grandes parce qu’on était de plus en plus nombreux. Il y avait une vie communautaire rigolote, qu’on n’avait pas, bien sûr, à Paris, qui donnait à ce séjour, et malgré la masse de travail, un petit air d’adolescence prolongée. On louait des scooters, on se déplaçait en bande.
« C’était le secret de la réussite des fêtes de Première, puis de Studio : les gens s’amusaient. »
ME. Cannes, c’est quand même un lieu où on a beaucoup fait les cons, la fête, sex, drugs and rock’n roll ! Il y a une année où je chroniquais le festival dans le 13 heures d’Yves Mourousi, sur TF1, à la fin du journal. Un jour, à l’antenne, il a parlé de la fête Première qui avait eu lieu la veille comme si c’était la fête la plus extraordinaire à laquelle il avait assisté de sa vie ! Toutes les vedettes présentes à Cannes venaient, parce qu’elles savaient qu’il n’y aurait pas de photographes, ou alors ceux du journal, qu’elles connaissaient. Elles savaient qu’ils n’iraient pas faire une photo pendant qu’ils roulaient une pelle à leur voisine !
JPL. Il y a eu des fêtes mémorables ! Je me souviens, ce doit être en 85 ou 86, Depardieu était entouré de ses metteurs en scène : Blier, Pialat, Veber, qui n’avaient pas pour habitude de se croiser ni… de se le partager !
ME. Ni d’aller dans des fêtes !
JPL. Il y avait aussi Pierre Richard, William Hurt, Patrice Chéreau, et tellement d’autres.
ME. Même Gilles Jacob, le boss du Festival, qui n’est pas le cousin d’Iggy Pop, se sentait obligé d’y passer !
JPL. Iggy Pop est venu d’ailleurs, avec Johnny Depp et John Waters, quelques années plus tard à une fête Studio. C’est sûr, c’était plus fun que les César ! C’était incroyable ! Mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César : sans Marc, sans son goût pour la fête, sans surtout ce désir et cette volonté de partager son plaisir, ces fêtes n’auraient jamais existé. C’est lui qui a en eu l’idée, c’est lui qui a fait en sorte qu’elles existent – j’imagine la tête des directeurs financiers quand il montait au créneau pour débloquer le budget ! Comme je le disais tout à l’heure à propos de ce sentiment de proximité qu’il sait communiquer, il a insufflé cet esprit de fête dans la vie quotidienne du journal. D’abord à Première, puis à Studio. Et même treize ans après son départ, cet esprit-là régnait toujours. Il ne doit pas y avoir eu beaucoup de rédactions qui célébraient la fin du bouclage au champagne ! A Studio, après le départ de Marc, on n’a pas pu organiser beaucoup de fêtes à Cannes, mais on a réussi à en faire de très belles à Paris. Tout le monde venait. C’était aussi une manière de tester… notre cote d’amour ! Je me souviens que la fête du numéro 200 de Studio est tombée pile au moment de l’arrivée des nouveaux actionnaires belges, qui venaient de racheter Studio, on s’était tous mobilisés pour qu’il y ait le plus d’acteurs possibles. Ils étaient tous là ! Même Jeremy Irons de passage à Paris ! Je peux vous dire que les Belges étaient impressionnés. Le lendemain, ils ne nous regardaient plus de la même manière. Et en plus, ces acteurs n’étaient pas venus que pour la photo, ils étaient restés longtemps et s’étaient amusés. Car c’était le secret de la réussite des fêtes de Première, puis de Studio : les gens s’amusaient. Pas de photos, sauf à l’entrée, et un mélange des gens idéal, pas seulement des acteurs célèbres, mais plein de copains et de copines qui aimaient faire la fête – ça aussi, on le doit à Marc.
ME. On en a fait avec plus de mille invités, des funambules sur les toits, on a été les premiers à avoir ces énormes projos qui faisaient des poursuites de lumière dans le ciel, on nous voyait depuis la Croisette ! Il faut dire que, pour organiser et animer ces fêtes, on avait trouvé une bande de potes dont c’était le métier, Sylvie Grumbach en tête, qui avait participé au lancement du Palace, et qui étaient top. Je précise que ces fêtes ne nous coûtaient pas grand-chose, puisqu’on les faisait dans les villas qu’on louait pour y habiter et y travailler pendant le Festival, et tout l’alcool était gratuit, ou presque, puisqu’à l’époque, les pubs d’alcool étaient autorisées dans les journaux, donc on échangeait deux pages de pub contre l’alcool de toute la soirée.


Ce qui est fou, quand on regarde les numéros de Première d’après Cannes, c’est qu’on voit, notamment en 1981, que même Gilles Jacob n’hésitait pas à commenter le palmarès… Inimaginable aujourd’hui ?
JPL. Je ne suis pas sûr. Il doit bien arriver à Thierry Frémaux de le faire, non ? Peut-être aussi, comme Marc tapait volontiers sur la sélection, que c’était une manière de nous amadouer, de s’expliquer… Aujourd’hui encore, 30 ans après, je ne peux pas croiser Vincent Maraval, le patron de Wild Bunch, sans qu’il m’interpelle : »La vieille vague, la vieille vague ! Cette chronique d’Esposito, ce n’était pas possible ! » En 1985, Chabrol et Godard étaient en compétition, et c’était le titre de l’édito de Marc sur la sélection : »La vieille vague » ! Après une période d’apprivoisement, on a eu des rapports quasiment amicaux avec Gilles Jacob.
ME. Il a même été très sympa quand je lui ai proposé pour Cannes le doc sur Dewaere pour les dix ans de sa mort, en 92. Il a dit oui sans hésiter. Et il m’a donné un bon conseil, que j’ai suivi : »Ne dépassez pas 1 h 20. Pour un doc, au-delà ça paraît toujours trop long. »

JPL. Et le doc a été présenté à Cannes 1992 en séance spéciale. C’était pour nous tous un moment forcément très émouvant. Toute l’équipe avait monté les marches.
ME. C’était énorme : voir ce film sur l’écran géant du Palais dans la grande salle. Mes parents, ma fille Adèle, qui avait 9 ans, étaient là. C’est un des deux ou trois moments les plus forts de ma vie.


JPL. Gilles Jacob nous a quand même piqué une idée – ou presque… Ce devait être en 85 ou 86, on déjeune avec lui au Fouquet’s pour discuter de Cannes, sans doute à propos d’un anniversaire du Festival. Marc jette une idée – comme quoi l’idée de la photo des 177 acteurs de Studio trottait dans sa tête depuis longtemps – et lui dit : »Ce qui serait magnifique, ce serait de réunir sur la scène du Palais tous les acteurs du cinéma français, de la plus jeune au plus vieux, de Charlotte Gainsbourg à Charles Vanel ». Et lui de nous répondre que ce serait trop compliqué, trop cher, impossible, etc. Et quelques mois plus tard, c’est… Charlotte Gainsbourg et Charles Vanel qui ont ouvert le Festival !
ME. Ah ah ah ! J’avais oublié ça !
JPL. Plus tard, à Studio, j’avais un jeu avec Gilles Jacob pour préparer les Spécial Cannes. A partir de janvier, je l’appelais régulièrement. Je lui énumérais des titres de films potentiellement « cannables », lui ne citait jamais aucun titre, c’était à moi de les trouver. Et… il n’y avait toujours pas Internet ! Il n’y avait que trois réponses possibles : »On ne l’a pas vu », »Peut-être » ou »Il est pris ». Il ne disait jamais »pas sélectionné » par courtoisie vis à vis des films refusés. Nous, en tout cas, ça nous permettait d’avancer dans la préparation du numéro, et de ne pas devoir tout faire à la dernière minute.
ME. Tous ces trucs-là, c’était typiquement Jean-Pierre ! Il passait un temps fou au téléphone, alors que moi je détestais ça, j’étais du genre injoignable.
Dans les couvertures de Première de votre époque, toutes consacrées à des acteurs, il y a une exception avec un metteur en scène : Steven Spielberg…
ME. Avant lui, il y a eu aussi Francis Veber, mais pas seul, avec Depardieu et Pierre Richard.

JPL. Spielberg, c’était en septembre 1986 pour la sortie française de La Couleur pourpre, le premier film de Spielberg, dit « sérieux » – ce qui est un qualificatif un peu idiot soit dit en passant. En tout cas, sans effets spéciaux et sur un sujet « adulte ». Et inattendu pour lui. Une histoire de Noirs. Uniquement avec des acteurs noirs. C’était un événement, d’autant que le film dés sa sortie américaine avait récolté près de 100 millions de dollars en moins de six mois. Voilà dix ans qu’on espérait le rencontrer pour une longue et vraie interview, et pas juste une conférence de presse. On demandait à chaque film – c’était facile, on les aimait tous ! Même si on trouvait La Couleur pourpre un peu trop mélo – mais le défi ne manquait pas de panache – on a renouvelé notre demande. Cette fois, non seulement il a dit oui pour une longue interview mais il a aussi accepté qu’on vienne avec un photographe. C’était la première personnalité américaine de ce statut à accepter de poser pour nous. Cela valait bien une couv ! Au départ, c’est Michèle Halberstadt qui devait l’interviewer mais elle est tombée malade. C’est donc moi qui ai fait le voyage. Mon premier voyage à Los Angeles ! Comme j’étais aussi terrifié – à cause de l’anglais ! – qu’excité, j’ai demandé à Jean-Paul Chaillet de m’accompagner. Et Luc est venu faire les photos. On était dehors, dans la cour des bureaux d’Amblin, véritable enclave aux allures d’hacienda mexicaine au milieu des studios Universal, qu’on a beaucoup vue depuis et où je suis retourné plusieurs fois, mais qu’on découvrait alors avec le sentiment de pénétrer dans le Saint des Saints ! A cause de la lumière, on a commencé par les photos, et Spielberg s’est prêté au jeu très volontiers. Pendant l’interview, qu’il a enregistrée lui-même de son côté au cas où il veuille réutiliser une partie de ce qu’il nous dirait (sic !) et qui a duré une bonne heure, il a été passionnant, pas langue de bois, généreux et attentif. Jusqu’au moment où un mec de la Warner est venu nous dire qu’il fallait poser notre dernière question. J’ai dit que ce n’était pas possible, qu’on en avait encore plein d’autres, et j’ai insisté, insisté… Devant notre insistance à la fois naïve et enthousiaste, Spielberg nous a promis de continuer cette interview au téléphone. Et quelques jours plus tard, alors qu’on nous étions rentrés à Paris, il a tenu promesse et m’a rappelé au bureau. Et on a encore parlé pendant plus d’une demi-heure. Il m’est arrivé exactement la même chose quelques années plus tard à Studio avec Meryl Streep qui, elle aussi, devant mon insistance, avait promis de me rappeler pour qu’on finisse l’entretien – j’avais pourtant passé plus d’une heure avec elle ! – et elle l’avait fait. Ce serait impensable aujourd’hui, non ?

HALBERSTADT / PREMIÈRE US
Marc, c’est vous qui avez eu l’idée du Première américain, comment ça s’est passé ? Pourquoi ça a déclenché votre rupture avec Michèle Halberstadt ?
ME. C’est une histoire de fous ! On est en 85, je fais une note à Daniel Filipacchi, le big boss du groupe auquel appartient Première, qui vient de s’associer avec Rupert Murdoch aux États-Unis, pour lui dire qu’il est complètement anormal qu’il n’y ait pas de magazine comme Première aux États-Unis, le premier pays du cinéma, qu’ils devraient faire Premiere US. Filipacchi fait traduire ma note et l’envoie à Murdoch, qui nous invite à venir le rencontrer. Je propose à Halberstadt le poste de rédac chef qui pourrait se créer à New York pour lancer la version US, elle accepte, elle part avec moi à New-York pour « vendre » le projet. On ne saurait mieux prouver que je l’aimais bien et que je lui faisais confiance. On se retrouve donc tous les deux face à l’état-major Murdoch, et je présente Michèle comme la future rédac chef de Premiere US. Ça se passe très bien, les Ricains sont conquis, nous reprenons l’avion tous les deux le soir même. Et là, dans l’avion de retour à Paris, elle m’annonce qu’elle n’acceptera pas le poste parce qu’elle est enceinte. Je suis furieux ! Elle ne vient pas de l’apprendre, pourquoi m’a-t-elle alors laissé faire toutes ces démarches et pourquoi m’a-t-elle accompagné ?! Après mon coup de sang, le reste du vol se passe dans un silence total. Ça devait être un vendredi ou un samedi, et le lundi suivant, elle n’est pas venue au bureau. On ne l’a plus revue. Elle a démissionné.
JPL. Depuis plusieurs mois, nos rapports s’étaient un peu compliqués à cause de sa situation personnelle. Elle vivait avec Laurent Pétin, avec lequel on avait été copains avant même qu’ils soient ensemble. A l’époque, il s’occupait du marketing des films, notamment ceux d’AMLF. Il avait un tel mépris pour la presse qu’on avait fini par se fâcher avec lui. Elle s’est retrouvée coincée entre le marteau et l’enclume. Elle avait essayé de nous réconcilier. En vain. Mais avant l’histoire du Premiere US, on n’avait jamais eu de conflit avec elle, on s’entendait même très bien.
ME. Puisqu’Halberstadt était out, j’ai demandé à Jean-Pierre s’il était ok pour partir à New York faire le Premiere US, et évidemment qu’il était ok ! Moi, ça ne m’arrangeait pas du tout qu’il parte, il allait beaucoup me manquer, mais bon, c’était une solution évidente.
JPL. Pendant quelques semaines, on a fabriqué un numéro zéro du Premiere US, dont la maquette était faite par Daniel Daage, le directeur artistique de Première (qui, parallèlement, travaillait sur la maquette de Studio !), et avec de vrais articles en anglais. On est partis à New York tous les deux pour présenter ce numéro zéro à l’équipe Murdoch…
ME. …Et leur présenter Jean-Pierre !
« Il (était) complètement anormal qu’il n’y ait pas de magazine comme Première aux États-Unis… »
JPL. Ce rendez-vous, je m’en souviens très bien, était fixé au 11 novembre (1986, donc). On vend l’idée du Premiere américain au staff Murdoch ce jour-là. Nous, on était vraiment des bleus, côté business ! On n’avait rien demandé sur ce projet, ni augmentation de salaire, ni prime, ni modification de notre contrat !! Quand Premiere US s’est fait sans nous, on n’a eu droit à rien. Si bien que chaque fois que j’allais aux États-Unis, après le lancement du Premiere US, et que j’en voyais un dans les kiosques, j’avais d’abord un sentiment de vanité – »Sans nous, il n’existerait pas ! » – et la seconde d’après, une vague de ressentiment.
ME. Ce rendez-vous s’était passé on ne peut mieux, c’était évident qu’ils étaient convaincus, ils allaient faire Premiere US, pourtant, en sortant de cette réunion, on marchait tous les deux au pied des gratte-ciels, et j’ai dit à Jean-Pierre : »C’est drôle, je ne le sens pas… Je ne sens pas que tu vas vivre ici, ni que je vais venir quelques jours par mois… »
JPL. Tu avais bien senti ! Après ce rendez-vous, Filipacchi nous invite à déjeuner, et là, on lui dit qu’on a trouvé l’argent pour Studio, et on lui annonce que le premier numéro est prévu pour le mois de février 1987, donc trois mois plus tard. Filipacchi nous demande comment on va faire pour s’occuper des trois titres : Première, Premiere US et Studio. Marc lui explique que Michel (Rebichon) va démissionner de Première pour s’occuper exclusivement de Studio, que, moi, je vais continuer Première en France tout en lançant Premiere aux États-Unis (c’était le temps de quelques mois, un an tout au plus), et que lui va superviser les trois… Filipacchi nous dit qu’il y aura des confits d’intérêts, on essaie de le convaincre du contraire.
ME. C’était trop tard pour arrêter Studio, on était à trois mois de la sortie du numéro 1, le film de pub était fait, les dos de kiosques étaient réservés, à ce moment-là, il était devenu impossible de ne plus faire Studio.
JPL. Tu as revu Filipacchi, seul, au retour de New York. C’est là qu’il t’a dit : »Nous sommes des vieux crocodiles, ce qu’on aime c’est le pouvoir, si on vous a dit oui pour Studio, c’est parce qu’on pensait que vous ne trouveriez jamais l’argent. » Peu après, il nous a convoqués, toi, Dany (le directeur artistique) et moi, à son bureau sur les Champs Elysées. C’était une scène du Parrain ! Il était tard, il faisait nuit, son bureau était laqué noir, avec une lampe très basse, il portait des Ray Ban fumées, et derrière nous – c’est un fou d’art contemporain – il y avait une statue hyperréaliste d’une femme avec son panier, grandeur nature. Si bien qu’on avait l’impression qu’il y avait quelqu’un dans notre dos quand il nous parlait ! Et là, il nous répète qu’il va nous falloir choisir entre Première et Studio. Nous, bien sûr, on lui répond qu’on refuse de choisir, qu’il nous a donné l’autorisation de se lancer dans ce projet, qu’on l’a tenu au courant de toutes nos démarches et de l’avancée de Studio. La situation s’est tendue, on continuait de faire Première, de réfléchir quand même au Premiere US, et d’avancer sur Studio. Puis, entre Noël et le Jour de l’An (!!), Filipacchi a convoqué une réunion de toute la rédaction. C’était la première fois qu’il venait au journal, rue de Berri. On a senti que c’était la réunion de la dernière chance. Ce jour-là, il a dit : »C’est à Marc que j’ai donné mon autorisation, pas aux autres », c’était une façon de dire : »Marc peut faire Studio, mais tout seul. » La situation était bloquée. Quelques jours plus tard, le 8 janvier 1987, Marc, Dany Daage et moi avons été licenciés avec mise à pied immédiate. C’est-à-dire qu’on devait quitter les bureaux dans l’heure et sans indemnités. ! On a donc été virés comme des malpropres en même pas dix minutes ! Le patron d’Edimonde, la filiale d’Hachette qui éditait Première, Jean Hohman, qui nous aimait bien – le succès de Première rejaillissait aussi sur lui – assistait à cet entretien. Gêné, embêté par la tournure des évènements, il me raccompagne à la porte de son bureau et me dit qu’il a un message pour moi de la part de Filipacchi : »On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, on croit que des gens sont nos amis, ils vous emmènent dans des aventures risquées, puis, au premier coup dur, vous laissent au bord du chemin… » d’un air de dire »Vous ne savez pas à quelle sauce Esposito va vous manger. » Et il me propose d’aller, quelques mois plus tard, à New York m’occuper du Premiere US. Moi qui n’ai pourtant jamais le sens de la répartie, je lui ai répondu : »Je vais pouvoir rassurer mes parents, je suis licencié mais j’ai une promesse d’embauche. » Je suis revenu le lendemain matin vider mon bureau. Puis, on s’est retrouvés dans les locaux de Studio.
« La plupart de nos potes de Première, et tous les plus importants, ont courageusement démissionné, par solidarité… »
ME. T’as pas eu à beaucoup marcher ! Les bureaux de Studio étaient sur les Champs-Elysées, face au Fouquet’s, à 300 mètres de la rue de Berri, où était Première… J’adorais ces bureaux. On était sur les Champs ! De la fenêtre de mon bureau, je voyais qui entrait et sortait du Fouquet’s, l’avenue George V, l’Arc de Triomphe, la Concorde. Pour un provincial comme moi, c’était énorme !
JPL. Ce n’était pas seulement très chic, c’était surtout très pratique : toutes les salles de projos de presse étaient dans le quartier, on gagnait un temps fou en ayant nos bureaux là.
ME. Nos trois licenciements ont bouleversé tous nos plans. Studio devait être fait uniquement avec des pigistes de Première, ils auraient été payés au feuillet pour leurs piges à Studio, qui ne devait avoir que 4-5 salariés, dont moi, avec un salaire au tiers de celui que j’avais à Première. Mais juste après notre lourdage, la plupart de nos potes de Première, et tous les plus importants, ont courageusement démissionné, par solidarité, sans même savoir si on pourrait les engager à Studio.
Propos recueillis par Sylvain Lefort & Fred Teper
Commander Mémoires d’un enfant du cinéma de Marc Esposito (Editions Robert Laffont) ici
Commander Gérard Oury – Mon père L’as des as de Jean-Pierre Lavoignat & Danièle Thompson ici
A suivre…
Épisode 6 : AVE CESAR !


NUMÉROS EMBLÉMATIQUES
« La couv de Première que je préfère, c’est celle de Christophe Lambert en Tarzan »
Avez-vous des numéros préférés ou emblématiques de Première ?
Marc Esposito. Les derniers. Mais, en même temps, le numéro le plus emblématique, c’est le 12, de décembre 77, avec la couverture sur les six nouveaux : Depardieu, Dewaere, Dutronc, Miou-Miou, Adjani et Huppert.
Jean-Pierre Lavoignat. Il était en effet comme le manifeste d’une nouvelle génération. Il y a plein de numéros que j’aime. Je me souviens de la couv de Depardieu en smoking, en décembre 1980. Ça n’allait pas de soi, à l’époque, de faire une telle couv… Je me souviens de la couv Deneuve, « Le Bel été », qu’on avait faite alors que tu étais en vacances, et qui était ma première interview d’elle. De la couv « Adjani enfin ! » De la couv d’Auteuil en Ugolin, de celle de Michel Blanc dans Tenue de soirée… De celle de Mickey Rourke pour L’Année du dragon… Et de tellement d’autres…
ME. Je trouve également la couv sur Bowie très belle. Mais la couv de Première que je préfère, c’est celle de Christophe Lambert en Tarzan dans Greystoke.
JPL. Oui, la photo de Lord Snowdon était superbe. J’aime beaucoup aussi celle qu’on a faite ensuite à nouveau avec Lambert, en 1986, avec une photo de Luc [Roux], prise en Ecosse, pour la sortie d’Highlander. C’est d’ailleurs ce numéro qui a battu tous les records de vente : plus de 490 000 exemplaires !
ME. Quand on regarde toutes les couv d’un seul coup d’œil, on s’aperçoit qu’il y a une grande unité.
PHOTOGRAPHES
JPL. C’est aussi dû au rôle des photographes. Ils faisaient partie intégrante de la rédaction de Première, et plus encore de Studio.
ME. C’était un des piliers du concept de Première comme de Studio : faire les photos nous-mêmes. Ne pas faire les photos en interne, c’était une façon de sous-traiter, journalistiquement pour nous c’était impensable. Ça, ça vient de Frimbois. Il avait été formé à l’école Filipacchi : Salut les copains, Paris Match, c’étaient des journaux qui faisaient leurs propres photos, et Frimbois avait imposé cette exigence, à Première comme à Onze. Il avait raison. Ce sont les photos qui ont, dès le début, fait la personnalité, l’unicité de Première.
JPL. Tous les acteurs jouaient le jeu volontiers, d’autant qu’il n’y avait pas alors tant de longs sujets photos qui leur étaient consacrés ailleurs. En plus, ils aimaient la manière dont on les regardait. Simplement. Sans effets. En cherchant à capter leur personnalité tout en les mettant en valeur. C’était d’ailleurs un des points communs entre les deux photographes principaux : Benoît Barbier et Luc Roux, puis ensuite avec Christophe d’Yvoire.
ME. C’était aussi une consigne de notre part. Ce que faisait Jean-Marie Périer à Salut les copains – mettre en scène les vedettes, avec des décors, des costumes – ne m’avait jamais fait rêver, même si j’appréciais sa créativité. Je n’ai jamais eu envie qu’on fasse la même chose. Si nos photographes avaient eu des velléités d’aller dans ce sens, on les aurait freinés.
JPL. A Première, et même à une certaine époque de Studio, on a eu jusqu’à trois photographes salariés, ce qui était très rare. Aujourd’hui, les journaux de cinéma n’ont plus de photographe salarié.
« C’était un des piliers (…) de Première comme de Studio : faire les photos nous-mêmes. »
Vous aimiez leur regard ?
ME. Ce qui compte, c’est la personnalité. Benoît Barbier, Luc Roux, Christophe d’Yvoire ou Loïc Marrec, qui a travaillé ensuite à Studio, sont des mecs discrets, pas intrusifs. Ils ne vont pas tutoyer tous les acteurs au bout de 30 secondes…
JPL. Benoît Barbier, qui a été longtemps le photographe principal de Première, avait un rapport réservé avec tout le monde. Par exemple, au début, il ne voulait pas manger à la cantine sur les tournages pour ne pas être pris pour un profiteur ! J’ai mis un certain temps à le convaincre que c’était un endroit où l’on pouvait tisser des liens, avoir des infos… Du coup, il a imprimé une certaine manière d’être sur les tournages, de se comporter avec les acteurs. Il a servi d’exemple à ceux qui ont suivi, à Luc, à Christophe.
ME. Christophe d’Yvoire et Benoît Barbier étaient des introvertis… Et ce sont deux aristos. Le vrai nom de Benoît – je le chambrais souvent avec ça, il n’aimait pas du tout ! – c’était Barbier de la Serre. C’est dire notre largesse d’esprit : on a engagé deux aristos ! Ah ah ah !
JPL. Comme je l’ai dit, c’est un des talents de Marc de repérer le talent, le potentiel des gens, même quand ils n’en sont pas forcément conscients. C’est lui qui a poussé Benoît et Christophe à oser faire de la photo en professionnels, qui a poussé Luc à en faire son métier. Et pareil à Studio pour des tas de gens.
ME. Je préfère travailler avec des gens auxquels on apprend le métier, plutôt qu’avec des gens qui ont déjà des habitudes venues d’ailleurs. Ce qui compte, je le répète, c’est la personnalité. On peut apprendre à un mec à être un bon journaliste de cinéma, on ne peut pas lui apprendre à être un mec bien. J’aime être entouré de gens que j’aime, que j’estime en tant qu’êtres humains. La compétence professionnelle vient après. On a embauché peu de journalistes confirmés à la grande époque de Première. Quand on fait Studio, toute l’équipe est constituée de journalistes qui ont débuté avec nous, qui ont appris leur métier avec nous, selon nos règles.
Et Dominique Maillet ?
JPL. On l’a connu au début de sa carrière. Il faisait des piges ici ou là, et notamment à Cinématographe. C’est l’attaché de presse Jean-Pierre Vincent qui nous l’a présenté alors qu’on cherchait quelqu’un pour écrire un papier sur Carlos Saura.
ME. Je dois beaucoup à Maillet. Si j’ai été rappelé par Première en 1980 après l’avoir quitté en 79, c’est parce qu’on lui avait proposé la rédaction en chef, et il l’avait refusée en disant que ce n’était pas un job pour lui, et que lui et la rédaction pensaient qu’il fallait me rappeler. Ça explique la force de mes liens avec la rédaction, d’entrée. Je suis là parce que ceux que je suis censé diriger m’ont réclamé, j’avais 27 ans, ça m’a forcément incité à un comportement très solidaire de l’équipe.

Certaines des photos de Première ou Studio sont devenues des affiches de films.
JPL. De Première, je ne crois pas… De Studio, oui. Celle de Sous le soleil de Satan, qui a valu à Luc une nomination au César de la meilleure affiche. L’année suivante, il l’a eu pour La Petite Voleuse qui n’était pas une photo de Studio mais une photo qu’il avait faite exprès car il avait couvert quasiment tout le tournage.
ME. Il a fait le discours le plus long de l’histoire des César ! Ah ah ah !
JPL. L’affiche de …Satan, ce n’est même pas une photo du film, c’est une photo que Luc a proposée à Depardieu sur le tournage et qu’on a publiée en pleine page dans Studio. Pialat et les distributeurs l’ont adorée, ils en ont fait l’affiche. Pareil pour La Reine Margot, où c’est une photo que Luc a montée avec Adjani entre les prises. Il y a eu aussi une photo de Guillaume Depardieu et Jean-Pierre Marielle devenue l’affiche de Tous les matins du monde, de Corneau, une photo d’Emmanuelle Béart devenue celle d’Une femme française de Régis Wargnier. Et puis bien sûr la photo de Christophe (d’Yvoire), publiée en double page de Studio, qui est devenue l’affiche – et l’emblème – du Cœur des hommes.
Serait-il possible d’avoir une rédaction photo aujourd’hui ?
JPL. Je ne pense pas car ça coûte trop cher. Désormais, les rédactions passent des commandes à des photographes au coup par coup, ou achètent des photos en agence, ou utilisent, y compris pour les couvertures, les photos de la production. A l’époque de Première, alors que l’agence Sygma régnait sur le cinéma et avait l’exclusivité photo sur quasiment tous les tournages, Marc avait réussi à imposer ce deal : l’exclusivité de Sygma était valable pour tout le monde sauf pour Première, et ça s’est élargi ensuite à Studio, lorsque le journal est né.
ME. Ils ne pouvaient pas refuser, parce qu’on était l’un de leurs plus gros clients pour leurs photos de cinéma. Même si sur certains sujets, on tenait à faire nos photos, on leur en achetait beaucoup aussi, notamment des films et des acteurs américains, ils ne pouvaient pas entrer en guerre avec nous. Et puis, c’était aussi l’intérêt des productions qu’on aille sur leurs tournages avec nos propres photographes.
« Oscar-César, Golden Globes-Les Lumières… C’est nul ! On n’était pas obligés. »
CÉSAR
Avec Première, vous avez eu des moments compliqués avec les César.
JPL. Première est né quelques mois après les César. Comme on fréquentait beaucoup Depardieu et Dewaere, et toute cette génération, on voyait bien à quel point c’était douloureux pour eux de ne pas être récompensés. Ils avaient beau dire qu’ils s’en foutaient, ils n’arrivaient pas à s’en foutre. Du coup, on était solidaires d’eux, on voyait bien que le système était injuste, on était contre les César. Cela a changé l’année où Coluche et Adjani ont été récompensés et où tout le monde était là. On s’est dit qu’on avait perdu, que l’histoire était plus forte que nous, qu’il ne servait à rien d’aller à contre courant, ce qui ne nous empêchait pas d’être critiques.
ME. Au moment du succès de Première, les César se sont mis à avoir nos goûts. Ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui. Désormais, ils concordent eux aussi avec la ligne Libé-Inrocks-Télérama. Toute la profession a évolué dans ce sens. Des producteurs aux secrétaires, en passant par les acteurs, les maquilleuses ou les machinistes, les ouvriers du cinéma, tous aiment Lars von Trier, Bruno Dumont et Michael Haneke ! Tout le monde est d’accord avec tout le monde, il n’y a plus de débat sur personne. Dans les années 80, je me plaignais du conformisme cinéphilique ambiant, mais c’est devenu mille fois pire aujourd’hui.
Il existe des chroniques de vous, Marc, franchement salées à l’égard des César…
ME. On était très immergés dans le monde du cinéma, et très du côté des acteurs. J’avais beaucoup de potes acteurs, et je savais que le soir des César, ils avaient tous envie de se pendre – à part les cinq nommés. Le soir des César, si on pouvait mesurer le moral du cinéma français, techniciens, acteurs, metteurs en scène, on verrait que beaucoup sont déprimés. Les seuls qui sont contents sont ceux qui brandissent leur statuette. Les 4 autres nominés ont envie de tuer le gagnant. Les César sont juste une machine à créer de la souffrance. En plus, je déteste cet esprit de compétition, et le fait que, dans le cinéma français, tout le monde chie sur l’Amérique, et on les copie pour ces remises de prix à la con ! Oscar-César, Golden Globes-Les Lumières… C’est nul ! On n’était pas obligés.
Propos recueillis par Sylvain Lefort & Fred Teper
Commander Mémoires d’un enfant du cinéma de Marc Esposito (Editions Robert Laffont) ici
Commander Gérard Oury – Mon père L’as des as de Jean-Pierre Lavoignat & Danièle Thompson ici
A suivre…
Épisode 5 : LES SECRETS D’UN SUCCÈS


DÉCOLLAGE
De quand date le décollage du journal en termes de ventes ?
Marc Esposito. Le gros décollage de Première, c’est le numéro juste après la mort de Romy Schneider, en mai 1982. On n’avait publié que des photos, sans long papier nécro. Cette sobriété avait été très appréciée par les lecteurs, qui l’adoraient. Et deux mois plus tard, il y a celui pour la mort de Dewaere, qui s’est suicidé le jour de mes 30 ans… Et ma fille Adèle est née en novembre… 1982 a été une année très forte pour moi.
Jean-Pierre Lavoignat. Je venais d’arriver en vacances à Avignon le jour de la mort de Dewaere, je t’ai proposé de remonter à Paris, tu m’as dit que ce n’était pas la peine, et tu as fait le sujet tout seul…

ME. En termes de ventes, le numéro avec Romy Schneider représente un bond considérable. On n’est plus jamais redescendu au niveau d’avant ce numéro, tous ceux qui l’ont acheté ont continué d’acheter Première par la suite. C’est un palier décisif.
JPL. Un ou deux ans plus tard, quasiment chaque numéro se vendait plus que le précédent, quelle que soit la couverture… C’était plus que stimulant !
« En quatre ou cinq ans, on est passé de 70 000 exemplaires par mois à plus de 450 000. «
ME. Le succès qu’on a vécu de 1982 à 1986, cette progression continue, qui semblait ne devoir jamais s’arrêter, c’est quasi historique. Très peu de journaux ont connu ça ! En quatre ou cinq ans, on est passé de 70 000 exemplaires par mois à plus de 450 000. C’était grisant ! On n’avait aucun intérêt financier dans cette réussite, contrairement à ce que tout le monde croyait. Je m’étais gravement engueulé dans une soirée avec Coluche devant plein de gens parce qu’il me traitait de menteur et ne voulait pas croire que je n’étais pas intéressé aux ventes ! J’ai seulement réussi à obtenir un mini pourcentage à la fin, en 86, juste avant d’être lourdé !
Le succès n’a pas dû vous valoir que des amis. Avez-vous senti de l’entre-soi de la part du milieu de la presse cinéma ?
ME. Non, pas un »entre soi », ils n’étaient pas tous copains entre eux contre nous ! Nous étions surtout très différents de tous les autres, déjà parce qu’on était plus jeunes – et plus chevelus ! – et parce que tous nos confrères écrivaient soit dans des journaux ou magazines grand public mais généralistes, soit dans des revues qui ne parlaient que de cinéma, mais très confidentielles. Dès les premiers numéros, Première a eu des ventes cinq fois supérieures aux revues cinéphiles, puis dix ou vingt fois. On n’a jamais boxé dans la même catégorie. On a aussi suscité beaucoup de jalousie, parce qu’on a été les premiers à gagner notre vie en faisant des journaux de cinéma, à voyager, à côtoyer les plus grands acteurs et réalisateurs, à écrire des longues interviews et des longs reportages, bref à s’éclater comme des fous tout en étant salariés, comme tous les journalistes de cinéma en rêvaient ! Avant nous, dans Les Cahiers ou Positif, les rédacteurs payaient quasiment pour écrire ! Nous, non seulement on était payés, mais on allait dans des belles villas à Cannes, le journal marchait du feu de Dieu, tout le monde croyait qu’on gagnait cinq fois plus que ce qu’on gagnait réellement !
JPL. Nos confrères n’avaient pas notre chance, soit parce qu’ils travaillaient dans un journal qui ne leur donnait que deux pages par semaine, soit parce qu’ils n’avaient pas les moyens de faire tous ces voyages, d’engager tous ces journalistes, à cause de leurs ventes trop faibles. Et c’est vrai qu’on a vite eu des rapports privilégiés avec tous ceux qui comptaient dans le cinéma.
« Notre force (…), c’est que nos lecteurs se retrouvaient dans nos goûts. »
ME. Cette jalousie n’a fait qu’augmenter au fil du temps, car au début, nous étions pour eux un peu le Salut les copains du cinéma. Ils pouvaient se raconter qu’on ne faisait pas le même métier qu’eux, que nos avis cinéphiliques avaient moins de poids que les leurs, mais au fil des ans, quand on vendait 200, 300 ou 400 000 exemplaires avec Première ou quand on a fait Studio, ils ne pouvaient plus se raconter ça. On était venus sur leur terrain, nous publiions des critiques et des interviews de réalisateurs aussi longues, sinon plus longues que les leurs, nous avons eu des parti pris éditoriaux de plus en plus précis, nous avons défendu un cinéma que globalement tout le reste de la critique méprisait, et nous avons taillé des films que globalement tout le reste de la critique encensait. Le succès de Première et Studio les a forcément agacés, car ce succès n’était pas seulement dû à une formule de presse plus populaire, plus efficace, mais aussi à des parti pris cinéphiles qui tenaient la route, et étaient en phase avec les goûts des cinéphiles de notre époque. Je dis bien »des cinéphiles », pas du public. Avant nous, l’idée reçue, c’est que les cinéphiles étaient trop peu nombreux pour faire vivre un magazine de cinéma, les cinéphiles aimaient Godard, Tarkovski, Ozu et Bresson, et le grand public non. C’était bien pratique, c’était un monde soi-disant binaire, avec d’un côté l’élite cultivée détentrice du label du bon goût, et de l’autre la masse, qui n’aimait pas assez le cinéma pour savoir ce qui était bon. Or non, dans ce »grand public », dans cette »masse », il y avait plein de vrais cinéphiles, des mecs qui adoraient autant le cinéma que les rédacteurs des Cahiers ou de Positif, qui avaient fait autant d’études et vu autant de films, mais qui n’avaient pas les mêmes goûts qu’eux. Nous avons été les porte-paroles de cette cinéphilie-là, la cinéphilie »incorrecte ». Un cinéphile, c’est juste un mec qui a la passion du cinéma, point à la ligne. C’est pas forcément un mec qui tombe en pâmoison devant le moindre home movie signé Godard ! Un mec qui voit 200 films d’action et de bagarre par an, qui a vu 34 fois tous les Bruce Lee, et qui connaît par cœur le générique de tous les Rocky et Rambo, c’est autant un cinéphile qu’un mec qui arrive à ne pas dormir devant un film de Jacques Rivette ! Nous, on préférait Blier à Rivette, Pretty Woman (de Gary Marshall, 1989) au Rayon vert (d’Eric Rohmer, 1986), et on a défendu nos avis d’un point de vue cinéphilique, on a argumenté, on a assumé nos goûts, et chaque mois, des centaines de milliers de cinéphiles, par leurs achats mensuels répétés, nous disaient qu’ils étaient d’accord avec nous. Nos concurrents savaient bien qu’on n’était pas lus par des incultes avinés. On était lus par le même public qu’eux, des jeunes surtout, des lycéens, des lycéennes, des étudiants, des étudiantes, tous aussi fous de cinéma que nous et que les rédacteurs des revues cinéphiles. Sauf que nous, on en avait vingt fois plus qu’eux. Forcément, j’aurais été à leur place, j’aurais eu les boules. Ah ah ah ! Et d’ailleurs, Fred, Sylvain, parlez-nous un peu de vous… Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à lire Première ? Vous avez fait quoi, comme études ? Vous êtes les preuves vivantes que nos fans n’étaient pas des nigauds incultes ou des groupies hurlantes amoureuses de Christophe Lambert !
Sylvain Lefort. Je suis tombé dans le cinéma je ne sais comment…. Peut-être grâce à Première ! Car mes proches n’étaient pas particulièrement cinéphiles. Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai acheté – ou plutôt fait acheter par ma mère, vous pouvez la remercier, ah ah ah ! – le tout premier numéro de Première. J’avais donc 10 ans tout ronds. A partir de ce moment-là, je n’ai plus décroché, de l’école élémentaire jusqu’à mes études littéraires et de com à Sciences Po. Première, puis Studio, ont contribué à forger une partie de ma cinéphilie, à arpenter des voies qui n’étaient pas empruntées par les autres revues, auxquelles – pardon ! ah ah ah ! – je me suis vite abonné aussi : Positif, Les Cahiers, La Revue du Cinéma, Cinématographe, Les Fiches de Monsieur Cinéma. Je suis un vrai boulimique de lecture, mais aussi de salles obscures. Depuis mes 10 ans, je vais au moins une fois par semaine au cinéma, en plus des deux ou trois films par semaine que je regarde dans mon salon. Et je viens même de créer une revue de cinéma, avec trois camarades, Revus & Corrigés !
Fred Teper. Comme toi, je devais avoir une dizaine d’années quand j’ai commencé à feuilleter plus qu’à lire véritablement Première, au début des années 80. A cette époque, j’avais surtout une grande inclinaison pour les fiches puis très vite, vers 1983, c’est devenu un rendez-vous incontournable. Je ne manquais aucun numéro. J’ai eu beau faire après le bac des études supérieures de publicité et de communication, j’avais davantage la tête dans les étoiles et les écrans que dans les bouquins et ça n’a jamais vraiment changé. Ah ah ah ! Depuis une dizaine d’années, je vois en moyenne entre 200 à 250 films par an mais à 15 ans j’en voyais déjà une centaine. J’en ai aussi énormément découvert en vidéo. Bref, je suis un vrai boulimique de films et de séries, et ça ne fait que s’amplifier de jour en jour !
La jalousie des autres journalistes de cinéma dont vous parliez, vous la deviniez, ou vous l’avez éprouvée ? Des confrères ont-ils été agressifs envers vous ?
ME. Pour être honnête, j’ai été plus agressif, dans mes écrits, à l’égard des autres journalistes de cinéma, qu’ils ne l’ont été avec moi. Ils se sont vengés plus tard, quand je suis devenu réalisateur ! Ah ah ah !

JPL. On s’est quand même fait allumer nommément de ci de là… Dans Libé, par Serge Daney par exemple qui, à la naissance de Studio, nous avait traités de nécrophages ! A l’époque de Studio, dans les années 2000, j’ai eu un gros coup de colère à cause d’Elisabeth Quin. Elle avait alors une émission de cinéma à la télé. Je la connaissais à peine mais à une fête à Cannes, c’était une période où elle n’allait pas très bien, elle m’avait pris comme confident et m’avait fait partager ses problèmes sentimentaux. Cela avait créé quelques liens entre nous. On se croisait régulièrement, on papotait, bref, j’étais en confiance. Arrive la sortie de La Repentie, de Laetitia Masson (2002) qui marquait l’énième retour d’Isabelle Adjani. Nous, indéfectibles admirateurs d’Adjani, nous avions fait la couverture avec elle au moment du tournage ainsi qu’une longue interview. C’était moins un engagement sur le film à venir qu’une expression de notre désir de retrouver Adjani au cinéma. A la sortie, le film se fait éreinter quasiment par tout le monde. Ce n’est pas un grand film, mais c’est un film qui me touche. Parce que j’y vois la fascination d’une cinéaste pour une star, pour l’image qu’elle a imposée (ou qui la dépasse) et pour les fantasmes qu’elle suscite. Comme on n’est pas nombreux à aimer La Repentie, l’attachée de presse me demande si je ne veux pas aller le défendre dans une nouvelle émission de télé, animée par Ruth Elkrief. J’accepte. Et là, au milieu de la conversation, on me présente un sujet enregistré où interviennent différents critiques. Il y a Elisabeth Quin qui l’éreinte violemment. Et à la question du journaliste qui lui dit : « Mais pourtant des journaux comme Studio ou Première ont fait leur couverture sur le film” (Première l’avait faite pour la sortie), je l’entends répondre : « Oh, on sait comment ça se passe avec ces journaux-là, c’est donnant-donnant : J’accepte de faire la couverture mais vous faites une bonne critique » ! Je me demande même si elle n’a pas dit que c’étaient des journaux achetés ou vendus, je ne sais plus. Je suis halluciné. Comment elle, peut-elle dire ça ? Si elle le pense, comment a-t-elle pu être copine avec moi ? Comment a-t-elle pu me dire régulièrement du bien de nos articles ? En tout cas, quand la caméra revient sur moi, je suis livide et me défends en disant que non, ça ne marche pas comme ça. Jamais. Et pas plus avec Adjani qu’avec quelqu’un d’autre. Je rentre au journal fou de rage, j’appelle Elisabeth Quin et lui vomis toute ma colère. Et elle me répond : « Mais Jean-Pierre, ce ne sont que des mots. Ça n’a pas d’importance. » Je m’emporte davantage encore. S’il y a bien quelqu’un qui ne peut pas dire que les mots n’ont pas d’importance, c’est un journaliste ! On m’entend hurler jusqu’au fond de la rédaction ! Et je raccroche. Deux heures plus tard, arrive à mon bureau une magnifique orchidée blanche avec ce petit mot : « Tu as raison, Jean-Pierre, les mots ont leur importance. L’autre Repentie ». Cette longue histoire nous a emmenés bien loin des débuts de Première, mais, si je ne me souviens pas d’autres attaques aussi directes, elle montre qu’au fond les choses n’avaient pas beaucoup changé en vingt ans. Elle est significative de ce que certains « confrères » devaient penser et répandre comme rumeurs depuis le succès de Première.
« Première, c’est un journal qui n’existait nulle part ailleurs. »
Avec le succès, vous avez eu également de plus en plus de pages de pub. Nous, lecteurs, on trouvait souvent qu’il y en avait trop ! Mais comme il y avait aussi beaucoup de contenu, on vous pardonnait…
ME. Vous êtes bien bons ! J’avais un deal avec la direction : la part du rédactionnel ne se comptait pas en pages, mais en proportions. Donc, plus il y avait de pub, plus il y avait de rédactionnel. Certains numéros faisaient plus de 200 pages.
JPL. C’est un principe qu’on a toujours appliqué et toujours défendu, même après le départ de Marc de Studio. Je me souviens qu’une des dernières années de Première, Marc s’était battu avec Hachette pour avoir un cahier de huit pages supplémentaire pour un Spécial Cannes et la direction n’avait pas voulu nous l’accorder. Alors qu’à l’époque, grâce aux ventes et à la pub, ils gagnaient beaucoup d’argent. C’est d’ailleurs l’un des éléments qui a compté dans le désir de faire Studio, et qui a nourri la réflexion de Marc sur la création d’un journal dont on serait les seuls maîtres d’œuvre. Cannes, c’était important pour les ventes qui s’étalaient sur deux numéros : celui d’avant-Cannes, qui faisait les meilleures ventes, un véritable guide pour le Festival qu’on était les premiers à faire de manière aussi systématique et complète, et celui d’après-Cannes, où on racontait le Festival, en détails, jour par jour, comme personne ne le faisait. A l’époque, je répète, il n’y avait pas Internet. Je peux vous dire que quand on apprenait quatre jours avant le bouclage qu’il y avait un film d’un cinéaste chinois inconnu, on était mal ! Je me souviens aux tout débuts de Première, pour le premier Spécial Cannes, être allé au flan à la délégation du Québec chercher de la documentation sur J.A. Martin photographe (de Jean Baudin, 1977) !
ME. Ça, c’est Jean-Pierre ! Personne d’autre que lui ne cherchait l’info comme ça. Moi, je ne suis pas du tout un chercheur d’infos. Je suis convaincu que la réussite de Première vient du miracle que constituait notre collaboration. On est tous les deux extrêmement travailleurs, consciencieux, perfectionnistes, et on était à fond, aux taquets. Du coup, la qualité journalistique était élevée. Parce qu’on bossait vraiment beaucoup. On relisait, et on réécrivait si besoin, tous les papiers.
JPL. Aucun papier ne paraissait sans que Marc ou moi ne les ayons relus. Même les brèves.
ME. On était aussi impliqués, aussi travailleurs, mais nos personnalités étaient très différentes, et très complémentaires en termes de management. Il faisait le gentil, je faisais le méchant ! On ne s’est jamais engueulés, ni sur le journal, ni sur les films, on avait les mêmes goûts.
JPL. .. ou presque ! Ah ah ah ! …
ME. … Dans le tableau des étoiles, il n’arrivait jamais que Jean-Pierre attribue 4 étoiles et moi un rond au même film, ou inversement. Il y a eu cette magie, notre entente, et le fait qu’on soit devenus bons dans ce boulot qui n’existait pas avant nous : fabriquer un magazine de cinéma populaire. On n’a jamais rêvé de faire Première, car ce type de journal n’existait pas avant nous.
JPL. En revanche il a vite fait rêver ! Peut-être faites-vous vous-mêmes partie des gens qui nous ont écrit. On recevait en effet beaucoup de courrier. Surtout des jeunes lecteurs. Les gens nous en parlaient sur les plateaux…
ME. On recevait aussi beaucoup de demandes d’embauche, beaucoup de jeunes voulaient travailler avec nous, parce qu’on avait les mêmes goûts qu’eux, et nos goûts étaient très marginaux par rapport aux goûts à la mode dans les autres journaux. J’ai beaucoup tapé sur Libé, dans mes éditos, par exemple. Ces conflits ont totalement disparu, aujourd’hui, il y a un consensus total, la ligne Libé-Télérama-Inrocks est partout, y compris aux César.
Vous ne pensez pas que la proximité que vous aviez avec les acteurs, ou avec des metteurs en scène comme Blier, a pu vous nuire ?
ME. Jamais ! Pourquoi ? Que quelques jaloux aient bavé sur notre dos sur ce sujet, c’est une chose, mais ça ne nous a pas nui, ça ne pèse rien à côté de tous les aspects positifs de cette proximité. C’est elle qui nous a permis de faire des reportages, des photos, des interviews d’une qualité, d’une sincérité que nous n’aurions pas atteintes sans bien connaître ces artistes. Et puis, elle nous a valu le respect du métier : tous les producteurs, tous les attachés de presse savaient que j’étais ami avec Depardieu, ou plus tard avec Blier, ça les agaçait peut-être, mais ils ne se disaient pas que j’étais un con, ou un mec »acheté », parce que j’étais copain avec Depardieu ou Blier !
Vous ne croyez pas que cela ait pu nuire à votre »réputation » de journaliste, à votre intégrité aux yeux des autres journalistes ?
ME. Vous plaisantez ?! Vous croyez qu’il y avait un seul journaliste de Paris qui aurait refusé d’aller déjeuner avec Depardieu ou Blier par intégrité journalistique ?! Ah ah ah ! Tous les journalistes de cinéma rêvent d’être proches des artistes de cinéma qu’ils aiment, ce n’est pas une »faute » d’être ami avec Blier quand on est journaliste à Première ! Michel Ciment, le boss historique de Positif, était très fier d’avoir des super relations avec les grands metteurs en scène qu’il aimait : Boorman, Rosi, etc. François Forestier, quand il était notre voisin du dessus et travaillait à L’Express, nous avait invités à un dîner avec Corneau. Nous n’étions pas dans la position de journalistes politiques qui compromettent leur objectivité en copinant avec des hommes politiques. Pas du tout. Nous, tous ces artistes, on les avait adorés avant de les voir en chair et en os, on aimait leur talent, et on faisait un journal pour le clamer, il n’y avait aucune contradiction à être devenus proches d’eux grâce à notre travail, au contraire c’était très gratifiant. J’ajoute que nous avons été des modèles de non-copinage, comparés aux autres journaux. Les bandes de Libé ou des Cahiers étaient potes aussi avec des acteurs et des metteurs en scène, pas les mêmes que nous, et vous pouvez être sûrs qu’à chaque fois que leurs chouchous pondaient un film, c’était le chef d’œuvre du siècle. Avec tous les anciens rédacteurs des Cahiers devenus cinéastes, c’était risible. Ils défendaient Jean-Claude Guiguet comme on défendait Bertrand Blier ! L’Histoire ne leur a pas donné raison ! Ah ah ah ! Parce qu’il y a ça aussi, qui comptait beaucoup, c’est que nous, nous avions des bonnes relations avec des figures très marquantes du cinéma français, pas avec des troisièmes couteaux, dont les films faisaient quatre entrées. Donc, oui, peut-être qu’ils ont été jaloux, peut-être qu’ils ont bavé sur nous, mais dans notre dos. Aucun n’aurait pu nous dire en face que nous faisions du copinage alors qu’eux n’en faisaient pas. En 17 ans de presse, ça ne m’est jamais arrivé.

Donc, la couverture de Studio avec Kaprisky sur le tournage de Milena (de Véra Belmont, 1991), ce n’était pas parce qu’elle était votre copine ?
ME. Pas du tout ! Quand on a décidé cette couverture, ça devait faire au moins cinq ans que je n’avais même pas pris un café avec elle ! Kaprisky, j’ai eu des bons rapports professionnels avec elle à sa grande époque, parce que je l’ai longuement interviewée, qu’on a fait beaucoup de photos avec elle, et j’ai fait la fête avec elle, au Festival de Cannes deux ou trois fois, mais c’est tout, je n’ai jamais eu avec elle des rapports proches comme avec Miou-Miou ou Evelyne Bouix, ni même Adjani ou Huppert… Et quand je lui ai proposé d’être dans Le Cœur des hommes 2, en 2006, je ne l’avais pas revue depuis 15 ans, depuis ce reportage à Prague sur Milena. Non, on l’a mise en couverture pour des raisons journalistiques : cette fille avait été un phénomène, nos deux couvertures avec elle au milieu des années 80 avaient été des gros cartons, elle avait disparu aussi vite qu’elle était apparue, et contrairement à ce qui se dit, ça n’arrive pas si souvent. Nous l’avions aimée, elle revenait dans un film d’une cinéaste respectable, Véra Belmont, sur un sujet ambitieux (la fiancée de Kafka), je continue de trouver que ça méritait une couverture. Je vais vous dire : au final, c’est même l’une des couvertures dont je suis le plus fier, parce qu’en la faisant, on disait au métier, aux autres acteurs : »Vous voyez, on est fidèles, on ne met pas en couverture que des acteurs au sommet de leur carrière, quand ils font vendre. » Ce reproche du copinage a toujours été infondé. Darmon, avec qui j’ai été ami à partir de 85, n’a jamais fait la couverture de Première ni Studio. Et ça n’aurait pas été un scandale que Darmon soit une fois en couv en 17 ans ! Les quelques fois où son actualité nous l’aurait permis, il devait y avoir un film ou un acteur qui s’imposaient plus ce mois-là, et ami ou pas ami, c’était ça qui comptait.
Nous, on avait quand même l’impression que le fait que vous soyez proches de certains réalisateurs ou acteurs nuisait parfois à votre exercice critique, influençait vos avis sur leurs films. Exemples : Love Dream, avec Christophe Lambert et Diane Lane, Gaspard et Robinson, avec Darmon et Lindon, que vous aviez encensé, ou même Tartuffe, de Gérard Depardieu. Est-ce que vous vous sentiez libres d’écrire des critiques négatives sur des films des artistes dont vous étiez proches?
ME. Là, vous me lancez sur un sujet sur lequel je ne vais pas pouvoir faire court, je vous préviens ! Il y a plusieurs aspects différents, dans votre question. Que nous ayons pu surestimer certains films à cause de la présence d’acteurs qu’on aimait, ça c’est sûr, et je le revendique, c’est une attitude cinéphile normale, qui existe depuis la nuit des temps. Je dirais même que Première et Studio sont bâtis sur ce concept : les acteurs constituent l’élément le plus déterminant dans la relation spectateur-film. De très loin ! Bien avant la mise en scène évidemment, et même, bien avant le scénario. Le célèbre dicton hollywoodien repris par Gabin : »Ce qui compte dans un film, c’est 1. une bonne histoire, 2. une bonne histoire, 3. une bonne histoire », c’est une grosse connerie ! C’est vrai pour certains films, pas pour tous. Je suis bien placé pour le savoir : si Le Cœur des hommes a marché, ce n’est pas parce qu’il y avait une bonne histoire ! C’est avant tout parce qu’il y avait quatre acteurs formidables, que le public aimait, et dont l’alchimie s’est révélée miraculeuse. Quand on aime un film, c’est d’abord grâce à ses acteurs. Vous n’entendrez jamais personne dire : »J’ai adoré Brice de Nice, et pourtant je n’aime pas Dujardin ! » Jamais ! Alors que je peux dire que j’adore Les Bronzés même si la mise en scène de Leconte y est brouillonne. Et je peux dire aussi que j’adore Sur la route de Madison (de Clint Eastwood, 1995), malgré deux éléments importants du scénario que je n’aime pas du tout : la fin, et la structure du film en flash back, toutes les scènes sans Streep et Eastwood m’emmerdent. Oui, les acteurs sont essentiels dans notre relation au film. Et notre proximité avec eux ne changeait rien car, je le répète, nous sommes devenus potes avec des artistes qu’on aimait avant de les connaître. Même avant d’être journaliste et de rencontrer Montand ou Depardieu, il est évident que leur présence dans un film me le faisait aimer davantage que s’ils n’y avaient pas été. Dans Vincent, François, Paul et les autres, si les rôles de Montand et Depardieu avaient été tenus par Marielle et Arestrup, je suis sûr à mille pour cent que j’aurais beaucoup moins aimé le film. Mon pote Philippe Montparnasse, qui a fait la musique du Cœur des hommes 3, et qui est très cinéphile, est fou de Belmondo, résultat : il aime tout Belmondo, et quand je lui dis : »Quand même Le Guignolo, c’est honteux… », il me répond : »Non c’est rigolo, j’aime bien. » Donc, oui, j’aimais tellement Depardieu qu’il me faisait aimer Tartuffe. Y’a pas de honte à avoir ! Surtout que je ne le cachais pas. Ça m’étonnerait que j’aie écrit dans ma critique de son Tartuffe : »Même si vous détestez Depardieu, courez-y, ce film est un chef-d’œuvre ! » Pareil pour Gaspard et Robinson, avec Lindon et Darmon, ou Love Dream avec Lambert : si j’ai écrit que je les ai aimés, c’est que je les ai aimés – Gaspard et Robinson, je m’en souviens bien, Love Dream pas du tout. Mais j’aimerais bien savoir ce que vous appelez »encenser » ! Je suis sûr que je n’ai pas écrit sur ces films des critiques aussi élogieuses que sur Danse avec les loups ou Cyrano – ça, ce sont des films que j’ai encensés. Gaspard et Robinson, comme plein d’autres, que nous avons plus aimés que le public et que l’Histoire a oubliés, ce sont des coups de cœur du moment, comme il est normal que tout cinéphile en ait. Je suis sûr qu’il y a plein de films auxquels vous mettriez 3 étoiles et que j’estime être des grosses bouses ! Ah ah ah ! J’assume tout, je revendique tout.
JPL. Bien sûr qu’on a écrit des critiques négatives sur des films faits par, ou avec, des gens dont on était proches. Si cela nous arrivait trois ou quatre fois de suite, on devenait moins proches, c’est dans l’ordre des choses.
Il ne vous est jamais arrivé d’écrire des critiques gentilles sur des films que vous n’aimiez pas, juste parce qu’ils étaient faits par des réals ou des acteurs dont vous étiez proches ?
ME. Alors là, je vous le dis clair et net : jamais. En 88, quand Zidi fait Deux avec Depardieu, relisez la critique, vous verrez que je suis très dur avec le film. Et idem sur Plein sud avec Dewaere, ou Le Maître d’école de Claude Berri. Si j’ai dit du bien de tous les films de Blier, c’est parce que je les ai tous sincèrement aimés. C’est un auteur avec lequel je suis synchrone : quand il veut émouvoir, je suis bouleversé, quand il veut faire rire, je suis plié, je ressens que je comprends tout son cinéma, qu’il est fait pour moi, que je suis son spectateur idéal. Je ressentais tout ça avant de devenir ami avec Blier. Ma proximité avec lui n’a rien changé, ça a juste continué, sur tous les films qu’il a faits. Il y a enfin un dernier paramètre qui compte, pour répondre complètement à votre question, c’est que nous étions une rédaction de cinéphiles qui préférions aimer que ne pas aimer, nous étions des gentils, des bienveillants. Ça vient de nos personnalités, à Jean-Pierre et à moi, et nous en avions fait un critère déterminant quand nous embauchions des nouveaux journalistes. Alors oui, on essayait de ne pas être trop méchants avec les films, quels qu’ils soient, surtout qu’on savait qu’on allait être lus par ceux qui les avaient faits, pas seulement par nos potes, par tout le métier, par les techniciens du film, par les acteurs, le réal, les producteurs. On essayait de dire les choses sans hargne. Dans les réunions où on se répartissait les critiques, quand on était tous d’accord pour ne pas aimer un film, personne ne voulait faire le papier, c’était pour chacun de nous une corvée de faire une critique négative. Je suis consterné de voir sur le Net des tas de critiques négatives sur les films, où l’on sent la jubilation de l’auteur à écrire un papier destructeur. Il y avait déjà ça à Libé à l’époque, ça me mettait hors de moi. Quand ils détestaient un film, on sentait qu’ils étaient ravis de le détester, nous jamais.
JPL. Notre force – et c’est ce qui explique le succès du journal – c’est que nos lecteurs se retrouvaient dans nos goûts, en tout cas pour l’essentiel. Aujourd’hui, même si dans les histoires “officielles ”, ou branchées, les aventures de Première et de Studio n’existent quasiment pas (dans l’histoire du cinéma français de Jean-Michel Frodon, il doit y avoir une ligne et demie sur Studio et Première, du genre »Les journaux qui aiment les stars »), je suis surpris et touché de rencontrer des gens qui viennent me dire à quel point ces journaux ont sinon changé leur vie, en tout cas beaucoup compté pour eux, à quel point ils ont nourri leur amour du cinéma et de ceux qui le font. Je suis surpris et touché de constater l’influence qu’ils ont pu avoir sur des gens – une influence qu’on ne soupçonnait pas à l’époque, tout occupés que nous étions à les faire – et même ce qu’ils ont pu susciter comme vocations.
ME. Il y a beaucoup de techniciens de cinéma qui ont eu envie de devenir techniciens grâce à la lecture de Première ou Studio.
JPL. Il y a même eu des influences inattendues. Je me souviens que Gaël Morel est arrivé au petit matin à une fête que Studio avait organisée à Cannes et qui était le même jour que la projection et la fête des Roseaux sauvages, et qu’il m’a dit à quel point Première avait nourri son amour pour Deneuve et que c’était même grâce au numéro Deneuve pour Le Lieu du crime qu’il avait découvert Téchiné ! Et Jean-Marc Lalanne, rédacteur en chef des Inrocks, que j’ai connu grâce à une émission de Canal à laquelle on collaborait tous les deux (j’ai découvert alors qu’il était aussi midinette que moi, sinon plus ! Et pas juste concernant Deneuve !), m’avait dit qu’il se souvenait très bien des numéros de Première où Marc racontait son festival de Cannes au jour le jour, et notamment de ce papier où Marc avait écrit être allé dans une fête où circulait du speedball (mélange d’héroïne et de cocaïne), et que cette liberté-là l’avait impressionné. Et qu’ils s’étaient d’ailleurs inspirés de ce ton-là, de cet esprit-là pour faire à leur tour dans Les Inrocks un compte-rendu de Cannes jour par jour… C’est amusant de voir les graines qui ont pu être semées sans même qu’on l’imagine.
ME. J’aurais pu jurer n’avoir jamais écrit le mot speedball ! Ah ah ah !
JPL. Première, c’est un journal qui n’existait nulle part ailleurs. En Europe, et même aux États-Unis – d’où l’idée du Première américain – il y avait, comme en France, d’un côté des journaux très pointus et des revues spécialisées, et de l’autre des fanzines pour ados. Et du coup, le succès de Première a fait naître plein de journaux comparables à l’étranger : Ciak en Italie, Kinema en Allemagne, Empire en Angleterre… Peut-être seraient-ils nés sans nous, du même besoin d’une nouvelle génération de spectateurs et de journalistes. En tout cas, ils sont apparus après. En France aussi, Première a ouvert la voie à d’autres. Des journaux sont nés qui n’ont pas forcément duré, comme Clap !, ou qui se sont imposés comme Starfix, qui se voulait un journal comme Première mais dédié au fantastique, à la SF, aux séries B, et aux films d’action. Il n’a duré que sept ou huit ans, sans jamais atteindre les niveaux de diffusion de Première, mais son souvenir a survécu jusqu’à aujourd’hui.
ME. A Starfix, ils chiaient sur le cinéma français qu’on défendait, et aujourd’hui Boukhrief, ex de Starfix devenu réalisateur, fait La Confession, remake de Léon Morin prêtre ! Ah ah ah ! La ligne Libé-Télérama-Inrocks est partout ! Mais je crois que tu surestimes l’écho de Starfix parce que tu es resté »dans le milieu » et que tu as fréquenté ses ex-journalistes quand ils ont travaillé à Canal. Moi, je ne connais que des gens qui ne savent pas que Starfix a existé !
JPL. Ils ont aujourd’hui encore de vrais fans, leur livre qui raconte leur histoire avec un best of de leurs articles a été un succès, et ils ont même un programme télé dédié sur une chaîne du câble ! J’ai beaucoup aimé La Confession – sans doute grâce à Marine Vacth dont je suis fou. Quand j’ai dit à Boukhrief que j’aimais La Confession, il m’a répondu que c’était sans doute plus un film Studio qu’un film Starfix !
ME. Je ne l’ai pas vu, la vie est trop courte, mais j’ai l’impression que c’est plus un film Télérama que Studio !
Propos recueillis par Sylvain Lefort & Fred Teper
Commander Mémoires d’un enfant du cinéma de Marc Esposito (Editions Robert Laffont) ici
Commander Gérard Oury – Mon père L’as des as de Jean-Pierre Lavoignat & Danièle Thompson ici
A suivre…
Épisode 4 : ÊTRE OU NE PAS ÊTRE A TU ET A TOI AVEC LES ACTEURS


SOMMAIRES
Nous avons beaucoup feuilleté Première pour préparer ces entretiens. Ce qui nous surprend, c’est la variété des sommaires.
Jean-Pierre Lavoignat. Oui, dans le même numéro, vous pouviez avoir une double page sur Les Enfants du placard, le deuxième film de Benoît Jacquot avec Jean Sorel et Brigitte Fossey, et une autre sur Raquel Welch… Même s’il est vrai qu’on défendait un certain cinéma, on était plus ouverts que ce qu’on a pu dire. Plus que critiques, on se revendiquait avant tout comme des journalistes et, du coup, on s’intéressait quasiment à tout. Je me souviens que Marc et moi étions fous de Brian de Palma et de Phantom of the Paradise et que, dès les débuts de Première, on a aussi défendu son Carrie avec enthousiasme, alors que les critiques installés disaient qu’il n’était qu’un plagiaire d’Hitchcock ! Et quand on écrivait qu’on aimait Sergio Leone et Claude Sautet, on nous disait que l’un avait tué le western, que l’autre faisait du cinéma pour les bourgeois, et on nous riait au nez ! Je me souviens aussi que, quelques années plus tard, en 1986, le mois où Coluche est mort – on s’était engueulés un an avant avec lui, il avait dit à Marc : ‘’Faisons cette interview entre gens qui ne peuvent pas se blairer’’, du coup Marc l’avait planté là, et avait décidé de ne plus faire avec lui la couverture prévue du Spécial Cannes – le mois où Coluche est mort donc, on a mis en couv Juliette Binoche qui tournait Mauvais sang de Leos Carax ! Pas mal quand même pour un journal que ses ennemis traitaient de racoleur ! Et Les Cahiers, eux, qui bien sûr ne l’avaient jamais mis en couv de son vivant, avaient consacré leur une à Coluche. Sans doute la mort lui avait-elle donné du talent…
« J’ai toujours voulu que Première soit à la fois un magazine d’informations (…), mais aussi d’opinion sur le cinéma. »
Vous écriviez d’abord sur les films que vous aimiez …
JPL. Pour nous, ça allait de soi. On voulait d’abord faire partager notre passion du cinéma, en parlant surtout des films qu’on aimait et des gens qui les faisaient.
Marc Esposito. J’ai toujours voulu que Première soit à la fois un magazine d’informations sur le cinéma, mais aussi d’opinion sur le cinéma. Blier, Sautet, Leone, on les aimait à la folie, on voulait les défendre, puisqu’ils étaient attaqués par nos soi-disant confrères. Finalement, tous les représentants de la critique traditionnelle nous ont servis. Si nous avions tous été d’accord, Première n’aurait jamais eu le succès qu’il a eu. Et d’ailleurs, aujourd’hui, ils sont tous d’accord et vendent beaucoup moins qu’à notre époque. On dit que c’est la faute d’Internet, mais pas seulement.
INTERVIEWS
Les interviews étaient très longues…
ME. On était jeunes, on était passionnés, on parlait avec les acteurs ou les réalisateurs pendant des heures, et on trouvait tous leurs propos intéressants, on avait du mal à couper ! On a tenté de faire de plus en plus long, et on a vu que les lecteurs aimaient ça, alors on a continué… Il y a eu deux époques. Au début, tous les acteurs qui étaient dans Première n’avaient pas lu Première avant de devenir acteurs, puisqu’on n’existait pas, mais ensuite, après sept ou huit ans d’existence, on a vu arriver des acteurs qui, à 15 ou 16 ans, avaient construit leur rêve en lisant Première. C’est la génération Lambert, Lindon, Bruel… Pour ceux qui l’avaient précédée, les Dewaere, Depardieu, Adjani, Miou-Miou, Huppert, la bande du Splendid, Baye, Giraudeau, Lanvin, etc, les interviews avec nous étaient un exercice totalement nouveau : un journaliste qui met un magnéto pour les laisser parler 4 heures si besoin, ça n’avait jamais existé. Et ils retrouvaient dans nos papiers ce qu’ils avaient dit. Sur ce point, Jean-Pierre et moi avons les mêmes principes, et on les a inculqués à l’équipe : se faire beaucoup chier pour que l’interview soit le reflet exact de ce que l’interviewé a dit, sans qu’il voie qu’on l’a réécrit. On passait beaucoup de temps sur les interviews. Les interviewés étaient très contents car ils voyaient la différence avec nos confrères. Les acteurs m’en parlaient : le plus souvent, avec les autres, ils passaient une heure en interview pour retrouver dix lignes dans le journal. Avec nous, ils restaient deux heures, et retrouvaient six ou huit pages. C’était très valorisant pour eux, on les traitait comme des gens intelligents, qui avaient des choses à dire.
JPL. Les photos ont été importantes, aussi, à côté des interviews et des articles. Avant nous, peu de journaux consacraient autant de pages à des photos d’acteurs, faites spécialement pour nous et par nous, ou à des photos de films, et encore moins de films en tournage.
ME. Même Adjani n’a jamais refusé de faire des photos pour nous. Personne ne refusait car on était très amoureux…
« (Delon et Belmondo) sont les deux seuls avec qui on a eu très vite des rapports compliqués »
DELON/BELMONDO
Quelles étaient vos relations avec Belmondo et Delon ?
JPL. Ce sont les deux seuls avec qui on a eu très vite des rapports compliqués, alors que c’étaient des acteurs qu’on aimait depuis notre adolescence. Le problème, c’est que Première est arrivé à un moment où ils font leurs plus mauvais films. Comme on l’écrivait dans nos articles, Delon s’est très vite fâché avec nous. Belmondo aussi, mais lui, c’est à cause de René Chateau, qui était tout à la fois son associé, son chargé de com, son attaché de presse, son porte-parole…
On trouve beaucoup de couv ou d’articles sur Belmondo et Delon aux débuts de Première.
JPL. C’est vrai au tout début – l’influence de Frimbois sans doute. Quand Marc revient en 1980, c’est la pire période pour les deux, Le Marginal, Trois hommes à abattre. Ce ne sont pas les Belmondo et Delon qu’on a aimés.
ME. Il y a aussi le fait qu’aucun des deux ne voulait nous montrer leurs films avant leur sortie.
A vous en particulier, ou à l’ensemble de la presse ?
ME. A l’ensemble de la presse. On n’est jamais allé voir de films de Belmondo en projection privée. Sauf peut-être Hold up d’Arcady.
JPL. Hold up, c’est le moment où on s’est réconciliés.

Vous vous réconciliez avec Delon et Belmondo quasiment au même moment, en 1985.
JPL. Avec Delon, on s’est refâchés très vite ! C’est moi qui ai fait son interview en juillet 1985, au moment de Parole de fic. Il avait fait très fort… Il me donne rendez-vous aux studios de Boulogne. Quand j’arrive dans son bureau, il me dit : »Ils sont insupportables, ils veulent me censurer ma bande-annonce ! », et il se lance dans un monologue furibard ! Moi, je lui demande pourquoi, etc, et comme ça, en fait, on a commencé l’interview sans quasiment s’être dit bonjour et sans avoir eu besoin d’évoquer notre brouille ! C’était assez malin ! Avec Belmondo, on s’est fâchés à cause de René Chateau. On avait fait une interview de Belmondo que Chateau nous avait demandé de relire. A l’époque, ça ne se faisait pas. On accepte, néanmoins. Il nous la renvoie, très corrigée : tout ce qui était intéressant était biffé de la main de Chateau. On décide alors de ne pas tenir compte de toutes les corrections. Il n’a pas aimé ! Avec Belmondo, on s’est réconciliés lorsqu’il s’est fâché avec Chateau. Les rapports étaient plus simples avec lui qu’avec Delon. D’ailleurs, après notre réconciliation, on ne s’est plus jamais fâchés, et à Studio, on a régulièrement travaillé avec lui. C’était un vrai plaisir. On l’a même suivi au Zimbabwe sur le tournage d’Itinéraire d’un enfant gâté…

ME. Il y a un truc qui a dû jouer à l’époque de Première : Delon et Belmondo étaient jaloux de l’amour qu’on portait à Depardieu, Dewaere, etc, et ça les énervait qu’on leur reproche de ne pas tourner avec eux. Ils nous ressentaient comme des cinéphiles intellos qui ne les aimaient pas. Comme quoi, on est toujours l’intello de quelqu’un ! Tous les films d’eux que nous aimions dataient de bien avant qu’on devienne journalistes : Les Aventuriers, Rocco et ses frères, Plein soleil, A bout de souffle, Classe tous risques, L’Homme de Rio, Le Guépard, La Piscine, Borsalino, etc.
JPL. Quand je suis entré à Première, mon rêve, c’était de rencontrer Delon. C’est certainement l’un des premiers acteurs que j’ai aimés, et qui, lorsque j’étais adolescent, m’a fait aimer le cinéma.
ME. Mais on est tombés dans sa pire période…
Belmondo et Delon, vous les asticotiez souvent…
ME. Personne ne le faisait, c’était très nouveau. Ils étaient très peu interviewés. Quand ils l’étaient, c’était souvent pour leur promo à la télé, ou dans Paris-Match, ce n’était jamais très méchant ni très pointu. Et les revues cinéphiles les ignoraient, ne leur parlaient pas. Avec nous, ils se retrouvaient face à des ex-fans, mais on n’était pas là depuis assez longtemps pour avoir pu leur prouver qu’on les avait aimés »avant », quand ils faisaient d’autres films.
VENTURA, MONTAND, DENEUVE, ET LES AUTRES
Parmi les acteurs de l’ancienne génération avec lesquels ça se passe très bien, il y a Lino Ventura, Yves Montand….
ME. Oui… Ça tient aussi à leur ouverture d’esprit. Ce n’est pas un hasard si vous citez deux Ritals !
JPL. Ils n’ont pas le même rapport à la célébrité que Delon et Belmondo. Et puis surtout, lorsqu’on arrive, ils font des bons films, des films qu’on aime et qu’on défend.
ME. Montand et Ventura m’appelaient directement au téléphone. A l’époque, il n’y avait pas de portables. Ventura n’avait pas de secrétaire, pas d’agent, c’est lui qui m’appelait quand on devait se fixer un rendez-vous…

JPL. Montand pareil. Je me souviens qu’après l’interview qu’on avait faite tous les deux, Marc et moi, en 1981, pour la sortie du Choix des armes, d’Alain Corneau, (il avait voulu qu’on s’installe dehors, sur un banc de la place Dauphine, et c’est lui qui tenait notre petit magnétophone !), il m’avait appelé à l’AFP où je travaillais encore, mais je n’étais pas là. Il avait dit alors à la secrétaire : « Dites lui que Montand a appelé. – Montand, comme le chanteur ? – Oui, comme le chanteur. ” Sans même préciser que c’était lui ! Ah ah ah ! En fait, les agents, on a eu affaire à eux très tard. A l’époque, on passait soit par les attachés de presse des films, soit directement par les acteurs ou les réalisateurs. Vous citez Ventura et Montand, mais on pourrait citer aussi Deneuve, Signoret, Schneider, Noiret, Piccoli, Annie Girardot, qui, tout de suite, nous ont reçus – et bien reçus. Pareil pour des réalisateurs d’avant l’existence de Première, comme Truffaut, Sautet, Lelouch, Chabrol, Pialat, Demy, Chéreau, Spielberg…
ME. Personne ne nous disait non. Sauf Delon et Belmondo, au début.
JPL. Il y a un truc qui a quasiment disparu dans la presse cinéma aujourd’hui, c’est les articles sur la carrière des acteurs. On analysait leurs rôles, on faisait de longs portraits d’acteurs, avec un vrai regard. Marc excellait à faire ça. On a mis longtemps avant de pouvoir interviewer les grands acteurs américains, par exemple, donc on faisait des longs papiers sur eux sans les interviewer. D’ailleurs, ils ont souvent fait la couverture de Première. Aujourd’hui, si les journalistes n’obtiennent pas d’interview, ils ne font rien. Et quand ils en ont, ce sont les mêmes partout. Dans »Autopsie d’une star » qu’on avait écrit sur Delon dans Première, il y a un angle, une analyse de ses échecs et de ses succès. Le papier de Marc sur Dustin Hoffman dans Studio est une merveille de journalisme de cinéma. C’est aussi ce qui a fait la valeur de Première et Studio.
ME. Ça m’éclatait, d’écrire ce genre de papiers.
Ce qui jouait aussi, c’est la proximité que l’on ressentait avec vos interviewés.
JPL. Cela vient, je crois, du fait qu’on les aimait, qu’on connaissait bien leurs films et leur travail. Ils se sentaient vite en confiance, ils comprenaient qu’on était là avant tout pour faire partager l’intérêt et l’admiration qu’on leur portait. C’était excitant d’embarquer nos lecteurs dans cette proximité. Ce sentiment de proximité, je pense qu’on le doit beaucoup à Marc. A la fois à sa manière d’être avec les gens et à sa manière d’écrire. Directe, frontale. J’envie cette façon qu’il a dans ses textes de créer immédiatement un lien de proximité, d’empathie, de familiarité avec les lecteurs. C’est d’ailleurs ce qu’on retrouvera plus tard dans ses films lorsqu’il passera à la mise en scène. Il sait rendre ses personnages proches, fraternels, familiers. Il a insufflé ce sentiment-là à Première, et tout naturellement les gens qu’on a recrutés, même plus tard à Studio, en ont été imprégnés et se sont coulés dans le moule…
ME. J’ai toujours été enchanté que les lecteurs perçoivent et aiment cette proximité. Elle est venue progressivement, au fil des ans, à force de rencontrer les artistes sur les tournages, de les photographier, et de les interviewer. C’est à cause de cette répétition des rencontres que nous avons surtout été proches des grosses vedettes. Plus des acteurs tournaient et sortaient de films, plus on avait d’occasions de les voir, et de tisser des liens, on a donc, logiquement, fini par être proches de ceux qui travaillaient le plus. Mais, dans notre parcours, il y a eu deux sortes d’artistes, qui ont entraîné deux sortes de relations très différentes. Il y a celles et ceux qui étaient des stars avant la naissance de Première, qui étaient plus âgés que nous, et avec lesquels on a souvent eu des rapports excellents, mais sans être jamais »proches », les Deneuve, Montand, Noiret, Ventura… Et il y a celles et ceux qui avaient grosso modo notre âge, qu’on a connus avant qu’ils soient tout en haut, et dont on a accompagné l’ascension, les Depardieu, Dewaere, Miou Miou, Adjani, Huppert. Les premiers, on les a toujours vouvoyés, alors qu’on tutoyait les seconds.
JPL. Enfin pas tous… Moi, j’ai mis des années à tutoyer Isabelle Huppert et Isabelle Adjani. Je crois qu’Adjani, c’était au moment de La Reine Margot (1994), c’est dire… Et je ne tutoie toujours pas Nathalie Baye par exemple. D’ailleurs, ceux qu’on tutoyait, c’est parce qu’ils nous avaient tutoyés d’abord. On ne leur aurait jamais dit « tu » en premier. D’autant que ni Marc ni moi ne tutoyons facilement.
ME. Encore un point commun entre Jean-Pierre et moi, qui n’est pas courant dans les milieux de la presse et du cinéma, où tout le monde se tutoie. Moi je dirais même que j’ai le tutoiement très difficile. Je vouvoie toujours mon producteur des Coeur des hommes, Pierre Javaux, ou Sarah Lavoine, qui sont tous les deux plus jeunes que moi, et que je connais depuis plus de vingt ans. En fait, en dix-sept ans de presse cinéma, il n’y a qu’un seul artiste avec lequel je suis passé du vous au tu en cours de route, c’est Bertrand Blier. C’est le seul metteur en scène plus âgé que moi que j’ai fini par tutoyer, j’ai toujours dit vous à Corneau, Sautet ou Lelouch, et ce, alors qu’eux me tutoyaient. Dans ces cas-là, je m’arrangeais pour ne dire ni »tu » ni »vous ».
JPL. Blier et Lelouch, j’ai fini par les tutoyer… Mais Corneau, Sautet, Miller, Tavernier, Téchiné, Varda, je n’y suis jamais arrivé… Même si eux me tutoyaient ou me tutoient. En revanche, ceux que j’ai connus au tout début de leur carrière comme Leconte, Wargnier, Besson, Beineix, Annaud, Jeunet, Ozon, etc. je les tutoie… Même aujourd’hui, lorsque je rencontre un jeune acteur de 20 ans, je le vouvoie jusqu’au moment où le tutoiement s’impose naturellement. Ou… non !
ME. Puisqu’on parle de proximité, je veux tout de suite préciser une chose, car on croit souvent que le cinéma est un milieu de débauche, où tout le monde couche avec tout le monde. Eh bien pas nous ! C’était même un véritable interdit, chez nous ! En tout et pour tout, pendant mes dix sept ans de Première et Studio, il n’y a eu qu’une histoire d’amour, une seule, entre une artiste et un journaliste.
« Impossible de passer une heure avec (Deneuve) sans sortir totalement envoûté ! »
Catherine Deneuve a été présente très vite dans Première et vous l’avez très souvent interviewée et photographiée. Avec Depardieu, elle arrive quasiment en tête des couvertures de Première et de Studio…
JPL. C’est qu’on était des fans absolus de Depardieu et Deneuve ! Cette passion pour Deneuve, c’est un des nombreux points communs sur lesquels s’est construit notre amitié. D’ailleurs, au début de Première, on s’était même promis tous les deux de ne plus adresser la parole aux gens qui disaient : »Ah oui, mais sa sœur était tellement mieux ! ». Bien sûr, on aimait Françoise Dorléac, et son charme, et sa fantaisie… Mais elle n’était plus là ! Et cela était insupportable – et tellement vain, et tellement injuste ! – d’entendre toujours cette comparaison…
ME. C’était un lieu commun de la pensée cinéphiliquement correcte ! Ça m’horripilait ! Heureusement, ça arrive moins souvent qu’il y a 20 ou 30 ans, mais ça arrive encore, et ça m’horripile toujours autant !
JPL. Moi aussi.
ME. J’aimais beaucoup d’autres actrices, Romy Schneider et Annie Girardot en particulier, qui étaient des actrices incroyablement bouleversantes, plus que Deneuve, mais Deneuve, pour moi, était dans une case différente, comme un fantasme, comme un rêve de femme. Dans Le Sauvage, elle est terrassante. Je n’ai ressenti de nouveau cet emballement qu’avec Julia Roberts dans Pretty Woman… La première fois que j’ai interviewé Deneuve, c’était sur le tournage de Je vous aime, de Claude Berri, mais pour la sortie du Dernier métro (de François Truffaut, 1980). Et, évidemment, j’ai adoré l’interviewer. Elle a un charme ravageur ! C’était vraiment impossible de passer une heure avec elle sans sortir totalement envoûté !
JPL. Sans parler de son intelligence, de la pertinence, de la précision avec laquelle elle répond…
ME. Elle était à tomber par terre, mais ce n’était pas du tout une séductrice, elle ne faisait aucun numéro de charme…

Et vous, Jean-Pierre, votre première rencontre avec elle ?
JPL. Dans son livre, Marc raconte que la première fois qu’il devait l’interviewer, il a dû attendre cinq jours sur le tournage de Je vous aime avant de pouvoir le faire. Eh bien pour moi, ça a été pareil ! Ah ah ah ! C’était en 1984, sur le tournage à Montréal de Paroles et musique, d’Elie Chouraqui, avec Christophe Lambert et Richard Anconina. J’étais déjà allé deux ou trois fois sur le plateau à Paris, mais j’avais juste échangé quelques mots entre les prises avec elle. J’étais parti à Montréal avec notre photographe Benoit Barbier, et notre objectif, c’était un reportage et la couverture de notre numéro d’été – c’est même, je crois, le premier numéro que j’ai fait sans Marc, parce qu’il était en vacances. Nous avions cinq jours pour tout faire. Pour la photo de couve, elle ne voulait pas d’une séance photo spéciale et elle nous avait dit qu’une photo prise sur le tournage, pendant ou entre les prises, ferait forcément l’affaire. Benoît était aux aguets comme un fauve en chasse ! Pour l’interview, elle m’avait juste dit qu’on trouverait bien le temps. Chaque jour, donc, je pensais pouvoir l’interviewer. Mais, soudain, je m’apercevais qu’elle avait quitté le plateau ! Je n’avais qu’à espérer que cela se ferait le lendemain. Et finalement, on a fait cette interview… le dernier jour ! Le jour même de notre départ ! Je l’ai souvent interviewée depuis, et heureusement beaucoup plus longuement, et ça a été un immense plaisir à chaque fois. Je l’aimais dans les films – et lorsqu’on a débuté, elle avait déjà une sacrée filmo, et elle a continué pendant toutes nos années, et encore aujourd’hui… – et je l’ai aimée tout de suite dans la vie. Pour à peu près les mêmes raisons d’ailleurs. Elle est assurément l’une des plus belles rencontres que j’ai faites dans ce métier, je lui dois quelques uns de mes plus beaux moments. Surtout pendant toutes les années Studio pendant lesquelles on l’a beaucoup sollicitée. D’abord parce qu’on l’aimait tellement qu’on ne manquait aucune occasion de l’interviewer, et souvent de la photographier, d’autant qu’elle s’entendait très bien avec Luc (Roux). Ensuite parce qu’elle a beaucoup tourné, et dans beaucoup de films excitants – ou… que sa présence rendait excitants !
ME. Elle est assurément l’actrice qui m’a le plus séduit, impressionné et enthousiasmé. J’aimais beaucoup la relation que j’avais avec elle. J’ai dû l’interviewer en tête à tête au moins quatre ou cinq fois, dont deux fois au restaurant. Vous posez le magnétophone sur la table, et pendant deux heures, Catherine Deneuve vous parle, ce n’est pas rien ! C’était un grand moment à chaque fois. Elle me parlait, à moi, et elle était vraiment à fond dans l’exercice, je n’avais pas du tout l’impression que c’était une corvée pour elle… En même temps, je n’ai jamais perdu de vue que ce moment était incroyablement plus fort pour moi que pour elle. Rencontrer une actrice qu’on adore, c’est autrement plus fort que rencontrer un journaliste qui vous adore !
JPL. La chance qu’on a eue, c’est qu’à l’époque de Première, comme on l’a dit, les journalistes de cinéma n’étaient pas si nombreux. Donc, des très longues interviews portant sur leur travail et sur leur carrière, il y en avait très très peu. Pour les actrices et les acteurs, je n’irai pas jusqu’à dire que c’était un plaisir, mais il y avait visiblement un peu de ça quand même. Alors qu’aujourd’hui, ils sont tellement sollicités – le nombre de journalistes de cinéma a dû se multiplier par cent ! – que c’est souvent devenu une corvée. Et ils sont devenus de plus en plus méfiants avec la presse, de plus en plus control-freak ! Il suffit aussi d’imaginer à combien d’interviews Catherine Deneuve a dû répondre depuis Les Parapluies de Cherbourg ! On peut comprendre qu’elle en soit lassée aujourd’hui. Idem pour les séances photos. Lorsqu’on regarde sur Internet, les photos d’elle qui existent, c’est hallucinant tellement il y en a. Je me demande combien d’heures au bout du compte, elle aura passé à poser pour les photographes ! En plus, c’était forcément plus simple pour elle d’accepter ses séances photos au moment du Sauvage qu’aujourd’hui, même si en bon « petit soldat » qu’elle est aussi, elle le fait encore pour la promo des films auxquels elle tient… Une fois que je l’interrogeais sur le temps qui passe, elle m’avait joliment et simplement répondu : « Le plus embêtant, c’est juste qu’il me faut un peu plus de temps pour me préparer ». Avec elle, il y a eu une interview très marquante qu’on a faite tous les deux ensemble, Marc et moi, pour le numéro de Première Spécial Cannes 1986, l’année où Le Lieu du crime, d’André Téchiné, dans lequel elle est déchirante, était en compétition.
ME. C’était au parc Montsouris. Elle est en imperméable gris clair, comme dans le film. Et c’est Luc qui a fait les photos…
JPL. C’est même sans doute sa première séance photos avec elle. La première d’une très longue série… On lui avait demandé d’être dans les tenues du film. On ne voulait pas photographier la star glamour des magazines mais l’actrice, voire le personnage, du film de Téchiné. Mais bien qu’en imperméable ou en petit gilet, quand on regarde les photos aujourd’hui, elle est presque plus glamour qu’en robe du soir ! Quand, à l’époque de Studio, j’ai fait avec elle une expo, puis un livre au profit de la recherche pour le Sida, qui réunissait quelques unes de ses photos préférées, elle en avait choisi une de cette série où elle est dans un kiosque à musique, les yeux fermés… On lui avait d’abord proposé d’aller dans le parc de Chantilly, qu’on aimait beaucoup, et où on avait déjà fait de belles séances photos, et elle nous avait dit : »Non mais vous rêvez ! On ne va pas aller jusqu’à Chantilly juste pour faire des photos ! » Et c’est comme ça qu’on s’était retrouvés au parc Montsouris. On avait rendez-vous en bas de chez elle, place Saint Sulpice, assez tôt le matin, et on devait partir dans notre voiture. Il était prévu qu’elle se fasse maquiller avant de nous rejoindre. On ne pouvait pas faire plus simple. On l’attendait depuis un bon moment déjà, à une vingtaine de mètres de la porte de son immeuble, lorsqu’on a vu sortir Pierre Lescure – leur relation était alors loin d’être connue de tous. Lescure, avec qui j’avais sympathisé dès que je l’avais rencontré à RMC, nous a vus, a hésité une demi-seconde, puis très naturellement, comme si c’était normal qu’il soit là, est venu vers nous en souriant : »Faudra être patients les gars, il y a eu une panne de courant ce matin, tout a pris du retard ! » Deneuve est finalement descendue, nous sommes partis pour le parc Montsouris, et lorsque nous sommes arrivés, il s’est mis à pleuvoir ! Nous avons alors commencé l’interview dans la voiture, avec le bruit de la pluie sur le toit. Au bout d’un moment, elle a dit : »On n’irait pas boire pas un café quand même ? » On a roulé un peu, on a trouvé un troquet, mais vraiment un petit boui boui genre Routiers, il devait être 11h ou midi, y avait sept ou huit mecs au comptoir. Quand on est entrés, quand ils ont réalisé avec qui on était, il y a eu un grand silence et c’est tout juste si on n’a pas entendu un »Woaaah » ! Et elle, très à l’aise, semblant ne rien remarquer, a commandé un café. C’est aussi ce que j’aime beaucoup chez elle : cette manière de ne s’empêcher de rien, de vivre le plus normalement possible. Elle conduit sa voiture, elle va faire ses courses – une fois, je suis tombé sur elle par hasard, deux jours avant Noël, à La Samaritaine ! – elle va au cinéma en salles, elle va aux puces le dimanche matin, bref elle vit ! Quand on est sortis du café, le soleil était revenu. On a pu retourner au parc, faire les photos, et terminer l’interview.
ME. Il y a un truc qui compte beaucoup et qu’on n’a pas assez dit, c’est que Jean-Pierre est resté 30 ans au total de Première et Studio, moi 17 ans, à peine plus de la moitié. Cela lui a permis de créer une qualité de relations durable avec plein d’artistes, alors que moi, à part avec Blier, ce sont des relations qui ont eu un début et une fin. Avec Deneuve, par exemple, il a des rapports de complicité que je n’ai jamais eus… Je n’ai jamais appelé Deneuve »Catherine » de ma vie !
JPL. Si moi, je l’appelle Catherine quand on se voit. Mais pas à tout bout de champ quand même ! Et elle me fait la bise la plupart du temps ! Ah ah ah ! Ce qui est incroyable, c’est qu’on a beau la voir au cinéma depuis longtemps, c’est qu’on a beau l’avoir rencontrée de nombreuses fois, lorsqu’on est face à elle, lorsqu’elle vous regarde droit dans les yeux et vous sourit, il y a un truc rare qui se passe ! Et encore, tu ne sais pas tout…
ME. Qu’est-ce que je ne sais pas ? Je sens que ça va m’agacer !
JPL. C’était pendant la Coupe du monde de foot, en 2014. Un soir, Thierry Klifa, organise un dîner chez lui avec quelques amis, des actrices et acteurs, dont Géraldine Pailhas, Christopher Thompson, Michael Cohen, et Catherine Deneuve. C’est un soir de match, et les rues de Paris sont noires de monde. À la fin de la soirée, Deneuve essaie d’appeler un taxi. Forcément, aucun ne répond. Elle décide alors de rentrer à pied. Tout le monde essaie de la décourager à cause de la foule dans la rue. Et là, je ne sais pas ce qui me prend, je dis : « Je suis en scooter, je peux vous raccompagner si vous voulez « , tout en pensant : »Mais qu’est-ce que je suis en train de dire ?!! Tais toi ! »
ME. Pourquoi ? J’aurais pu égorger un enfant pour emmener Catherine Deneuve en scooter ! Ah ah ah !
JPL. Je rajoute très vite : »Ah mais non, je n’ai qu’un casque… » Et là, Thierry : »J’en ai un que quelqu’un a oublié… » Et donc, Deneuve dit en souriant : »Ah bien oui, parfait ! » On descend tous les deux, on arrive à mon scoot, un petit Vespa 50. Elle met le casque, je l’aide à l’accrocher…
ME. Non ?! C’est un cauchemar ! Je vais me réveiller !
JPL. Heureusement, elle n’habite pas loin de chez Thierry. De Maubert à Saint-Sulpice, ça a été vite fait, même pas dix minutes… J’ai à la fois adoré le moment et, en même temps, j’avais un trac de malade. Je pense que je n’ai jamais conduit aussi lentement, aussi prudemment, ni autant regardé les feux rouges !
ME. Elle s’est tenue à toi ou au scoot ?
JPL. A moi. Mais tout simplement…
ME. Mais même du bout des doigts, j’aurais été au nirvana ! Pourquoi ça ne m’est pas arrivé à moi ?!
JPL. On arrive place Saint-Sulpice, je monte sur le trottoir et me gare en bas de son immeuble. Elle descend, enlève le casque, et fait un mouvement rapide de la tête en arrière pour que ses cheveux retrouvent leur place… J’entends encore ce léger schhhhhhh qu’ils ont fait ! Ce schhhhhh avec sa chevelure blonde dans la nuit, c’était un moment magique, un pur moment de cinéma. Juste pour moi…
ME. C’est la plus belle histoire de ces entretiens ! Il ne doit pas y avoir beaucoup de mecs qui peuvent se vanter d’avoir emmené Catherine Deneuve en scooter !
Propos recueillis par Sylvain Lefort & Fred Teper
Commander Mémoires d’un enfant du cinéma de Marc Esposito (Editions Robert Laffont) ici
Commander Gérard Oury – Mon père L’as des as de Jean-Pierre Lavoignat & Danièle Thompson ici
A suivre…












































